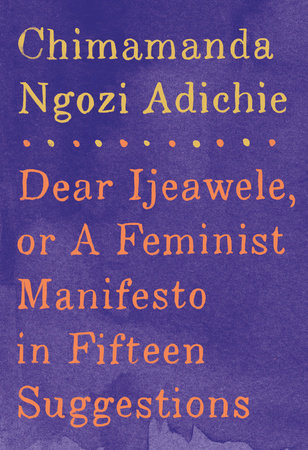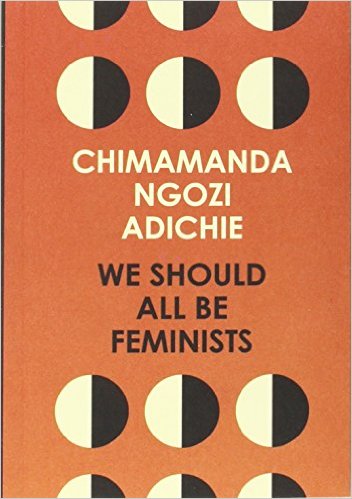Chimamanda Ngozi Adichie is back, ladies & gents. L’auteure de We Should all be Feminists, retranscription de sa conférence TED, qui a remporté un succès phénoménal, revient avec une publication à potentiel multi-best seller sur un thème similaire : le féminisme de masse, le seul et l’unique qui atteindra tous les cœurs de foyer. Cette fois, il s’agit de partir des fondations de l’esprit et d’imaginer une éducation féministe qui favoriserait l’ouverture sur la diversité du genre, dans cette lettre intitulée Chère Ijeawele, adressée à l’une de ses amies.

Ce court opus de 70 pages (comptez 20 lignes à peine par page) s’engouffre à la pause thé-café-biscuits, ou lors d’un simple trajet de moins de 60 minutes. On y retrouve Adichie dans une verve olympique et dans un format dans lequel elle excelle depuis son premier essai. C’est drôle, droit, concis. Les propos sont pragmatiques, les exemples sont toujours tirés de son vécu, mais la vérité y est universelle. Elle sait là où le bat le plus banal blesse, quand la sauce pique, et parvient avec une adresse toute naturelle à déjouer les retenues et réfutations à l’encontre des arguments qu’elle formule. Adichie a un talent pour se montrer à la fois compréhensive et intransigeante avec son sujet de prédilection.
Éduque-la à la différence. Fais de la différence une chose ordinaire. Fais de la différence une chose normale. Apprends-lui à ne pas attacher d’importance à la différence. Et il ne s’agit pas là de se montrer juste ou même gentille, mais simplement d’être humaine et pragmatique. Parce que la réalité de notre monde, c’est la différence. Et en l’éduquant à la différence, tu lui donnes les moyens de survivre dans un monde de diversité.
Avec ce petit manifeste, c’est 15 des piliers de la pensée féministe qu’elle énumère et illustre de ses anecdotes, qui par leur solidité et la force positive de leur auteure, parviennent à se loger durablement quelque part entre la tête et le poitrail.
Son entreprise globale est de désamorcer les préjugés mis en branle malgré nous, qui contribueront à l’empêchement féminin : préjugés trop ancrés, presque invisibles, transmis de génération en génération ou par notre exposition quotidienne aux idées sociétales, dans les journaux, dans la culture, dans l’Histoire.
La puissance des modèles alternatifs ne pourra jamais être exagérée. Parce qu’elle en aura côtoyé régulièrement, et que cela l’aura rendue plus forte, elle sera en mesure de s’opposer à l’idée selon laquelle les « rôles de genre » seraient figés.
Ses propos liminaires portent sur le travail, et la nécessité de ne pas s’excuser de travailler, en tant que femme. C’est pour elles-toutes que la pression sociale liée à la famille sera la plus lourde, et ce sont elles qui intérioriseront cette pression en la transformant en culpabilité, dès l’instant que l’enfant pourra paraître en souffrir ; tandis que les hommes, peu souvent – voire jamais – ne percevront leur occupation comme une source de culpabilisation, ou même de jugement, sur leur rapport à l’éducation des enfants. Rentrer tard ne sera qu’une conséquence logique et nécessaire de leur dévouement à enrichir le foyer, à des fins confortables. Elle met en garde contre les discours qui entoureront ces jugements : « Apprends-lui à questionner la façon dont notre société utilise la biologie de manière sélective, comme « argument » pour justifier des normes sociales. » Cette volonté de déculpabiliser la femme, et la mère, de sa volonté d’indépendance, d’entièreté qui s’allient au souhait de faire comme il faut, s’exprime parfaitement dans son injonction : « Accorde-toi le droit d’échouer. »
Adichie s’attaque ensuite au langage commun : « Et, je t’en prie, bannis le vocabulaire de l’aide. Chudi ne « t’aide » pas quand il s’occupe de son enfant. Il fait ce qu’il est censé faire. » Les tâches doivent être partagées, et la langue d’usage participe de cette égalité et de ce changement de point de vue. De même, elle encourage son amie à toujours laisser un champ libre de possibilités, de tenir son langage loin des contraintes, notamment de genre ; les valeurs qu’elle prône sont humanistes, il s’agit d’enseigner la bienveillance et l’assertion de soi, et contextualiser chaque doute, chaque conflit, pour ne pas croire qu’il y a une seule et même réponse à chaque question émergeant dans les relations de sexe : « Quand tu lui apprendras ce qu’est l’oppression, fais attention à ne pas faire des opprimés des saints. »
Mais quand même. N’en restons pas à d’heureuses (auto-)congratulations (pour lire ce livre) car il y a critique. Oui, critique. Et la chose n’est pas facile car je porte Adichie haut dans ma tête, et ses livres (y compris celui-ci) trônent fièrement, dans leur éventail d’éditions, éditions pas seulement acquises parce que les couvertures sont irrésistiblement géométriques.
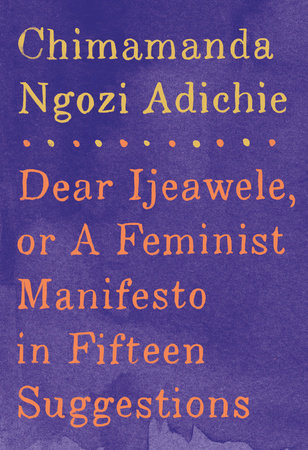

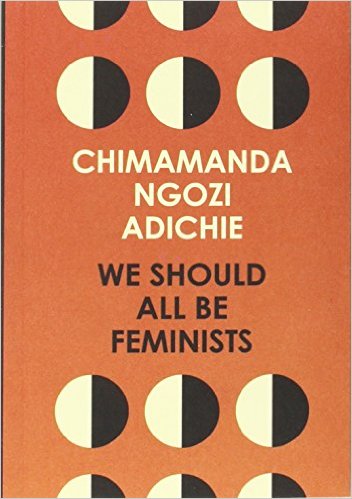
C’est la périphérie de cette publication qui m’a posé problème. L’autour. Et pour être plus précise (si mes restes de Génette étaient plus frais, l’ultime précision aurait peut-être été atteinte, mais la flemme de plonger dans les sous-sols de ma bibliothèque a coupé l’alimentation à mes veines de jambes), plus précise, disais-je, l’appareil marketing. Alors, que le marketing nous martèle et nous empêche, ce n’est nouveau pour personne. Que diable me donne-je donc cette peine qui n’en vaut pas ? Eh bien, c’est que je ne peux jouir d’un plaisir sans ombre à cette lecture, tant la crainte m’apparait que cette auteure chérie ne se transforme, malgré elle : car cette publication pose la question de l’auteure marketing. Adichie, devient-elle une sorte d’évangéliste ultra-populaire pour vendre cette idée de féminisme aux couleurs changeantes ?
Le livre est, à l’origine, une lettre rédigée à la requête d’une amie nigérianne, Ijeawele, interrogeant Adichie (comme de nombreuses personnes le font désormais, depuis qu’elle incarne cette figure de féministe messianique) sur la façon adéquate d’offrir une éducation féministe à sa fille. Cette lettre fut ensuite publiée en statut Facebook, sous une forme légèrement altérée.
Certes, il n’est pas inhabituel, ou contraire à l’éthique imaginaire de la création, qu’un auteur utilise ses productions à titre personnel (lettres, notes, morceaux de journal, etc.), pour en tirer profit. L’écrivain écrit, mais s’il veut en vivre, il doit vendre ses écrits, ça ne peut pas constituer une aberration, et ce serait vite oublier la normalité d’une telle pratique : depuis 25 ans, Amélie Nothomb (que j’affectionne également, #ToughLove) sort quelques feuillets de son tiroir et les refile en couronne à la Rentrée littéraire. Mais la valeur de l’auteure, sans vouloir tomber dans l’amalgame de celles et ceux qui vendent leur âme au profit du profit, tient en partie à son authenticité. Quand le filon commence à être exploité plus que de mesure, la foire aux vanités tient ses quartiers.
Aussi, on peut parler, en ce qui concerne ce manifeste, d’une écriture rapide, d’une production éclair et d’un objet à destination des masses, dans tout ce qu’elles ont de plus gros, c’est-à-dire un pouvoir massif d’achat commun, à condition que le prix soit petit et l’objet lestement digestible. Que se passe-t-il dans la tête de l’auteure lorsqu’elle accepte de publier, sous forme imprimée, son statut Facebook, et de le transformer en livre légèrement étoffé ? Joue-t-elle le jeu de l’éditeur, lorsqu’elle accepte cette publication, vendue à presque 15 euros, pour quelques feuillets non-inédits (le prix tout d’abord affiché) ? A-t-elle conscience de sa pleine valeur marketing (la marque Boots avec laquelle elle a signé un contrat pour représenter un rouge à lèvres aurait tendance à corroborer) ? Souhaite-t-elle exploiter son potentiel marketing pour établir un complément de revenus ? S’est-elle entichée de cette posture de porte-parole, de communicante sur un principe en lequel elle croit, dont elle est devenue l’image, l’incarnation ? Et d’un autre côté, le monde n’a-t-il pas fait d’Adichie une si parfaite porte-parole en raison de sa pleine féminité, de son physique glamour et de son charisme qui, au-delà de la compréhension des principes mêmes qu’elle porte, donne un sentiment de fierté aux suiveurs qui s’y identifient ?

So in the past few years, she has become something of a star, flourishing at the unlikely juncture of fiction writing and celebrity. Her position was on full display during her visit to New York, where she started her book tour last week. She took the stage in front of a sold-out crowd at Cooper Union, and there was “this kind of unanimous scream,” said Robin Desser, a Knopf editor who has worked with Ms. Adichie for 12 years.
… rapporte le NY Times, alors que son slogan a été récupéré et s’est imprimé sur la pop-culture, utilisé et détourné sur des t-shirts, des mugs et tout un tas de goodies. Idem pour L’Express « style », qui se demande qui est Chimamanda Adichie Ngozie, cette « icône » féministe ? Voilà qui nous fait dériver vers le concept de « Femvertising », le féminisme comme argument de vente, ni plus, ni moins : de Konbini à Madame le Figaro, le sujet soulève quelques interrogations.
Et de fait, Adichie a toujours unis les concept de féminisme et de féminité, en appuyant sur le fait que l’un et l’autre ne devaient pas s’opposer mais régner ensemble, dans la mesure de la volonté de féminité de la femme. Il y a une dichotomie entre féminisme et réflexion sur le genre, cette dernière ne rentrant que très peu dans le discours d’Adichie. La construction sociale de la féminité n’est pas réellement remise en question, quand bien même l’auteure précise qu’il ne faut pas encourager cette construction en insinuant qu’une chose (une activité, un vêtement, un aliment) est féminin ou masculin. Elle s’en prend, d’ailleurs, à la dichotomie des couleurs dans sa dernière publication :
Je ne peux pas m’empêcher de m’interroger au sujet du petit génie du marketing qui a inventé cette distinction binaire entre rose et bleu. Il y avait aussi un rayon « unisexe », avec toute une gamme de gris blafards. Le concept d’ « unisexe » est idiot, puisqu’il se fonde sur l’idée que le masculin est bleu, que le féminin est rose et qu’unisexe est une catégorie à part. Pourquoi ne pas simplement ranger les vêtements des bébés par taille et les présenter dans tous les coloris ? Les nourrissons, garçons ou filles, ont tous des corps semblables en fin de compte.
(Mona Chollet dans Beauté fatale, revenait également sur cette idée marketing de génie émergée au milieu de XXe siècle, car traditionnellement, le rose – et le rouge – avaient été jusque-là associés aux hommes)
Elle développe cette thèse, en discourant sur le rapport du vêtement et de la morale qui, selon elle, est nul :
Ne fais jamais le lien entre l’apparence physique (…) et la morale. Ne lui dis jamais qu’une jupe courte est « immorale ». Fais de ses choix vestimentaires une question de goût et de charme, plutôt qu’une question de morale. (…) Parce que les vêtements n’ont strictement rien à voir avec la morale.
Mais elle défend le goût des femmes pour le rouge à lèvres, les talons et les robes. Et quelque part, c’est ce qui est plaisant chez elle : elle véhicule des idées progressistes, le féminisme, mais n’effraie pas car elle ne remet pas en cause la base, les fondamentaux. Adichie secoue, mais ne dérange pas, ne révolutionne pas. La société dans ses fondations n’est pas remise en question. Elle plait parce qu’elle est consensuelle, parce qu’elle est féminine et féministe.
Prenons le contre-exemple d’Adichie, prenons sa presque nemesis : Jessa Crispin. Crispin a récemment publié un livre qui a fait un formidable tollé, Why I’m not a Feminist. Ce sont des idées de l’ordre du féminisme anarchique, révolutionnaires, grandioses. Impraticables ? Des idées qui mettent mal à l’aise parce qu’elles vont vers le déracinement des repères de sexe et de genre auxquels nous sommes habitués, malgré nous, des repères qui nous jalonnent sur toute une vie et sans lesquels nous serions pris complètement au dépourvu. Parmi ces repères, la féminité donc, le rapport hommes-femmes mais aussi la famille.

Dans son interview avec Flavorwire – qui est un must, pour celui ou celle qui a une heure à tuer et un malaise existentiel à se créer – elle va à l’encontre de tout ce que porte Adichie, comme intrinsèquement fallacieux et contre-productif de la cause qu’elle porte. Il s’agit pour elle de redescendre des fausses idées de féminisme appliquées au quotidien, à la culture. La famille est un leurre qui perpétue des stéréotypes de genre ad vitam eternam, la pop-culture est un outil de masse pour perpétuer les stéréotypes de genre. Buffy est en première ligne de ces attaques, car porteuse justement de cette idéologie prêtant à la culture un emploi féministe. Crispin remet fondamentalement en doute les prétentions de la série de Joss Whedon en s’en prenant à ce qu’elle considère être le tronc de la série : le caractère intrinsèquement charmant de Buffy. Le personnage féminin duquel tous les autre personnages tombent amoureux.
Qu’Adichie soit le porte-étendard du féminisme, cela n’est pas forcément un souci pour le mouvement qu’elle s’est appropriée et dont elle souhaite répercuter les idées, mais l’impact véritable du noyau dur demeure en suspens. Et ce qui pose tout autant question, c’est la machine, éditrice dans le cas de son dernier livre, qui est à l’œuvre derrière, machine à laquelle elle participe, en cautionnant un tel tarif pour un tel objet (même si là n’est originellement pas la place de l’auteur, puisque l’espace commercial appartient à l’éditeur). Ce petit livre, bien écrit, bien pensé, est fait pour circuler. Sa structure, sa taille, font de lui un objet de circulation, posté aux caisses, comme à Paris où Gallimard a mis en place des PLV. Gallimard qui a d’ailleurs exploité cette pépite avec une rapidité fulgurante : rapidité de traduction et d’édition, pour un petit objet bien confectionné avec soin (gaufrage, couverture à rabais + bandeau glacé) et sorti dans la collection Nrf pour 8 sous et 50 centimes. À la Librairie de Paris (qui appartient au groupe), les exemplaires foisonnent. Toutes les meilleures raisons d’abaisser son prix, puisque le tirage initial doit être diantrement élevé, ici et ailleurs.
Un livre au contenu pertinent et nécessaire, mais entaché par la volonté unanime de vouloir tirer profit de tout ce qu’Adichie touche, sans que celle-ci ne s’en émeuve particulièrement. Nonobstant ce coup de pif passager, je souhaite que ce livre lâché dans le monde ait désormais les meilleures répercussions possibles. On se souvient qu’un exemplaire de Nous sommes tous des féministes avait été offert à chaque adolescent suédois de 16 ans. Soyons follement optimistes : peut-être la Suède va-t-elle poursuivre sur sa lancée progressiste et offrir la version parentale, Chère Ijeawele, à tous les nouveaux parents de 2017 ?

 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !













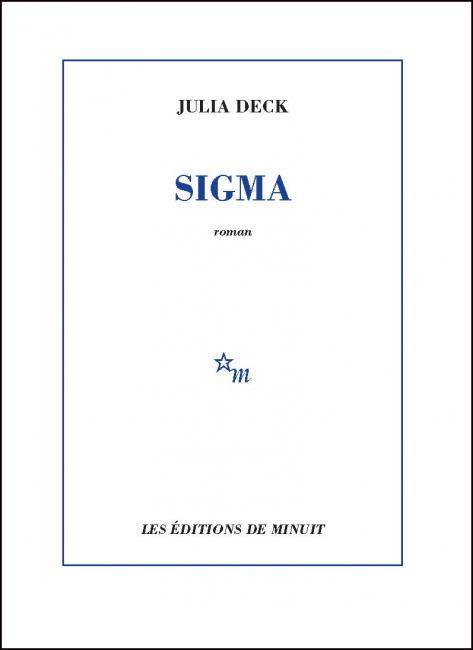
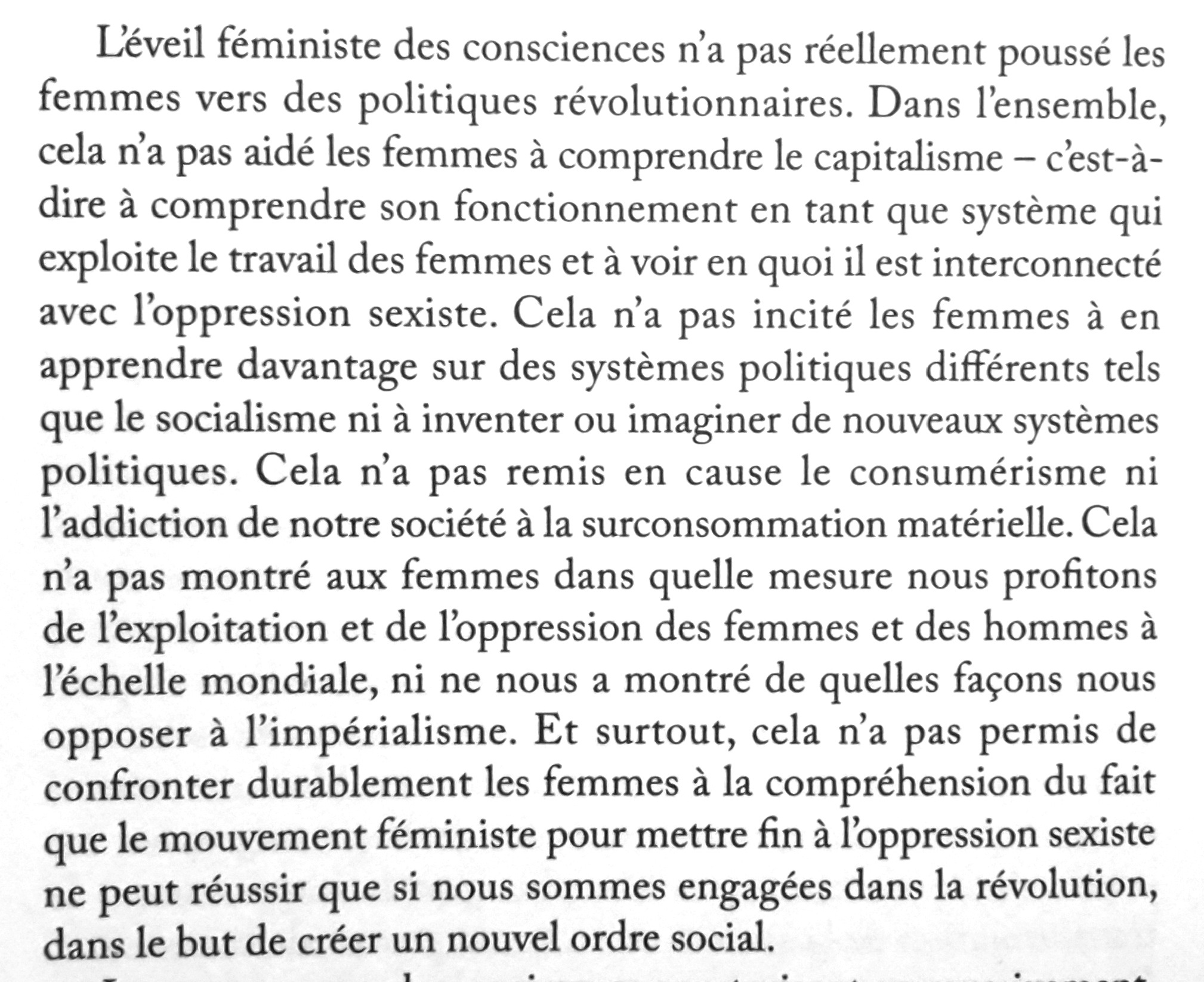







 Sylvia Beach la brindille, à gauche ; Adrienne Monnier la robustesse, à droite.
Sylvia Beach la brindille, à gauche ; Adrienne Monnier la robustesse, à droite.