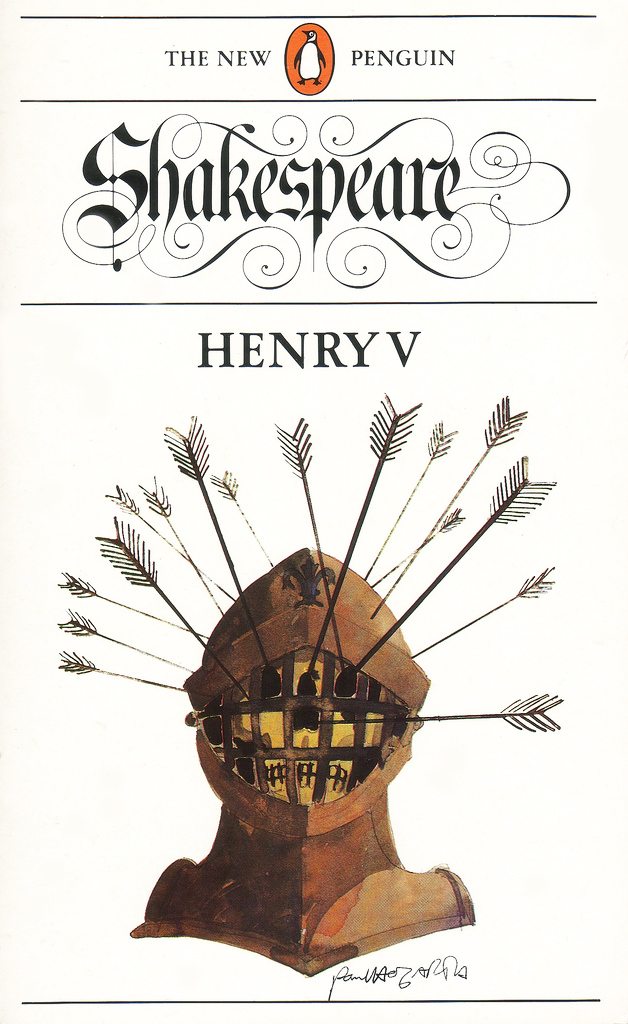William Shakespeare est un gonze que j’approche à pas feutrés. Les seuls contacts, jusqu’à présent, que j’avais eus avec la langue écrite du monsieur (je passe sur les multiples adaptations à côté desquelles, justement, on ne peut passer dans le courant d’une vie humaine, à moins de s’appeler David et d’aller s’exiler dans les bois avec son violon) était via la lecture de ses pièces en VO. À l’époque pas plus qu’aujourd’hui je ne maîtrisais l’anglais médiéval (ou Renaissance, ne chipotons pas), comme un bouc maîtrise sa puanteur, mais il va toujours plus de soi que le choc fut rude : pourtant, ma première lecture concernait Roméo et Juliette, et on peut difficilement envisager intrigue plus fameuse que celle-là. Et pourtant, la langue virevoltait, des jeux de mots à chaque vers, des références multiples et souvent trop élevées pour mes connaissances encore chevrotes : un monde littéraire s’ouvrait et mieux valait être bien armé pour le pénétrer, de crainte d’en manquer le sens.

J’aurais pu m’atteler à découvrir ensuite Hamlet, Macbeth ou bien Othello, qu’en sais-je : mais non, comme je n’étais pas seule partie dans ce choix, ce fut donc Richard III et Henry V qui poursuivirent le défrichage, et autant dire que la petite soufflette que j’avais cru naïvement prendre avec Roméo et Juliette, s’avéra être une bonne beigne dont les traces charrièrent profond. Du début mythique du monologue de Richard III, duc de Gloucester (« Now is the winter of our discontent »), épitomé du méchant à la verve triomphante et au culot meurtrier, à celui du choeur d’Henry V (« O for a Muse of fire, that would ascend / The brightest heaven of invention, / A kingdom for a stage, princes to act /And monarchs to behold the swelling scene! »), deux pièces historiques complexes et jouissives, toutes deux au coeur des enjeux de la Guerre des Roses, qui déchira le royaume en quête d’un monarque unique : l’usurpation est la crainte et la norme, la légitimité une valeur glissante, qui se transmet autant génétiquement que par contamination. Ainsi, Richard Gloucester va-t-il ruser et éliminer tous ceux en travers de la route le menant au trône. Shakespeare en fait le portrait éclatant de la monstrueuse bête incarnant le mal qui ne se refait pas : homme difforme de naissance, il trompe sans vergogne, use de sa langue envoûtante (car s’il n’a pas le physique, il a l’intelligence de mille hommes) pour parvenir à ses fins. Seule la Reine Margaret, impitoyable figure, jure la perte de ce vilain dont elle est perçoit la vile nature. Gloucester, après avoir terrassé ses ennemis, glisse doucement dans la paranoïa, entouré des fantômes de ses victimes, et périt de la main d’un usurpateur / héros – Henry Richmond, futur Henry VII, sur le champ de bataille en déclamant son fameux vers : « A horse, a horse, a kingdom for a horse! ».
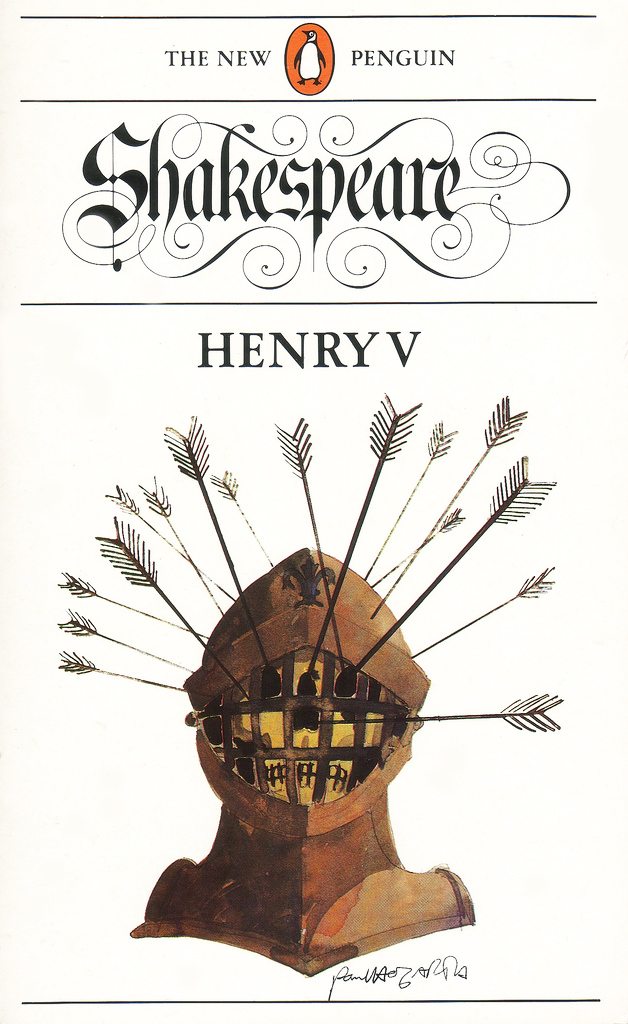
Quant à Henry V, il est pour sa part, l’incarnation du bon souverain : juste, courageux, intelligent. Et ce sont ses qualités qui pallient à son manque de bleu sanguin, car la droiture ne fait pas d’un homme un roi. C’est toutefois l’enjeu de la pièce : par ses qualités, sa bravoure lors des batailles (qui paradoxalement n’ont jamais lieu sur scène, c’est sa verve qui doit en créer l’illusion, comme elle doit compenser tous ses autres manques), Henry doit accomplir l’unité du royaume sous une même bannière, la sienne. La plus célèbre illustration vient du discours qu’il sert à ses troupes pour les rallier avant la bataille d’Agincourt, le fameux discours de la Saint Crépin qui agit pour une écriture de l’Histoire par celui qui la vit au moment où il la vit : c’est le discours démonstratif dans toute sa splendeur, Harry enjoint ses hommes à donner leur vie en son nom, que leur vie fasse son nom. Et il répètera tant le nom de “Crépin » qu’il en créera un mythe : « We few, we happy few, we band of brothers; / For he to-day that sheds his blood with me / Shall be my brother; be he ne’er so vile, /This day shall gentle his condition; / And gentlemen in England now-a-bed / Shall think themselves accurs’d they were not here, / And hold their manhoods cheap whiles any speaks / That fought with us upon Saint Crispin’s day.» Les gueux seront anoblis, hurrah ! La pièce se clôt sur une scène hilarante, où Henry qui a vaincu sur le terrain et gagné sa couronne, peut s’unir à la princesse française, Catherine de Valois, afin d’endosser le lierre gaulois. Sa cause lui est acquise, mais bien sûr Henry sauve les apparences quoi qu’il arrive, et décide tout de même de faire une petite cour de circonstance à Kate, histoire d’user des instruments royaux jusqu’au bout (la légitimation ne s’arrête pas au sang versé, mais concerne aussi celui excité). Hilarante scène en français et en anglais, où la pauvre Kate ne comprend pas de quoi le rustre lui cause, tandis que ce dernier pensait que son éloquence traverserait les frontières : « And take me, take a soldier; Take a soldier, take a King », « You have witchcraft in your lips, Kate » ou bien le vers par lequel il répond qu’il n’est pas l’ennemi de la France, et qu’il l’aime d’ailleurs tant et si bien qu’il ne l’en séparera pas de l’Angleterre (et hopla, Roi d’Angleterre et de France, emballé c’est pesé).
KING HENRY V
Then I will kiss your lips, Kate.
KATHARINE
Les dames et demoiselles pour etre baisees devant
leur noces, il n’est pas la coutume de France.
KING HENRY V
Madam my interpreter, what says she?
ALICE
Dat it is not be de fashion pour les ladies of
France,–I cannot tell vat is baiser en Anglish.
KING HENRY V
To kiss.
ALICE
Your majesty entendre bettre que moi.

Les sources utilisées par Shakespeare pour écrire ces deux pièces historiques (bien qu’on donne également l’appellation de tragédie à Richard III) et le contexte dans lequel il les rédige sont cruciaux à leur compréhension : car l’époque participe à la propagande d’une image monstrueuse d’un monarque malveillant en ce qui concerne Gloucester, qui n’était pas non plus un roi infirme ou difforme de son état. De même que le meurtre des deux petits princes dans la Tour de Londres qui lui est incombé dans la pièce, demeure l’un des mystères de l’Histoire, et Shakespeare parsème sa pièce ici et là d’éléments ambigus et complexes poussant vers une remise en question de la narration historique, toujours établie dans l’intérêt de quelqu’un, et précisément un pouvoir en place (celui d’Elisabeth, donc de la lignée des Tudors, à la légitimité brumeuse). Histoire manipulable, et transposable : parmi les adaptations notoires, on note la fulgurante performance de Ian McKellen (comment passer après ça), avec une scène d’ouverture des plus emblématiques et cette première scène de l’Acte I où Gloucester se fait volte-face dans le miroir de la caméra.
GLOUCESTER
I, that am curtail’d of this fair proportion,
Cheated of feature by dissembling nature,
Deformed, unfinish’d, sent before my time
Into this breathing world, scarce half made up,
And that so lamely and unfashionable
That dogs bark at me as I halt by them;
Why, I, in this weak piping time of peace,
Have no delight to pass away the time,
Unless to spy my shadow in the sun
And descant on mine own deformity:
And therefore, since I cannot prove a lover,
To entertain these fair well-spoken days,
I am determined to prove a villain

Une remarque en conclusion sur les traductions en français : j’y reviendrai dans un prochain billet sur le Roi Lear, dévoré ce week-end, mais dans le cas d’un auteur comme Shakespeare où la transposition d’une langue à une autre induit forcément une perte de sens quelque part, il est important d’en limiter l’état. Aussi d’anciennes traductions comme celles de François-Victor Hugo, malgré leurs vers ourlés, sont à fuir comme la peste (traductions très fautives). Celles d’Yves Bonnefoy ou Michel Leyris circulent beaucoup, mais pour ma part, ma préférence va à celles de Jean-Michel Déprats, qui entreprend depuis 2002 la traduction de ses oeuvres complètes (sortie en Pléiade, puis réédition en Folio), qui re-traduit en cherchant à retrouver la théâtralité du vers. Et ça se sent, d’emblée, lorsqu’on lit l’une de ses traductions : le vers est vivant, drôle, pertinent, on le visualise et cela change tout. La volubilité de Shakespeare est re-dynamitée, et on s’imprègne de l’histoire sans s’empêtrer dans les problèmes de compréhension que pose la langue dans d’autres traductions. Les suivantes sont donc disponibles :
- Tragédies I : Titus Andronicus, Roméo et Juliette, Jules César, Hamlet, Othello
- Tragédies II : Le roi Lear, Macbeth, Timon d’Athènes, Antoine et Cléopâtre, Coriolan
- Histoires I : La première partie d’Henry VI, La deuxième partie d’Henry VI, La troisième partie d’Henry VI, La tragédie de Richard III, Vie et mort du roi Jean
- Histoires II : La tragédie du roi Richard II, L’histoire d’Henry IV, La deuxième partie d’Henry IV, La vie d’Henry V, La célèbre histoire de la vie du roi Henry VIII
- Comédies I : La Comédie des erreurs, Les Deux Gentilshommes de Vérone, Le Dressage de la rebelle [La Mégère apprivoisée], Peines d’amour perdues, Le Songe d’une nuit d’été, Le Marchand de Venise
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !