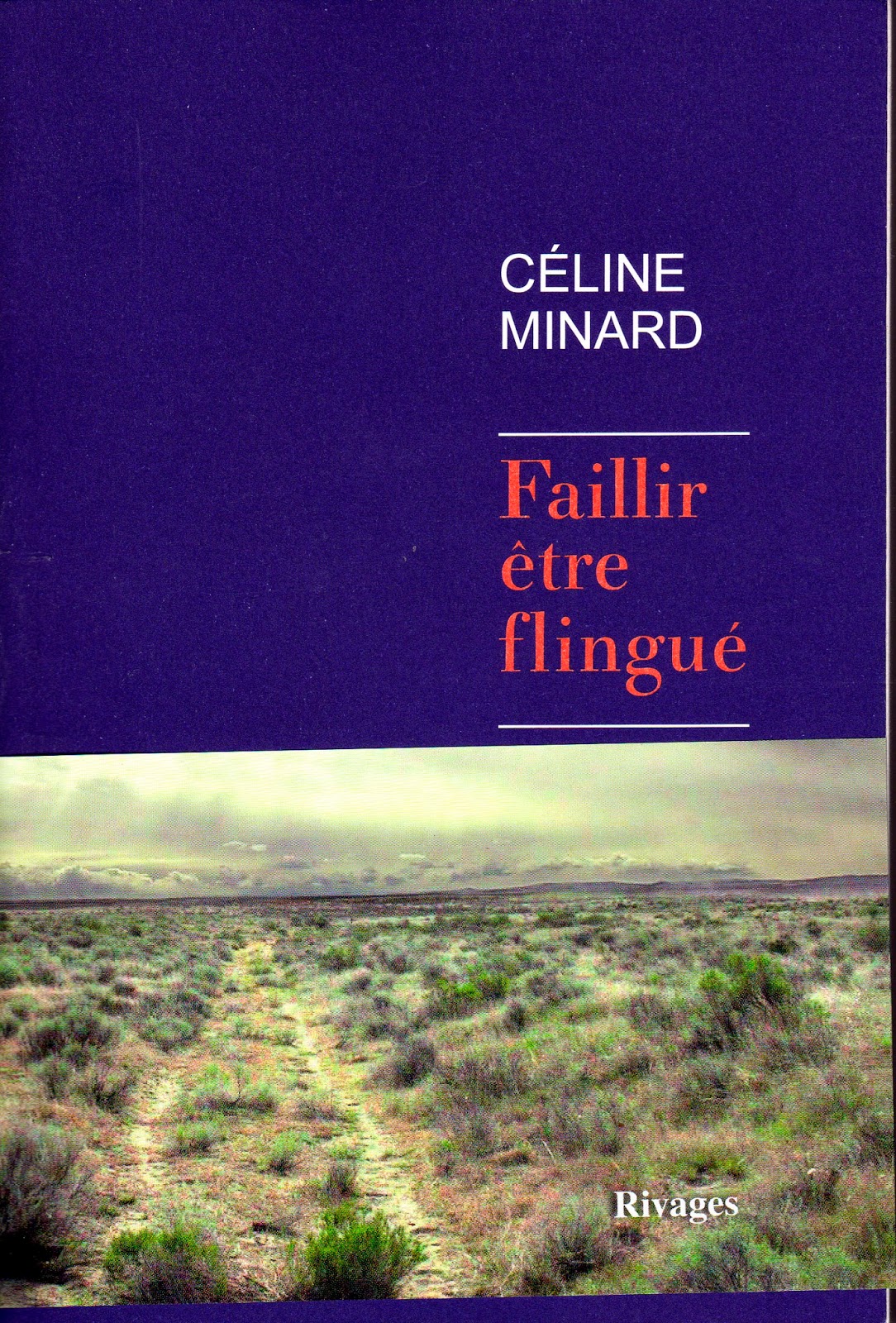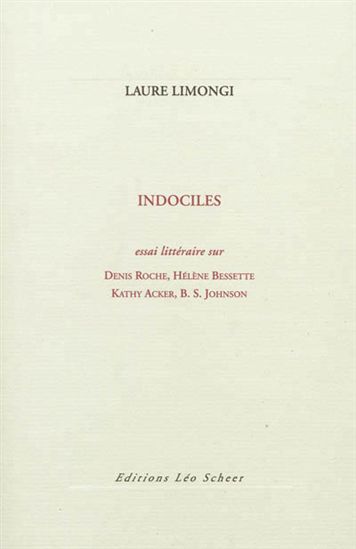Tenir sa langue, la tenir, à deux mains s’il le faut, est pourtant la moindre des politesses. Et peut-être le début du style, qui est avant tout un mode de vie, une discipline, une modulation.
So Long, Luise
Il est dit, sur ses quatrièmes de couvertures, dans les recensions de ses livres, dans les articles de presse couvrant ses nouvelles et anciennes publications, que Céline Minard est un ovni.
Son écriture semble-t-il détonne par rapport à la production actuelle, par son inventivité, par son rythme rebelle qui ne se laisse pas même dompter par sa propre plume, par ses choix d’écriture. Ovni littéraire, Minard ? Il faut prendre au mot les critiques qui sont dans le domaine de la littérature des références de lecture : son étrangeté, pour ma part, commence ailleurs. La première mise en échec qu’a paru réalisée Minard est à mon sens la figure de l’écrivain : Céline Minard n’est pas née écrivain, et à la question revenant de façon récurrente dans ses entretiens écrits, radiophoniques et tchats Internet, sommée comme une incantation divinatoire, comme une élucidation de son oeuvre – « L’écriture, une vocation ? », Minard répond un juste « Non. » Juste parce qu’il est vrai et va à l’encontre du fatalisme, de la construction mystificatrice de l’écrivain-né, du talent vocationnel, du cliché entretenu d’un art aux voies peu pénétrables. Minard commence donc chaque entretien par la déconstruction simple et sans appel de cette conception de l’écriture, où le talent serait inné : elle est avant tout une lectrice, la compulsion d’une vie jamais secondée d’en faire l’imitation. Ça lui a pris « comme ça ». Et plus précisément, elle rappelle la valeur de l’accident, de l’événement en expliquant comment à la suite d’une chute de patins à roulettes, elle fut cantonnée à son lit pendant une longue période, durant laquelle elle se mit à relire Rousseau et Les Confessions, tout en parallèlement réapprenant la marche.
C’est ainsi que nait son premier livre, mélange de philosophie et de réflexions personnelles, qui sera publié par les éditions Comp’Act sous le titre minimaliste R. L’écriture a donc suivi l’accident et fut renouvelée, comme une activité libératrice et pertinente. C’est une écriture d’exigence, qui se travaille pour se trouver, faite de ratures. Ses maîtres à penser de la philosophie et de la littérature nourrissent son écriture, en baignant sa narration de réflexions, digressions, interruptions, associations d’idées, apartés et autres commentaires adressés à soi-même ou au lecteur, selon l’angle duquel on observe la narration. Le mélange et la mixité, deux règles pionnières de l’écriture Minardienne qui cherche avant tout à explorer des territoires et créer des tensions par son style : les territoires de la langue inexplorés, afin de livrer une rythmique unique et faite (ou défaite) de sens. Plonger dans un texte de Minard, c’est plonger dans un mode de fonctionnement langagier qui décide de créer et suivre sa règle linguistique le temps d’une exploration. Avec pour résultante d’avoir poussé les limites de cette langue que l’on pensait appréhender, et possiblement en questionner sa « pureté ».
Des tailles devis
Céline Minard est née à Rouen en 1969. Après des études de philosophie et quelques années à oeuvrer en tant que libraire, elle publie deux romans : R. chez Comp’act en 2004, et La Manadologie, chez MF (Musica Falsa) en 2005, ainsi qu’une suite inventée d’un livre inachevé de George Sand, Albine, avec Sophie Loizeau et Daniel Arsand, aux éditions Comp’act en 2005. Le Dernier Monde paraît chez Denoël en 2007, puis est réédité en poche chez Folio en 2009. Dans le cadre d’une collaboration avec le Pôle graphisme de la ville de Chaumont et les éditions Dissonances, Minard écrit Bastard Battle en 2008, mis en page par la graphiste Fanette Mellier. Le livre est ensuite republié par les éditions Leo Scheer, dans la collection « Laureli », en 2008, puis repris dans un format poche par les éditions Tristram en 2013 dans leur collection « Souple » (une aubaine pour Minard qui se voit publiée dans la même collection que l’un de ses maîtres, Arno Schmidt). Chez Denoël paraissent Olimpia en 2010 et So Long, Luise en 2011. Elle travaille régulièrement avec la plasticienne scomparo (Sylvie Comparo) avec qui elle publie Les Ales chez Cambourakis en 2011 et s’expose avec elle à diverses reprises pour la sortie de ses publications. La dernière exposition en date est celle organisée à La maison de la poésie à Paris en novembre 2013, pour la sortie de son livre Faillir être flingué (Rivages, 2013). Scomparo y propose une traversée plastique de l’Ouest américain au travers de l’histoire d’un peuple fictif : une installation-performance en miroir de l’univers fictionnel du dernier roman de Minard.
Elle alterne entre petits indépendants et plus grosses maisons d’édition : le plus récent changement constitue sa publication chez un autre éditeur que Denoël (qui la suivait majoritairement depuis Le Dernier Monde), Rivages.
Le renouvellement de la littérature
Le problème des puritains avec le plaisir, le problème de Sade, c’est qu’ils cherchent à le faire durer. Absurde. La vraie question est celle de son renouvellement. Ce qu’il faut négocier avec la longévité, c’est la pertinence, la légèreté des passages entre les positions. Et garder à portée de main un flacon de lubrifiant.
So Long, Luise
Minard voit la fiction comme moyen de problématiser. À chaque livre sa forme littéraire : si dans R. et La Manadologie elle revisite la philosophie, elle accoste sur le territoire du roman d’anticipation avec Le Dernier Monde, où Jaume Roiq Stevens, cosmonaute de son état, refuse d’obéir à un ordre et se retrouve par le plus terrible des hasards seul survivant, en chute libre dans l’espace, observant depuis sa navette la disparition progressive de son espèce. Puis dans le cadre d’une collaboration graphique, elle écrit un texte mélangeant la langue du manga et celle moyenâgeuse de Villon avec Bastard Battle ; son ouvrage suivant, Olimpia la voit prêter sa voix à un personnage historique, Olimpia Maidalchini, dite Pimpaccia, l’égérie du pape Innocent X, pour une langue libre et rageuse traversée par l’italien. Son troisième roman, So Long, Luise publié par Denoël plonge pour sa part dans le merveilleux, la fantasy en proposant le testament mi-inventé d’une auteure française écrivant en anglais. Après une escale par le livre illustré via une collaboration avec la plasticienne scomparo que les éditions Cambourakis proposent sous le titre Les Ales, Minard revient à la rentrée littéraire 2013 avec un récit d’aventure revisitant le western, Faillir être flingué. Pas de genre de prédilection pour Minard qui prend plaisir à tirer de toute lecture une fenêtre d’écriture, et qui trouve dans les genres matière à détourner et problématiser. Si les livres paraissent à première vue si différents, c’est dans ce déplacement d’un genre à un autre, dans les emprunts et les assimilations dont Minard va tirer une néo-langue, dans les frictions et leurs résultantes que l’on pourra analyser ce qui constitue le ferment de son œuvre. Chaque livre s’aventure vers un nouveau territoire de la littérature et de la langue : elle s’intéresse à la philosophie dans R. et La Manadologie, la science- fiction dans Le Dernier Monde, le manga et le récit d’escarmouche dans Bastard Battle, l’écrit biographique et autobiographique dans Olimpia et So Long, Luise ainsi que le merveilleux pour ce dernier, ou plus notablement le western avec son dernier ouvrage, Faillir être flingué. Mais les genres explorés constituent avant tout des supports pour problématiser : problématiser l’espace de l’écriture, les codes et la langue.
L’écriture pour problématiser l’espace
Malgré ce que pourraient laisser penser ses études de philosophie, la pensée de Céline Minard s’avère souvent très concrète, concrétion qui passe par la pensée de l’espace. Espace qui se révèle littéral, dans Le Dernier Monde mais également dans Faillir être flingué où la plaine encore déserte se voit progressivement colonisée par la « civilisation ».
… lieu de l’action principale de mon gros roman que j’avais du mal à mener à bien faute d’une bonne spatialisation.
So Long, Luise
Faillir être flingué se situe dans la continuité d’un travail sur le mouvement : mouvement des différents personnages, perdus dans un espace élargi, alors qu’ils convergent vers une petite communauté. La composition globale présente les personnages comme évoluant simultanément dans un même espace. Les personnages se construisent entre eux, en même temps qu’ils construisent la plaine : le principal enjeu est de trouver ses repères sur cette lande encore vierge. La narration converge vers la ville, une ville qui s’érige finalement sur la mort de tous les Indiens.
C’est également l’espace-temps que son écriture cherche à montrer comme les deux versants d’une même notion, en mêlant le très archaïque et le très actuel : Bastard Battle voit ainsi le rythme sériel et la langue coup-de-poing du manga se mêler à celle de Villon, dans un Chaumont médiéval.
Les deux notions s’entremêlent également dans So Long, Luise : le lecteur ne sait jamais exactement où il se trouve et à quelle époque, car le temps va et vient, en avant et en arrière selon les lignes, et les espaces s’effacent les uns devant les autres, pour n’être plus que des visions claires ou moins claires selon l’humeur narrative. So Long, Luise fait le portrait d’une femme écrivain très âgée, qui déroule sa vie selon les périodes embrassées, via un testament qu’elle adresse à sa bien-aimée, Luise. On ne connait pas véritablement son âge – elle mentionne néanmoins ses quarante ans de vie commune avec Luise – mais sa vie a été des plus mouvementées. Celle qui parle est une femme de caractère aux dents longues, qui ne s’aveugle pas et ne perd jamais de vue l’aspect « gagne-pain » de l’écriture, ou « jactance » comme elle l’appelle pour en signifier la trivialité (« J’étais dans ma tour de guette en train de préparer une affreuse petite jactance destinée à régler nos six à huit mois de vie oisive »). Son projet est d’offrir à Luise des pensées de souvenance, un plaisir de mémoire, pour, au crépuscule de sa vie, étendre encore un peu le temps passé ensemble. La narration (et ses mensonges, ses versions, ses ratures et ses recommencements) est un moyen d’échapper à la longévité d’une vie en la déclinant le plus possible. Elle se remémore les moments d’amour et de vie partagés et en invente quelques uns : ce jeu de réinvention et de déplacement ouvre des espaces littéralement merveilleux.
Le jeu de la jactée (alea jacta) est sans aucun doute une façon de provoquer, de multiplier, mille fois pour une vie, la pauvre poignée de basculements possibles. Adoncques de contrer le temps qui nous est compté.
La narration est nulle part et partout à la fois : elle est dans la mémoire de la narratrice, aussi perdue qu’elle, aussi vague et peu précise, et la clef des déplacements est avant tout contenue dans les associations d’idées qui traversent le paysage mémoriel de la voix baignant dans ses souvenirs. Le récit est un verre à moitié plein, continuellement re-rempli de nouveaux souvenirs qui menacent de le faire déborder. Les souvenirs peuvent être longs, courts, sont rapportés dans un complet désordre, mêlés de pensées et réflexions présentes, et aucunement hiérarchisés. C’est un long monologue intérieur, dédié à sa bien-aimée.
Minard propose une réflexion sur le récit autobiographique et sa dimension mensongère (ou défaillante) en proposant la voix d’une testamentaire lucide et non-conventionnelle. « Attention, dans les récits qui vont suivre, je ne donnerai aucune date. Les lieux seront parfois déplacés, les noms s’il s’en trouve, transformés. » Le titre s’est éclairé à moi-même alors que je pensais faire une comparaison avec le film de Riddley Scott, Thelma et Louise : il s’agit bien entendu d’un parallèle significatif, avec l’histoire de ces deux femmes qui pillent, tuent et cavalent, et qui découvrent qu’elles peuvent vivre sans homme, jusqu’au bout. Minard propose sa version de Thelma et Louise, si seulement elles avaient survécu au plan final, et avaient pu s’aimer.
Dans Bastard Battle, Japon et France médiévaux sont également rapprochés, au-delà des langues qui divergent :
- Akira, qu’est-ce qu’un rônin ?
- Un samourai sans maistre.
Et lors comme un choeur tous nous écriâmes :
- Comme nous aultres ! Pareil au même ! Itelle ! Item et j’en suis !
- Que vivent et longue vie ! Longue vie aux sept samouraïs ! Yeepee !
Cette langue « ancêtre », elle souhaite l’exhumer, la faire revivre : cela ne passe donc pas par une simple mimique du langage moyenâgeux mais bien par sa refonte, sa subversion et son adaptation. Minard voit le potentiel narratif et humoristique qu’elle contient et s’en sert.
Se libérer des codes : écrire les tensions, écrire contre les clichés
Le ferments de l’œuvre de Minard repose dans les frictions, dans les rapports manquant d’évidence, dans les déplacements et les transpositions.
Au début de Faillir être flingué, les détonations sont nombreuses, comme on peut l’attendre d’un western. Mais progressivement, le contrôle social se met en place, par le jeu et le pari. Ce contrôle n’empêche pourtant pas les personnages d’être violents, et de trouver des façons plus raffinées de l’être. L’exemple du conflit qui se résout par une course plutôt qu’une bagarre à la fin du récit est probant. Le rééquilibrage interindividuel est constant car il n’y a pas de loi écrite. C’est la raison pour laquelle les conflits doivent se résoudre autrement que par la force. Le duel, passage obligé (ou cliché) du western a donc bien lieu, mais symboliquement, car personne ne tire.
Les scènes des bains (au Luxe Rudimentaire) sont une invention absurde de l’auteure – les bains publics ne font aucunement partie du topos du western : cette transgression de l’auteure s’accomplit dans un but humoristique et frictionnel, appuyé par le grand écart entre le rudimentaire (la plaine, vide) et le luxe (cigare, whisky, pain). Dans ces bains, on débat même de l’amour, allongés comme à l’époque de la Rome Antique, aux débuts de la philosophie. C’est une adaptation jouissive du banquet.
Dans So Long, Luise, le genre juridique du testament se mélange à celui de l’autobiographie, au roman d’aventure, presque picaresque (suite improbable d’aventures qui n’en finissent pas et se suivent sans discontinuer), ainsi qu’au merveilleux. Il s’agit bien d’envisager l’autobiographie comme écriture à fraude : la vérité se trouve dans le style, dans les traces linguistiques que laisse l’auteur et non dans la sélection des souvenirs narrés. Les faeries peuplent le récit, entre l’Irlande et le pays de Galles, les légendes se succèdent, les éléments (les lacs, les forêts) font surgir des aventures fantasmées et fantastiques : ce surgissement devient littéral lorsque la narratrice trébuche soudainement sur une fourmilière qui lui ouvre les portes d’un monde magique, un monde grouillant de bêtes et de créatures qui vit le temps de quelques pages, un monde « fourmidable » qui les mène vers une reine, une larve de majesté, qui les invite à prendre le thé et des loukoums dans son pavillon d’automne. La magie du merveilleux est faite de toutes les aires géographiques, mais elle provient également du quotidien :
C’étaient donc eux (des rats), et non pas d’extraordinaires termites, qui sapaient et trouaient sournoisement la pesante étoffe de la réalité quotidienne. (…) Cette maquette (…) était censée me permettre d’appréhender la séquence narrative problématique par tous les angles de mes différents personnages.
Ce détournement de codes est le leitmotiv d’écriture de Céline Minard, avec pour effet systématique de provoquer le rire. Les personnages sont outranciers, les situations passent du comique au dramatique dans la même phrase. Pour Minard, il faut tuer le cliché en s’en servant comme outil de déclenchement du rire, et en le dépassant systématiquement. Et pour enrayer le cliché, il faut en montrer l’inconsistance : il faut inventer.
Les courts chapitres de Bastard Battle se concluent par des cliffanghers artificiels, censés tenir le lecteur en haleine, calqués sur le modèle de prépublication par chapitre des manga. En effet, les bandes dessinées japonaises sont sérialisées, et le rythme des chapitres sont extrêmement calibrés : les péripéties doivent s’enchainer, afin de pousser le lecteur à se procurer la suite dès sa sortie. Les séquences se closent toujours sur une note dramatique. Minard subvertit cette notion de cliffhanger en rendant son usage complètement anecdotique, puisque le cliffhangher est le même d’un chapitre à l’autre. Elle met l’emphase sur la vacuité de réutiliser un même schéma qui tue le suspense en l’automatisant. Dans Bastard Battle, la phrase d’accroche devient la source du rire plutôt que de tension : « Ce qui fut, ce jour six de novembre mil quatre cent trente sept, son dernier mouvement de stratège. » Puis de nouveau, au chapitre suivant, après de nouvelles péripéties : « Et ce qui fut, le jour sept de novembre mil quatre cens trente sept, son dernier mouvement de stratège. » De même les codes des batailles sont ridiculisés : les attaques ont des noms ridicules, caricaturaux, et sont orchestrées par des personnages aux noms absurdes et déconnectés de leur magie :
On entend craquer l’os. L’homme hurle. Vipère-d’une-toise depuis le rempart hoche le chef et commande :
- Kung-fu du thé !
- Paume de sagesse !
Lançant sa main ouverte sur le poitrail de son ennemy, il prend un élan qui le porte droit, et souffle la grosse masse de l’homme désarmé, long de chemin, deux pieds en sus du sol.
La typologie de l’attaque de manga est reprise, contée dans une langue fleurie : l’homme est soulevé au-dessus du sol pour la magie de l’attaque « paume de sagesse ». La langue transgresse également le politiquement correct, en caricaturant à l’extrême : « … sous la tunique une paire de tétins assez platz mais tétins fémenins sans conteste puis longs cheveux noirs puis le visaige lisse d’un démon jaune. » La « démone » emprunte les traits physiques grossièrement stéréotypés d’une femme asiatique et ne s’en excuse pas, puisque c’est la notion de cliché qui est mise en scène.
Se libérer par la langue : « Par amour du beau langaige »
Ce qui compte avant tout, c’est le rythme.
So Long, Luise
La langue de Minard cavale : longues phrases, ou phrases abruptes, suite de juxtapositions, mêlée des genres, scansion et listes. Il ne faut rien éliminer : la lourdeur doit apparaître pour mieux ouvrir la voie à la légèreté. Les registres d’écriture sont source de tensions, l’érudition côtoie les barbarismes. Tous les livres de Minard sont dictés par cette logique de frictions : la langue d’Olimpia est traversée par les celles du XVIIe siècle, de l’italien et du Vatican, tandis que Faillir être flingué opère un fondu enchainé des registres de langue. Si l’on prend l’exemple de Bastard Battle, l’histoire met en scène Denysot-le-clerc, dit le Hachis et Spencer Five, clerc, illustrateur et copiste de son état : un héros bien littéraire en soi, servi par le parler cadencé du manga (présence lourde d’insultes, utilisation de l’anglais, formules de défis lancés à tire larigot, caractères excessivement orgueilleux ou excessivement humbles du héros et du méchant, et en règle général, omniprésence de l’excès) et des films de sabre (les références aux Sept samouraïs sont nombreuses), en compagnie de la langue du XVe siècle, rendue sur-contemporaine.
Le bastard lui dit : On me nomme Aligot, mais tu m’appelleras Saigneur. Je suis Aligot de Bourbon, second bastard du nom, le meilleur. Ta rançon, fils de pute, est de ce jour fixée à dix mille florins d’or car tu ne vaux pas le demi d’un Mérigot Marchès. Puis le bastard se détourna.
Le résultat est une langue bâtarde, à laquelle toute noblesse que l’on associe d’ordinaire aux langues vieillies, est retirée : Minard va à l’encontre de la pensée commune qui fait le parallèle entre « ancien », « difficile d’accès », « littéraire et élitiste », et l’ennui. La langue médiévale est dynamitée, hilarante, très intelligible. À l’instar de Queneau qui proposa le néo-français, on pourrait ici dénommer cet effort de création archéo-français : un français qui se réinvente tout en s’incantant lui-même.
Et lui, écumant :
- Gore pissouse, je ferai tanner ta piau pour ma descente de lit ! Lors Tartas lui dit très simplement :
- Va chier !
Ce que sans doulte il fit, ou simplement vider ses chausses.
Tu n’es pas un goin mâtin punais, à parler de droiture en menant ta faulsée par derrière. Icy tu joues ta vie, tu vas le sentir !
Les personnages n’ont aucune noblesse, aucune tenue, l’humour et le second degré sont leur règle de vie, véhiculée par la langue explosive : les jeux de mots pullulent (saigneur / seigneur) et se réalisent entre les langues. Les noms japonais sont calqués sur les noms français et sont dotés de particule (le « no » japonais se substituant au « de » français) : c’est une multilangue, faite de passages et de constantes transpositions. Le résultat est une langue complètement irrévérencieuse :
- Tu peux dire à ton maistre que je te laisse vivre eu égard à ta dextre, drunken master, quel est ton nom ?
- Denysot-le-Clerc dit le Hachis, aussi Spencer Five comme illustrateur et copiste. Mais je n’ay maistre mon sieur, je vais où le vin me pousse.
Et septièmement parla le sabreur. Il dit se nommer Akira No Suké, être fils du soleil levant, vermillon, et son sabre item portait nom : Katana. Il dit encore être un rônin occupé de la seule voie du sabre iaïdo, en quête de perfection. Que lesdites quête et voie l’avoient mené hasardement par les mers et les terres jusqu’en abbaye de Fontenay où les cisterciens l’avoient pris d’amitié.
Cette liberté d’invention passe dans So Long, Luise par un questionnement sur le bilinguisme. La narratrice se présente comme l’unique auteure française à avoir jamais été publiée tout d’abord en anglais, avant d’être traduite en langue française depuis son texte anglais. Le mensonge originel bien sûr est qu’en vérité l’écrivaine a toujours rédigé ses livres en français avant de les traduire elle-même en anglais. Qu’est-ce qu’une langue naturelle, une langue d’écriture ? La sienne est multiple, et prend sa source dans plusieurs endroits, à plusieurs époques.
Le bilinguisme, quelque usage ou double usage que j’en fisse, fut une excellente pratique de proximité alterne, profondément amoureuse.
Laure Limongi dans un essai sur Hélène Bessette paru dans son ouvrage Indociles (Léo Scheer, 2012) revient sur cette tentative d’écrire en deux langues : « Elle avait pour projet de développer une écriture réellement bilingue. Elle a longtemps défendu un manuscrit écrit en français et anglais intitulé Paroles pour une musique, disant que ce serait le « premier livre européen ». » Et Minard se situe dans la droite lignée bessettienne : « Pour Hélène Bessette, la langue française, si on doit en connaître les subtilités, n’est pas à ménager dans son intégrité. » Ce mouvement de la langue, sa réinvention sont nécessaires à la création d’après Hélène Bessette. L’écriture de Céline Minard agit dans une direction similaire. Langues et genres doivent se mêler de façon à ouvrir les frontières de l’écriture : la typographie doit être dynamitée, la poésie doit intervenir dans le roman, l’écriture doit avoir le panache de la vie. C’est une langue qui s’auto-entraîne, une première phrase ouvre la voix pour une seconde. L’énergie qui s’en dégage révèle un état d’ébullition dans lequel la pensée (de l’auteure, mais également du lecteur qui est entraîné avec elle) baigne. Ainsi les mots en anglais, les majuscules, les formules latines, tout est véhicule de pensée et de narration, rien ne se met en travers de la compréhension qui doit être envisagée dans sa globalité. Les mots difficiles, le vocabulaire spécialisé (de la philosophie, du merveilleux – les « pixies », les « Himantopodes », les « Panotes », les « kennings » – du juridique…) ne seront jamais un obstacle d’écriture mais un maillon nécessaire à son naturel, et à sa richesse.
Rita, la terroriste brune, se laisse enfin, enfin embrasser par sa collègue de la filature, retourne l’initiative timide et pose violemment ses mains sur le mur devant elle, décadre, lui mange la bouche. Elle s’étonne de sentir l’absence de son revolver dans son jean, déplace son centre de gravité sur le ventre de l’autre et pousse. Leurs mains frétillent..
C’est une langue qui se délecte, qui aime et cherche à retranscrire cette tendresse. Dans So Long, Luise, Minard tente d’écrire d’une façon renouvelée la force du désir, son électrification. Plus que tous ses autres ouvrages, ce testament factice revient à maintes reprises sur l’amour et la sexualité que partagent la narratrice et Luise. L’écriture tente alors de recréer ce choc du contact sensuel, rend compte et raconte l’amour homosexuel par le déplacement du désir (« le centre de gravité ») et de la description. Les lois de la physique peuvent être réadaptées. Le « revolver » est absent, la sexualité se trouve autre part.
Dans la tiédeur d’une nuit parisienne, contre le mur appuyée, tu m’embrasses. Je passe la main sous ta chemise, pensant toucher du bout des doigts le tissu de ton soutien-gorge, pensant déjà l’écarter mais tu ne portes rien sous la soie.Tu as des seins minuscules dont les aréoles sont totalement détendues, téton gauche piercé. Le contact direct, infiniment doux, me révolte, révolutionne, m’électrise. Tu dis sssht, dans mon oreille.Viens, j’habite à deux pas.
Les personnages ne sont jamais décrits dans le menu détail, l’écriture du désir passe par le mouvement des corps, par le matériel physique, par la surprise. L’irruption du discours direct libre renforce cette montée d’intimité que la narratrice a construite (la nuit, la tiédeur, l’immobilité. Puis un gros plan sur la main qui explore et contamine tout le corps, et monte jusqu’à la tête de la narratrice par la voix qui susurre à l’oreille) et en décuple l’effet : la langue fait frissonner.
… je préférais rester dans la bibliothèque pour jeter un œil au catalogue de l’arrière-grand-tante et toi, ma Luise, alliée Kara, mia cara, tu ne la suivis pas non plus, tout simplement pour être avec moi, et commencer un vrai roman d’aventure. Elle nous montra où s’éteignaient les lumières.
Le personnage de So Long, Luise écrit une déclaration de vie et d’amour à Luise, mais également à la littérature et à l’objet-livre :
Je te regarde du coin de l’oeil et ton profil de page découpe le monde qui m’entoure et l’enchante.
La fin de So Long, Luise est une apothéose : le testament est une carte que l’auteure laisse à sa bien-aimée, une carte mentale. Elle fait appel à son imagination pour la mener là où elle souhaite que Luise trouve son legs, tout en décrivant par le menu détail le parcours qu’il lui faut traverser. Un passage sur lequel je reviendrai plus en détails (oui, c’est possible), puisqu’il s’est agi ici de parcourir dans les grandes lignes les particularités de l’écriture de Céline Minard et ses enjeux.
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !