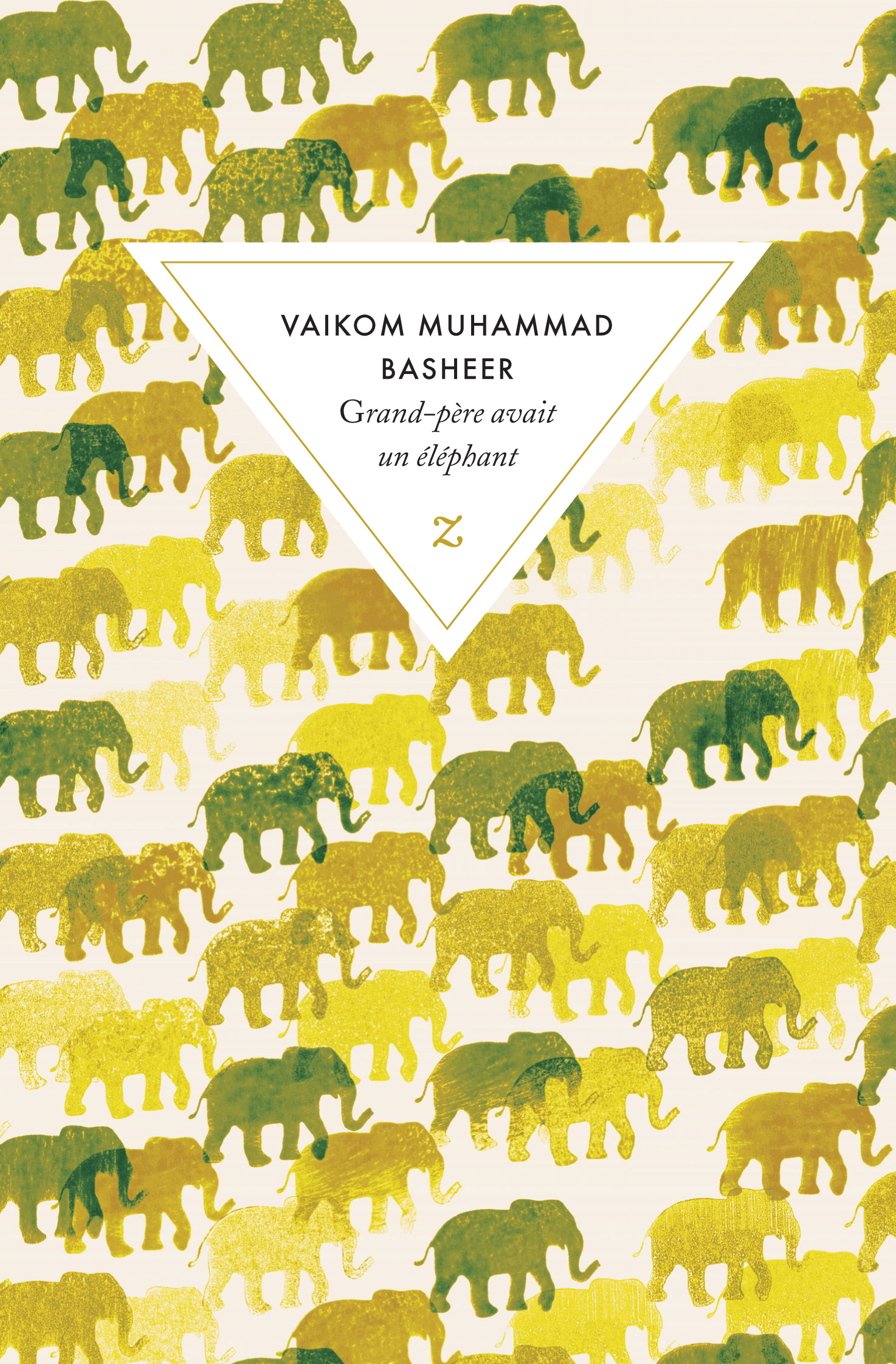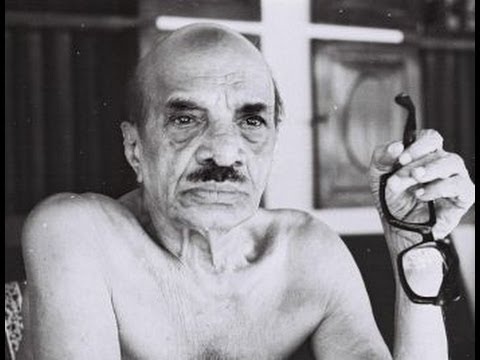Bon. Et si nous jactions un peu la France, histoire de textualiser ce présent effort d’actualisation sans presque-précédent ? Je ne l’écris pas son honte, que nenni, il s’agit bien là d’un effort, la Courtille de mes lectures prenant d’usage un siège en contrée étrangère. Mais bien heureusement, de cet effort-là, la sueur est modique et bien souvent féconde, quand elle n’est parfois pas absente.
Le comté France donc, mais attention : on ne cause pas de naguère mais bien du temps qui court, celui qui fend l’air de sa croupe, s’échevelle la frange, s’égruge le vernis. Celui qui détale dans l’espace quand on veut lui remettre les idées en place : le content forain. Ce temps-là, bien que l’on y soit vivace, on s’y noie tout aussi grassement qu’un bâton de pomme-frite dans une mare de mayo. C’est pas faute d’essayer (un peu, à la force molle du techno-addicte) mais le contemporain déborde de tous les ports, si bien que l’on finit toujours par revenir vers le dicible, le reconnu, le familier. Adiosse le tsunami de nouveautés, salute les valeurs sûres déjà goûtées ! Hélas cet état d’endormissement mène bientôt à de l’insomniscience si ce qui fait défaut grandit l’obsession du largué. En d’autres termes : pour dormir sur l’une de ses deux oreilles, il ne faut pas avoir de regret. Non, de remord. Non, de… frustration ? Mais de quoi ne faut-il pas manquer pour bien sombrer ?
L’angoisse du vide s’affirme chez moi par l’absence de connaissances. Ne soyons pas relativistes et parlons donc de connaissances nécessaires : non pas de celles qui permettent de changer une roue sans smartphone, mais plutôt des acquis expectés dans cette chair qui est la vôtre. Vous êtes un habitat et son locataire a des taxes à payer en fin d’année ; et vraisemblablement des comptes à rendre bien plus souvent. Angoisse, ma Gisèle ; détresse, mon David. Pour remédier à cette angoisse, ding-dong : un bâton de sourcier, et le sourcier qui l’accompagne. Sans cela, mes tâtonnements se limitaient à du 2012 : Deck, Chiarello, Salvayre, Pourchet et de projetées Lê, Pireyre… Assez de terre fraîche pour faire une jolie motte, mais pas de quoi combler un cratère.
Heureusement il y a le syllabus, cet outil indissociable du normé, cet appendice, avec sa joliesse séductrice d’agréé. Je m’en plains peu, ça me facilite toujours le travail, n’étant pas une fine snifeuse de page fraîche, encore moins une juge méditative en avance sur son ombre. Je ne dégaine d’ailleurs que peu, pour ainsi dire, et bien souvent je touche à défaut ou me tire dans le ventre. C’est en piètre experte de la prose que j’expose ma compagnie. Mais va-t-on seulement pourfendre un peu de Beau-Texte à la fin, me diront les gens venus pour faire affaire ?! Ouiouioui, faisons commerce allez !
Puisqu’il n’y a plus de honte à maintenir (voir Argumentaire pour une survie litt&raire ci-avant), ne commençons pas par l’écriture plate d’Annie Ernaux, ni celle contaminée d’Hervé Guibert : d’autant que ce dernier est encore intronisé dans le dernier Magazine Littéraire (soyons ribamrebelle et différons).
Aparté : il n’autorisa la publication que de sa correspondance à Eugène Savitzkaya, mais après lecture des deux premières lettres, je me demande bien pourquoi. La proximité m’en a donné un malaise insurmontable et j’ai stoppé ma lecture.
Vous ne savez pas si vous aimez les animaux mais vous en voulez absolument un, vous voulez une bête. C’est l’une des premières manifestations de votre désir, un désir d’autant plus puissant qu’il reste inassouvi.
Partons dans le désordre donc : j’ai refermé il y a quelques jours un ouvrage d’Olivia Rosenthal, dont le nom ne m’avait jamais été évoqué, malgré une liste d’oeuvres plutôt longue. Publié aux éditions Verticales, maison dont je commence à peine à découvrir la richesse (spécialisée dans la littérature française contemporaine) et arrêter de ciller devant les couvertures un tantinet éteintes (voilà c’est dit, la police ne me convainc pas), Que font les rennes après Noël ? disposait d’une quatrième rappelant vaguement beaucoup celle de Viviane Élisabeth Fauville, dont mon coeur s’est entiché voilà quelques mois : synopsis obscur (voire inexistant) mais d’un ton princieux d’Inca bilobé qui était fait pour m’appâter. Étrangement, le résumé offre un éclaircissement pour le lecteur distrait qui ne se serait pas sorti de sa narration en zigzag :
Vous aimez les animaux. Ce livre raconte leur histoire et la vôtre. L’histoire d’une enfant qui croit que le traîneau du père Noël apporte les cadeaux et qui sera forcée un jour de ne plus y croire. Il faut grandir, il faut s’affranchir. C’est très difficile. C’est même impossible. Au fond, vous êtes exactement comme les animaux, tous ces animaux que nous emprisonnons, que nous élevons, que nous protégeons, que nous mangeons. Vous aussi, vous êtes emprisonnée, élevée, éduquée, protégée. Et ni les animaux ni vous ne savez comment faire pour vous émanciper. Pourtant il faudra bien trouver un moyen.
L’histoire utilise un jeu de voix narratives alterné : la première, la principale (?) est la voix d’une enfant, d’une petite fille, d’une adolescente, puis d’une femme. On la cueille sur ses quatre pattes, alors qu’elle rampe son désir encore opaque de posséder un animal sauvage domestiqué, pour au fil des chapitres l’accompagner dans sa croissance et sa maturité. Sans identité bien définie, on ne connait d’elle que ses quelques pensées obsessionnelles sur les animaux, et son désir inassouvi d’en détenir un, sa relation forte et abandonnée avec sa mère, et ses quelques péripéties qu’elle enfouit bien confortablement dessous la conscience. Au fil des paragraphes qui s’alternent, on la devine grandissant, on la sait grandie, on écoute ses tentatives de s’expliquer un certain manque d’indépendance (« Vous ne désirez rien d’autre que de vous enfermer. ») Les émotions n’ont pas l’air de la tirailler, la narratrice est plutôt à l’aise avec l’idée de rester emmitonée dans son cocon familial, s’affranchir est à la fois un désir et une dernière priorité. Mais surtout, elle s’interroge : c’est ce qui la caractérise toute entière. Elle agit peu, mais s’interroge beaucoup : Qu’est-ce que s’affranchir ? Qu’est-ce que s’émanciper ? Pourquoi est-elle si bien élevée ?


On ne vous dit pas ce qu’on faisait des rennes après Noël. On ne vous a pas expliqué ce qu’il advenait du corps inerte des animaux. Entre les contes de fées et la vie réelle il y a un vide que vous n’arrivez pas à combler. (…) Vous décidez, si vos parents continuent à vous cacher la vérité, que vous partirez avec les rennes juste après Noël. Vous trahirez.
Vous reprenez peu à peu l’habitude d’aller au cinéma avec votre mère. Vous la laissez choisir le film, le jour, l’heure et la salle, vous n’émettez aucun avis, vous ne vous émerveillez pas, ne vous énervez pas, ne vous emportez pas, ne commentez pas, c’est votre manière de vous venger. Vous vous absentez.
Vous ne bronchez pas, vous ne soufflez pas, vous ne râlez pas, vous lisez, vous écrivez, vous remplissez les copies, vous passez des examens et des concours, vous étudiez sans effort, vous êtes à côté, derrière, sur le bord, vous êtes vague, vous êtes légère, vous êtes insaisissable, vous êtes nonchalante, vous traversez l’existence comme s’il s’agissait d’un nuage, d’une fine buée, d’une matière cotonneuse et sans résistance, vous vivez en somnambule, vous êtes anesthésiée, vous êtes endormie, vous êtes assommée, rien ne peut vous réveiller. Vous apprenez qu’on peut être ensemble et séparés. Vous vous absentez.
Un paragraphe sur deux, ce « Vous » narratif nous abandonne pour laisser la place à une voix plus impersonnelle : on en dessine son destinateur en prenant patiemment connaissance de tous ces détails techniques sur l’élevage et le dressage d’animaux. De l’imprégnation, le marquage, l’émancipation progressive, l’origine du sida (soit la cambrousse)… Cette figure masculine, qui change de peau au fil des chapitres, se présente petit à petit comme dresseur de faune sauvage, comme un éleveur, comme un soigneur : il dévoile des détails techniques, médicaux sur son métier, sur l’attachement aux bêtes, sur la distance critique qu’il faut garder et sur les bêtes elles-mêmes. Les descriptions sont souvent froides et scientifiques, teintées d’humanisme : certaines révulsent, choquent ; d’autres intriguent, éclairent. On y apprend le cycle de vie des animaux en captivité, les changements altérés dans leur physiologie, le besoin de les faire échapper à l’ennui. La problématique du dresseur revient souvent à rétablir une forme d’équilibre entre le quotidien aseptisé de l’animal et la nécessité de lui insuffler un souffle d’état sauvage, aussi artificiel soit-il, en commençant par une rupture partielle avec l’intimité qui peut naître de la proximité humaine.
Dans son introduction aux principes de la morale et de la législation (1789), Jeremy Bentham s’interroge sur la place des animaux dans la classification des êtres vivants. Si le respect qu’on accorde aux êtres vivants n’est plus fonction de la raison mais de la sensibilité, et par extension de la capacité à souffrir – puisqu’il est toujours plus facile de lire sur un visage quelconque la peine que le plaisir -, il devient urgent de changer de point de vue sur les bêtes. La question n’est pas : les animaux peuvent-ils parler, mais : les animaux peuvent-ils souffrir ?
La question du périmètre est intrinsèque aux deux narrations : mais d’ailleurs, que faire de cette alternance ? Des thèmes reviennent d’un texte à l’autre : la filiation, le désir, la mort, l’émancipation… Les liens semblent quelques fois très ténus d’un paragraphe à l’autre, parfois brumeux. Lorsque le dresseur décrit en détails comment réussir la décongélation d’un rat (pour que le serpent qui devra s’en repaître ne le rejette pas en flairant l’arnaque – la proie pas fraîche), on serre la bouche en coeur sans réellement mesurer son impact sur le second récit. C’est la question qui m’a taraudée : qu’est-ce que les exposés du dresseur apportent au récit de croissance de la jeune fille ? Comment peut-on les lire ? D’une manière ou d’une autre, l’un des deux récits prend l’avantage sur le second (dans mon cas, la continuité narrative, l’effet de progression chronologique aidant) : car contrairement au W de Perec, ce sont des paragraphes qui s’emboitent, et non des chapitres. Il est impossible de s’immerger complètement dans l’un comme dans l’autre, sauf lorsque le morceau qui vient d’être lu fait rentrer en jeu une donnée à suspense. Le récit de cette passionnée de bêtes frustrée se calque largement sur ce jeu de données, puisqu’en concluant toujours ses interventions sur le même modèle (le sujet accomplit une action, dont la modalité peut évoluer, régresser ou se stabiliser), elle pousse le lecteur à s’accrocher à sa voix en attendant attentivement une suite – une chute – quelque rétribution à la clef de ce ressort narratif.
Vous aimez les animaux.
Vous insistez.
Vous insistez.
Vous résistez.
Vous n’en dites rien à votre mère. Pour mentir, il faudrait parler.
Vous voulez trahir, vous ne savez pas comment vous y prendre.
Vous ne savez pas encore comment vous y prendre mais un jour vous trahirez.
Vous trahirez.
Vous vous oubliez.
Vous vous préparez.
Vous êtes contaminée.

Ces phrases assez simples ponctuent chaque levée narrative : de page en page, elles se déforment, se pervertissent, s’annulent, pour accélérer l’action dans le dernier morceau du livre. Le défaut, la fatalité, la possibilité qu’offre cette permutation, et ce serait là ma réserve, est que la primauté que prend l’une des deux voix fait passer derrière un voile les propos de la seconde : tant et si bien qu’il est parfois difficile de se souvenir précisément des riches détails rapportés par les comptes-rendus du dresseur. Le coup fatal fut porté par le film de Jacques Tourneur, La féline, que la jeune femme retrace et commente copieusement : mon affection pour ce film tant de fois visionné m’a transportée par-delà l’alternance vocale et m’a leurrée dans la croyance d’une unité complète du texte. Ce qui ne relevait pas d’Irena Doubrovna est en réalité passé à la trappe de mon attention, sans que je m’en aperçoive. D’où l’interrogation d’un tel procédé et les résultats escomptés : je n’ai nullement réussi à extraire de l’ensemble une forme totale de complémentarité ; au mieux, elle s’est réalisée à des endroits bien spécifiques, partielle donc. Au pire, l’une des narrations a estompé l’autre.
Pour écrire son livre, dans la continuité de l’écriture polyphonique d’On n’est pas là pour disparaître, l’auteure a réalisé une dizaine d’entretiens avec des gens travaillant directement avec les animaux : éleveur, dresseur, soigneur, boucher… pour en tirer la matière de préparation à la dimension documentaire de l’ouvrage. Mais c’est aussi d’une envie d’écrire sur les rats que nait cet ouvrage, comme elle le rapporte avec humour, un ouvrage traitant finalement de la domestication de l’humain.
Pour raconter ce qui a trait du passage de domestique à sauvage ou de sauvage à domestique, le mieux est de raconter l’histoire d’un humain depuis le début.
Au début, est-ce qu’on est sauvage ou domestique ?… Je n’ai pas réussi à savoir.
Olivia Rosenthal, à propos de Que font les rennes après Noël ?
Il reste qu’il s’agit là d’un regret quant à ma réception du texte, qui m’a beaucoup plu et dont je n’ai pu tirer autant avantage de la forme que je l’aurais souhaité. Quant aux enjeux de domestication, ils apparaissent dans toute leur limpidité en conclusion du livre, au cours d’une montée raide et libératrice, qui fait exploser l’anesthésie narrative et brise définitivement son consentement à être bridée. Un texte intrigant et hautement captivant.
Après votre divorce, certaines personnes continuent de vous donner votre nom de femme mariée, nom que par ailleurs vous n’avez jamais porté. Tout vous énerve.
À votre âge, il va falloir penser à faire des enfants sinon il sera trop tard. Vous ne voulez pas faire des enfants. Vous ne voulez pas devenir mère. Tout vous énerve.
Malgré vos explications, votre gynécologue n’a pas très bien compris votre changement de sexualité. Toujours pas de rapport sexuel ? demande-t-il d’un ton gêné à chacune de vos visites. Tout vous énerve.
Vous écrivez un scénario qui raconte une histoire d’amour entre deux femmes. Le producteur vous suggère de garder la même trame et de changer seulement le sexe de l’un des protagonistes, entre un homme et une femme ça ne sera pas tellement différent et ça sera plus universel. Tout vous énerve.
Vous avez quarante-quatre ans et on vous dit toujours mademoiselle. Tout vous énerve.
Quand vous marchez main dans la main avec une femme dans les rues d’une ville moyenne, les piétons vous dévisagent et se retournent sur votre passage. Tout vous énerve.
Vous êtes étonnée, vous êtes désarmée, vous ne maîtrisez rien, vous ne contrôlez rien, vous vous passionnez, vous vous énervez, vous vous engagez, vous vous impatientez. Après des décennies de rétention, de contention et de déni de votre part, vous n’avez plus le temps de vous justifier ou d’attendre. Vous lâchez ce que vous avez retenu tant d’années, vous l’exprimez. Vous découvrez la colère.
J’avais originellement prévu de regrouper quelques impressions vivaces sur la multitude de pages engouffrées dernièrement, mais de toute évidence, ma langue s’est déroulée un peu plus longuement que prévu. Ernaux, Échenoz, Chevillard et Guibert sont repoussés.
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !