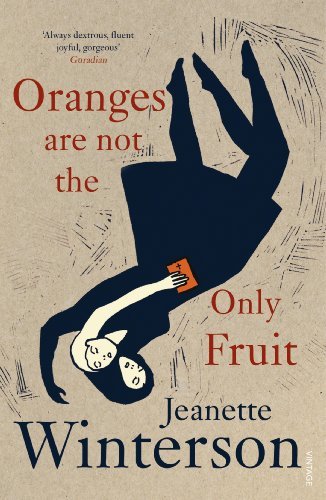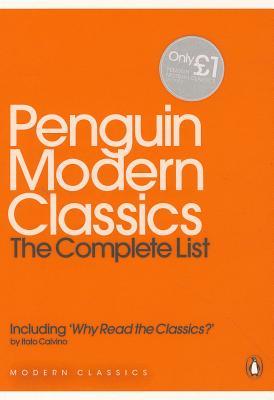Car en imagination j’avais pénétré dans une boutique au sol carrelé de noir et blanc, où pendaient des rubans colorés étonnamment beaux. Mary Carmichael ferait bien d’y jeter un oeil en passant, me dis-je, car cette scène se prêterait tout autant à la description qu’un pic enneigé ou une falaise rocheuse des Andes.
Il y a également la fillette derrière le comptoir – je serais aussi curieuse de connaître sa vraie histoire que de lire la cent-cinquantième biographie de Napoléon ou la soixante-dixième étude de l’utilisation faite par Keats de l’inversion miltonienne rédigée en ce moment par le vieux professeur Z et ses semblables.
Ainsi Virginia Woolf nous invite-t-elle dans A Room of One’s Own à dépasser ce que le bon goût littéraire commun considère comme des sujets et des oeuvres dignes d’êtres écrits, et lus. La critique continue de Woolf se concentre sur l’écartement historique des femmes des activités littéraires et artistiques, et le syllabus tout à fait genré qui en a résulté durant des siècles.
Je n’ai jamais lu Mauriac. Je n’ai aucun souvenir d’avoir parcouru Giono ou Ionesco, mes lectures de W ou des Mains sales n’ont pas laissé de traces indélébiles et je n’ai traversé Radiguet qu’à travers la biographie de Cocteau ; ma connaissance de Balzac est limitée, j’ai longtemps cru que Barthes aurait raison de mes neurones (avant même de comprendre avec l’arrivée dans ma vie de Derrida que l’univers du pire ne connaît nulle limite) et Céline n’a même jamais accaparé un tant soit peu mes pensées. Je n’ai jamais vu Fight Club non plus, Psychose m’a si peu marquée que je n’arrive jamais à jurer l’avoir bel et bien regardé, et je peux difficilement identifier l’auteur d’une composition classique.
Comprenons-nous bien : je ne fais pas l’éloge des chemins de traverse qui ont pour unique but de proposer des voies d’évitement. Je ne brandis pas non plus l’ignorance de certains travaux majeurs comme d’une marginalité entreprenante et légitimante. Je ne vais pas non plus, par le biais d’une rhétorique bancale, tirer fierté de ma perplexité face à certains textes qui me résistent. Tout comme je ne nierai pas la qualité d’oeuvres auxquelles j’ai résisté ou que ma mémoire a oblitérées, sans y réfléchir plus avant et sans nullement juger. Je considère que l’oubli peut être parfaitement indépendant de l’oeuvre, et ne pas se souvenir du prénom de son enfant ne signifie pas pour autant qu’on ne le porte pas dans son coeur (excusez du peu de guimauve, il faut ce qu’il faut).
Mais j’ai tendance à trouver certaines listes consensuelles. Tiens, en digressant de listes, en voici une que j’applaudis à moites paumes. Elle est rigolote et réflective. Les listes donc. Parlons de celles que l’on trouve communément dans les syllabus, les auteurs qui font la crème de la culture. Ceux sur lesquels on s’accorde, dont je retrouve les noms d’un numéro à l’autre lorsque je déploie, page après page, les frappes mensuelles du Magazine Littéraire. Et j’essaye de réfléchir : qu’ai-je fait, toutes ces années, lorsque je ne lisais pas Proust ?
Je lisais Jamaica Kincaid peut-être.
Où étais-je quand Marie N’Diaye faisait la une des journaux littéraires ?
Je découvrais Shakespeare, à mon rythme.
À quoi occupais-je mon temps si je ne parcourais pas les textes de Breton ?
Je tombais par hasard sur Tournage dans un jardin anglais.
Par le simple fait de ma curiosité, sans même connaître l’oeuvre sur laquelle le scénario était basé. Je rentrais dans la salle, poussée par le pur et simple fait de ma curiosité pour un sujet inconnu mais aux abords absurdes, et j’en ressortais complètement émerveillée, plus que jamais ouverte à un univers de trésors littéraires.
Interlude liste :
What happens when you search out Italo Calvino’s If on a Winter’s Night a Traveler, from If on a Winter’s Night a Traveler by Italo Calvino
So, then, you noticed in a newspaper that If on a winter’s night a traveler had appeared, the new book by Italo Calvino, who hadn’t published for several years. You went to the bookshop and bought the volume. Good for you.
In the shop window you have promptly identified the cover with the title you were looking for. Following this visual trail, you have forced your way through the shop past the thick barricade of Books You Haven’t Read, which were frowning at you from the tables and shelves, trying to cow you. But you know you must never allow yourself to be awed, that among them there extend for acres and acres the Books You Needn’t Read, the Books Made For Purposes Other Than Reading, Books Read Even Before You Open Them Since They Belong To The Category Of Books Read Before Being Written. And thus you pass the outer girdle of ramparts, but then you are attacked by the infantry of the Books That If You Had More Than One Life You Would Certainly Also Read But Unfortunately Your Days Are Numbered. With a rapid maneuver you bypass them and move into the phalanxes of the Books You Mean To Read But There Are Others You Must Read First, the Books Too Expensive Now And You’ll Wait Till They’re Remaindered, the Books ditto When They Come Out In Paperback, Books You Can Borrow From Somebody, Books That Everybody’s Read So It’s As If You Had Read Them, Too. Eluding these assaults, you come up beneath the towers of the fortress, where other troops are holding out:
the Books You’ve Been Planning To Read For Ages,
the Books You’ve Been Hunting For Years Without Success,
the Books Dealing With Something You’re Working On At The Moment,
the Books You Want To Own So They’ll Be Handy Just In Case,
the Books You Could Put Aside Maybe To Read This Summer,
the Books You Need To Go With Other Books On Your Shelves,
the Books That Fill You With Sudden, Inexplicable Curiosity, Not Easily Justified.(and so on.)
Fin de l’Interlude Liste.
J’ai pris Vian dans la ciboulot en passant les yeux par Trouble dans les andains, et je me suis contentée ainsi, ce trouble ayant trouvé confortable chaise sur laquelle me demeurer bien en tête.
Pourtant, j’aurais tort de me croire impromptue découvreuse de talents : je ne suis pas un fin nez mais bien des yeux aux aguets. Mes découvertes sont guidées, non par ma capacité à étiqueter des classiques inclassés, mais par la volonté de connaître les classiques à l’éclairage plus érudit, faussement marginalisés. Faussement, de la faute de l’Histoire (racée, genrée, classée) ; ou faussement, de leur caractère fondamentalement consensuel dans l’acceptation générale qui les attend fatalement une fois exhumés.
Je m’aperçois que mes propres lectures, mon syllabus personnel, est guidé par l’idée de classiques. Lorsque je balaye des yeux mes étagères, que je regarde au fond de mes innombrables paniers, que je parcours les étages de mes listes d’attente, je vois des noms et des titres, sans me souvenir souvent du trajet qu’ils ont emprunté pour en arriver là. Persuadée qu’il ne s’agit pas d’avis presciptifs de lecture professorale, d’où ai-je alors tiré l’envie ou la pensée qu’ils devaient être lus ?
Il y a d’évidentes réponses, tel le classique name-dropping dans des oeuvres qui font office de bâtisses sûres et solides. Mais que ferait Janet Frame entre Katherine Mansfield et Virginia Woolf ? Elle est, à coup sûr, le résultat d’une quête littéraire au pays des kiwis.
Charlotte Perkins Gilman, Mary Wollstonecraft, Maria Edgeworth, Laurence Sterne… sont rangés aux côtés des urgences, qui n’en finissent pas de s’accumuler sans jamais n’être que parcouverts : Olaudah Equiano, Aphra Behn, Frances Burney. Car les urgences ne cessent de se reproduire et de changer d’ère : Mary McCarthy, Rebecca West, Elisabeth Jolley, Elisabeth Strout, Janet Frame, Carol Shields, Louise Erdrich, Anne Tyler, Annie Proulx, Jane Smiley. Et le lendemain : Linda Lê, Steve Tesich, Emmanuelle Pireyre.
Mais s’il fallait donner une illustration bien personnelle des classiques, qu’énoncerais-je ? À qui me réfèrerais-je ? Pourrais-je nommer Jane Austen et Jean Giraudoux comme des figures constellaires ? Devrais-je avouer la place royalement trompeuse qu’occupe le rire dans mon échelle de valeur ? Que je lis Jarry en diagonale avec délice ? Que je n’ai juré que par Duras seulement pendant un temps, celui de la découverte ? Parlerais-je de mon admiration pour le caractère tamisé des oeuvres de Zweig sans savoir élaborer ?
Alors que je réfléchissais, mes yeux se sont à nouveau portés sur la liste des « Modern Classics », livres édités dans la collection limpidement dénommée par les éditions Penguin, avides d’éviter la controverse de l’amalgame avec ce fonds dépouillé de tout copyright – la marque du temps à valeur nominative contrôlée pour un classique digne de l’appellation. S’y trouvent quelques pages à l’éclairage bienvenu, un essai de la part d’Italo Calvino : Why Read the Classics?
Petit état de sa pensée à suivre.
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !