Un royaume pour théâtre, des princes pour acteurs
William Shakespeare est un gonze que j’approche à pas feutrés. Les seuls contacts, jusqu’à présent, que j’avais eus avec la langue écrite du monsieur (je passe sur les multiples adaptations à côté desquelles, justement, on ne peut passer dans le courant d’une vie humaine, à moins de s’appeler David et d’aller s’exiler dans les bois avec son violon) était via la lecture de ses pièces en VO. À l’époque pas plus qu’aujourd’hui je ne maîtrisais l’anglais médiéval (ou Renaissance, ne chipotons pas), comme un bouc maîtrise sa puanteur, mais il va toujours plus de soi que le choc fut rude : pourtant, ma première lecture concernait Roméo et Juliette, et on peut difficilement envisager intrigue plus fameuse que celle-là. Et pourtant, la langue virevoltait, des jeux de mots à chaque vers, des références multiples et souvent trop élevées pour mes connaissances encore chevrotes : un monde littéraire s’ouvrait et mieux valait être bien armé pour le pénétrer, de crainte d’en manquer le sens.
J’aurais pu m’atteler à découvrir ensuite Hamlet, Macbeth ou bien Othello, qu’en sais-je : mais non, comme je n’étais pas seule partie dans ce choix, ce fut donc Richard III et Henry V qui poursuivirent le défrichage, et autant dire que la petite soufflette que j’avais cru naïvement prendre avec Roméo et Juliette, s’avéra être une bonne beigne dont les traces charrièrent profond. Du début mythique du monologue de Richard III, duc de Gloucester (« Now is the winter of our discontent »), épitomé du méchant à la verve triomphante et au culot meurtrier, à celui du choeur d’Henry V (« O for a Muse of fire, that would ascend / The brightest heaven of invention, / A kingdom for a stage, princes to act /And monarchs to behold the swelling scene! »), deux pièces historiques complexes et jouissives, toutes deux au coeur des enjeux de la Guerre des Roses, qui déchira le royaume en quête d’un monarque unique : l’usurpation est la crainte et la norme, la légitimité une valeur glissante, qui se transmet autant génétiquement que par contamination. Ainsi, Richard Gloucester va-t-il ruser et éliminer tous ceux en travers de la route le menant au trône. Shakespeare en fait le portrait éclatant de la monstrueuse bête incarnant le mal qui ne se refait pas : homme difforme de naissance, il trompe sans vergogne, use de sa langue envoûtante (car s’il n’a pas le physique, il a l’intelligence de mille hommes) pour parvenir à ses fins. Seule la Reine Margaret, impitoyable figure, jure la perte de ce vilain dont elle est perçoit la vile nature. Gloucester, après avoir terrassé ses ennemis, glisse doucement dans la paranoïa, entouré des fantômes de ses victimes, et périt de la main d’un usurpateur / héros – Henry Richmond, futur Henry VII, sur le champ de bataille en déclamant son fameux vers : « A horse, a horse, a kingdom for a horse! ».
Quant à Henry V, il est pour sa part, l’incarnation du bon souverain : juste, courageux, intelligent. Et ce sont ses qualités qui pallient à son manque de bleu sanguin, car la droiture ne fait pas d’un homme un roi. C’est toutefois l’enjeu de la pièce : par ses qualités, sa bravoure lors des batailles (qui paradoxalement n’ont jamais lieu sur scène, c’est sa verve qui doit en créer l’illusion, comme elle doit compenser tous ses autres manques), Henry doit accomplir l’unité du royaume sous une même bannière, la sienne. La plus célèbre illustration vient du discours qu’il sert à ses troupes pour les rallier avant la bataille d’Agincourt, le fameux discours de la Saint Crépin qui agit pour une écriture de l’Histoire par celui qui la vit au moment où il la vit : c’est le discours démonstratif dans toute sa splendeur, Harry enjoint ses hommes à donner leur vie en son nom, que leur vie fasse son nom. Et il répètera tant le nom de “Crépin » qu’il en créera un mythe : « We few, we happy few, we band of brothers; / For he to-day that sheds his blood with me / Shall be my brother; be he ne’er so vile, /This day shall gentle his condition; / And gentlemen in England now-a-bed / Shall think themselves accurs’d they were not here, / And hold their manhoods cheap whiles any speaks / That fought with us upon Saint Crispin’s day.» Les gueux seront anoblis, hurrah ! La pièce se clôt sur une scène hilarante, où Henry qui a vaincu sur le terrain et gagné sa couronne, peut s’unir à la princesse française, Catherine de Valois, afin d’endosser le lierre gaulois. Sa cause lui est acquise, mais bien sûr Henry sauve les apparences quoi qu’il arrive, et décide tout de même de faire une petite cour de circonstance à Kate, histoire d’user des instruments royaux jusqu’au bout (la légitimation ne s’arrête pas au sang versé, mais concerne aussi celui excité). Hilarante scène en français et en anglais, où la pauvre Kate ne comprend pas de quoi le rustre lui cause, tandis que ce dernier pensait que son éloquence traverserait les frontières : « And take me, take a soldier; Take a soldier, take a King », « You have witchcraft in your lips, Kate » ou bien le vers par lequel il répond qu’il n’est pas l’ennemi de la France, et qu’il l’aime d’ailleurs tant et si bien qu’il ne l’en séparera pas de l’Angleterre (et hopla, Roi d’Angleterre et de France, emballé c’est pesé).
KING HENRY V
Then I will kiss your lips, Kate.
KATHARINE
Les dames et demoiselles pour etre baisees devant
leur noces, il n’est pas la coutume de France.KING HENRY V
Madam my interpreter, what says she?
ALICE
Dat it is not be de fashion pour les ladies of
France,–I cannot tell vat is baiser en Anglish.KING HENRY V
To kiss.
ALICE
Your majesty entendre bettre que moi.
Les sources utilisées par Shakespeare pour écrire ces deux pièces historiques (bien qu’on donne également l’appellation de tragédie à Richard III) et le contexte dans lequel il les rédige sont cruciaux à leur compréhension : car l’époque participe à la propagande d’une image monstrueuse d’un monarque malveillant en ce qui concerne Gloucester, qui n’était pas non plus un roi infirme ou difforme de son état. De même que le meurtre des deux petits princes dans la Tour de Londres qui lui est incombé dans la pièce, demeure l’un des mystères de l’Histoire, et Shakespeare parsème sa pièce ici et là d’éléments ambigus et complexes poussant vers une remise en question de la narration historique, toujours établie dans l’intérêt de quelqu’un, et précisément un pouvoir en place (celui d’Elisabeth, donc de la lignée des Tudors, à la légitimité brumeuse). Histoire manipulable, et transposable : parmi les adaptations notoires, on note la fulgurante performance de Ian McKellen (comment passer après ça), avec une scène d’ouverture des plus emblématiques et cette première scène de l’Acte I où Gloucester se fait volte-face dans le miroir de la caméra.
GLOUCESTER
I, that am curtail’d of this fair proportion,
Cheated of feature by dissembling nature,
Deformed, unfinish’d, sent before my time
Into this breathing world, scarce half made up,
And that so lamely and unfashionable
That dogs bark at me as I halt by them;
Why, I, in this weak piping time of peace,
Have no delight to pass away the time,
Unless to spy my shadow in the sun
And descant on mine own deformity:And therefore, since I cannot prove a lover,
To entertain these fair well-spoken days,
I am determined to prove a villain
Une remarque en conclusion sur les traductions en français : j’y reviendrai dans un prochain billet sur le Roi Lear, dévoré ce week-end, mais dans le cas d’un auteur comme Shakespeare où la transposition d’une langue à une autre induit forcément une perte de sens quelque part, il est important d’en limiter l’état. Aussi d’anciennes traductions comme celles de François-Victor Hugo, malgré leurs vers ourlés, sont à fuir comme la peste (traductions très fautives). Celles d’Yves Bonnefoy ou Michel Leyris circulent beaucoup, mais pour ma part, ma préférence va à celles de Jean-Michel Déprats, qui entreprend depuis 2002 la traduction de ses oeuvres complètes (sortie en Pléiade, puis réédition en Folio), qui re-traduit en cherchant à retrouver la théâtralité du vers. Et ça se sent, d’emblée, lorsqu’on lit l’une de ses traductions : le vers est vivant, drôle, pertinent, on le visualise et cela change tout. La volubilité de Shakespeare est re-dynamitée, et on s’imprègne de l’histoire sans s’empêtrer dans les problèmes de compréhension que pose la langue dans d’autres traductions. Les suivantes sont donc disponibles :
- Tragédies I : Titus Andronicus, Roméo et Juliette, Jules César, Hamlet, Othello
- Tragédies II : Le roi Lear, Macbeth, Timon d’Athènes, Antoine et Cléopâtre, Coriolan
- Histoires I : La première partie d’Henry VI, La deuxième partie d’Henry VI, La troisième partie d’Henry VI, La tragédie de Richard III, Vie et mort du roi Jean
- Histoires II : La tragédie du roi Richard II, L’histoire d’Henry IV, La deuxième partie d’Henry IV, La vie d’Henry V, La célèbre histoire de la vie du roi Henry VIII
- Comédies I : La Comédie des erreurs, Les Deux Gentilshommes de Vérone, Le Dressage de la rebelle [La Mégère apprivoisée], Peines d’amour perdues, Le Songe d’une nuit d’été, Le Marchand de Venise
L’écriture parrainée
Engouffré il y a quelques années, j’avais gardé en mémoire informatique des impressions de lecture sur cette intense leçon de narration. Il est temps de revenir sur cette écriture parrainée, par son adaptation ultérieure, par sa traduction flanchante, et de se parrainer soi-même en se republiant depuis les limbes.
Car Le Parrain, ouvrage de Mario Puzo, référence de la trilogie de Coppola père et films auxquels participa l’écrivain en tant que co-scénariste, est avant tout un petit bijou de narration.
Aux yeux de ses voisins, Don Corleone est un patriarche, un respectable père de famille qui a su donner à ses enfants une éducation où les rigoureux principes de la morale sicilienne s’adaptent aux nécessités de la vie américaine. Mais sa vraie famille est plus vaste ; c’est une des ” familles” de la Mafia dont il est un des chefs les plus aimés, mais aussi les plus respectés, car il est raisonnable et juste. Pour eux, il est le Parrain. Le Parrain, c’est l’évocation d’un monde souterrain qui sape les fondations de l’Amérique, d’une pègre redoutable que la société voudrait ignorer, mais que de retentissants scandales ne cessent de révéler au grand jour. De New York à Las Vegas, des somptueuses villas de Hollywood au maquis de Sicile, voici le portrait d’une nation gangrenée par ses syndicats du crime, sa guerre des gangs et ses puissances occultes.
Mais tout cela est bien plus alambiqué, me permettrais-je ? Plus amphigourique.
Si le livre a inspiré la production cinématographique, ce n’est diantre pas sans raison. Livre au suspense impitoyable et à la trempe bien solide, Le Parrain soigne son histoire, maîtrisée d’un bout à l’autre. Point d’esbroufe, l’action prône devant tout discours, et détrône parfois l’intelligence.
« Chaque chose en son temps ». Ainsi pourrait être empaquetée l’intrigue. Le lecteur n’est mis au fait des détails obscurs de l’histoire que lorsque le temps est venu pour lui de saisir la complexité d’un protagoniste et par là-même, ses mobiles d’action. Le procédé est efficace : les personnages sont esquissés, l’auteur nous présente à eux par le biais du présent et de leurs différentes charges. Nous suivons tranquillement leur évolution, sifflet au bec, l’attention présentement focalisée sur les agissements de la tête de la Famille. Puis débarque l’instant où un acte d’envergure vient exploser la vitre des apparences maintenues par le rôle que chacun des personnages est tenu de jouer. Mais en maestro des suspensions, Puzo opère un retour en arrière systématique chaque fois qu’il s’agit d’assister à la réalisation de l’importante opération qui se monte depuis des dizaines de pages. Il faut savoir ménager son histoire.
Ainsi vous voilà expulsé bien dix ans en arrière à la découverte de menus détails de vie : vous apprenez comment de fil en aiguille, cet homme est devenu ce qu’il est et est entré au service de la famille. Vous épousez ses motivations, ses enjeux, son mode de pensée. Et lorsque vous avez terminé de faire sa pleine connaissance, vous le retrouvez dans le présent, prêt à accomplir son forfait. Le suspense est alors durement mené et vous détient en haleine.
Ces retours en arrière pourraient paraître frustrants et fastidieux si mal menés : car lorsque inondé dans le déroulement du récit, vous êtes sommairement interrompu pour vous attacher à des détails généalogiques de certains des protagonistes, vous ne désirez rien que de retrouver votre cher présent de narration pour connaître l’issue des événements. Je l’avoue, il m’est arrivé de survoler quelques paragraphes, trop emprise à l’envie dévorante de connaître la conclusion de la trame narrative présente. Mais la vérité, c’est également celle de n’en avoir sauté que très peu (on se rassure comme on peut), et que ce livre de 481 pages à la police bien corpulente s’est engouffré dans ma tête en moins d’un jour, nuit de 8 heures et repas tout compris. Point ne faut de fanfaronnade, cette remarque n’a pour but que de vous signifier que votre serviteuse n’a pas lâché d’un seul ongle la reliure du Parrain.
Avec ses retours en arrière distillés çà et là qui feront fortement leur effet, le livre est composé de sept parties, dont la première ne comporte pas moins de cent-soixante-douze pages et la toute dernière pas plus de six (je vous épargne le camembert, mais l’intention est là). Ainsi, les retours se composent également dans l’espace : il n’est jamais permis au lecteur de suivre l’un des membres de la Famille au détriment d’un autre, mais il ne l’est pas non plus de lui faire lire deux lièvres à la fois. Chaque prose en son temps, et le changement de partie permet souvent une transition pour se focaliser sur les membres qui n’ont pas été oubliés, mais laissés temporairement sur la touche.

Mais il y a un hic, et pas des moindres : Le Parrain est relativement mal écrit, mal traduit, ou bien les deux. Pour re-contextalualiser ma harangue, l’édition qu’il m’a été permise d’alpaguer date de 1970. Je ne parviens pas à remettre le gant (puisque je contextualise, il faut bien s’adapter au givre qui habille le carreau) sur le dit-volume, mais il s’agit probablement d’une édition de J.-C. Lattès ou de Robert Laffont.
Assez paradoxalement, l’auteur maîtrise sans aucun doute sa narration qui malmènera plus d’un lecteur. Il tient rudement bien ses personnages et son histoire n’a pas à blêmir, très loin de ça. Mais l’écriture est simple, parfois frustrante de simplicité et souvent maladroite. On dénombre dans le livre plusieurs marques de présence d’un narrateur, plus ou moins indésirables. Jamais la narration omnisciente ne laisse transparaître une quelconque existence : tant, que lorsque une phrase comme « C’est là que nous retrouvons notre bon Antonio » (prénom fictif) au détour d’un retour de flash-back, on se prend à se demander qui est ce « nous » de connivence, car on ne se souvient pas que le narrateur ne nous ait jamais enjoint à rallier les actants de ce spectacle mafieux. Malgré sa terrine sympathique, on a envie d’aller déterrer les mânes de cet italien dégrossi pour lui signifier de toucher à sa plume parce qu’on a pas gardé les faisans ensemble. Plusieurs de ces phrases m’ont faite tiquer à regrets.
Font souffrir également toutes ces notes entre parenthèses, ignorant s’il s’agit de la marque de présence d’un traducteur ou de maladroites précisions de l’auteur : un mot italien que le lecteur serait susceptible d’ignorer et une parenthèse se chargera de son instruction le plus puérilement du monde (ça copain, ça veut dire « c’est notre affaire », cosa nostra, c’était une expression courante dedans le milieu). Ne remarquant aucune note en bas de page, aucune en fin d’ouvrage et pas même de préface ou d’index, il n’en est que plus probable que ces parenthèses soient l’œuvre d’un malhabile traducteur. Traducteur que j’aurais de toute évidence châtié sans déplaisir à la lecture d’expressions, telle que « à la bonne franquette » dans un contexte qui ne la tolère pas (selon mon avis d’ignorante que j’ai le toupet, que dis-je, l’outrecuidance de proposer à vos petits yeux gourmands). Et j’oublie presque de vous ennuyer avec les monumentales coquilles, jusqu’aux absences de lettres, qui sont la cause de toutes ces éruptions de sang et du relief nivelé le long des avenues de mon cuir chevelu.
Tout ça pour trouver du mal à une histoire passionnante ? Peut-être bien, mais pour inviter à se le procurer en VO également si l’anglais ne constitue qu’une balustrade pour la lecture, car si la traduction n’est pas si médiocre, c’est qu’exceptés quelques termes techniques tels que « poinçonneur » ou de l’argot passager (une souris et une minette, etc.), elle ne devrait pas poser tant de soucis de compréhension. Par chance, on peut également ramasser l’édition dont la traduction n’est pas désapprouvée (puisque non testée) par votre débitrice.
En résumé, loin d’être un monument littéraire, car péchant parfois dans son manque de finesse à l’égard du lecteur, Le Parrain et son histoire passionnante sont dotés d’un capital sympathie que l’on pourrait difficilement passer outre, et se lira vachement d’une traite (… de l’art de gâcher sa chute).
« La civilisation, vous dis-je, la civilisation ! cria Mr. Parker. Des chaussures bleues et des bottines de nankin ! »
Il est des mania dont on ne se dépêtre pas, et à en juger par ma matinée de balayage frénétique des librairies en ligne, Jane Austen a fait son retour triomphant après quelques mois de silence (… Adieu, argent).
Furetant parmi les étagères bien garnies de Gibert Joseph, j’avais cet été dégoté plusieurs éditions françaises de ses ouvrages, voulant malgré moi comparer les traductions d’Archipoche, de 10/18 et du Livre du poche, laissant à plus tard celles de Folio, Bourgois, ou encore Rivages. Comment alors résister à la mise en place d’une table thématique « Régence et ère victorienne » au milieu du magasin, où trônait comme un cygne une édition de Sanditon ?
Alors un peu de double standard contextuel ne fait jamais de mal. Tout d’abord, pourquoi dans ma mania je ne m’étais encore jamais intéressée à Sanditon, le tout dernier écrit de Jane Austen ? Eh bien il faut savoir qu’en réalité, Jane Austen a gratté un nombre bien restreint de romans (elle n’avait pourtant pas grand chose à faire de sa vie), que l’on compte au nombre de 6 (Raison et sentiments, Orgueil et préjugés, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey, Persuasion – les deux derniers publiés à sa mort). Oui, la folie Austen se perpétue depuis un siècle (tenons que l’engouement n’a pas démarré au quart de tour, malgré un honorable succès) et les multiples rééditions et adaptations se chargent de rejouer continuellement les mêmes intrigues que l’on connait sur le bout de la langue. Si l’on compare avec la production faramineuse de Dickens, on peut high-fiver Austen qui a bien joué son coup. Est-ce qu’Austen était une feignasse de qualité supérieure contrôlée ? Il faut plutôt aller piocher du côté de sa biographie et plus particulièrement sa date d’expiration : trépassée à l’âge de 41 ans, voilà qui enraye le processus créateur d’une œuvre nourrie sur la longueur. Fatalement. À ces six romans s’ajoutent donc des œuvres de jeunesse, Juvenilia (des pièces humoristiques, des essais, écrits pour distraire sa famille, et un court récit, Lady Susan), un roman abandonné (The Watsons) et un roman inachevé : Sanditon.
Et un roman inachevé, c’est un peu… bloquant (un turn-off, dans la langue des chasseurs). Les dénouements des romans de Jane Austen ont ce petit quelque chose qui donne la note du bonheur trémolo, ce truc irrépressible qui fait glousser comme une pintade et dont on ne se lasse heureusement jamais. Même la fin de Persuasion, qui atteint une note plus amère que les autres, réchauffe le torse comme un brownie chargé écrasé dans la bouche. Mais la pensée de rester sur sa faim (… oui) a longtemps écarté la lecture de Sanditon : l’infinitude de Middlemarch n’a pourtant pas empêché le monde savant de porter aux nues le roman de George Eliot. Inachevé sous le titre The Brothers, c’est sa famille lui survivant qui favorise le titre de « Sanditon », lieu où se déroule l’intrigue, et l’ouvrage sera publié à titre lointainement-posthume puisque il voit la couleur d’une presse pour la première fois en 1925, plus d’un siècle après son décès en 1817. Mais un second aspect bloquait quelque peu cette découverte : le roman inachevé avait été notablement « fini » par une autre plume.
Me voilà donc engourdie de toutes ces informations, prête à passer l’éponge afin de poursuivre mon exploration du territoire Austen : car découvrir un nouveau texte, c’est comme réaliser après avoir stérilisé à la puissance gloutonne de son plus petit doigt l’ensemble du pot de Nutella que l’on avait oublié de passer en revue le couvercle… C’est Noël dans les hanches !
On aurait tort de croire qu’un roman de Jane Austen s’attaque toujours avec facilité : certaines de ses œuvres ont cette accessibilité qui permet l’entrain dès l’incipit, Orgueil et préjugés n’étant pas des moindres. Sanditon pour sa part demande un peu plus de patience à la fanatique romantique qui ne demande rien d’autre que d’être fixée sur les liens tissés entre les protagonistes, quand les 120 premières pages vont pourtant prendre tout leur temps – un petit trot soutenu – pour exposer de long en large, en travers, en-dessus, en-dessous… la provincialité du bord de mer. Car on omet souvent, dans nos suremphatiques louanges des œuvres de Austen, qu’elle est l’écrivaine des caractères, celle qui donna des voix à un très large panel de petites et grandes gens, en modulant à l’infini leurs timbres et tons.
Mais un peu d’histoire, que diable !
En ce début du XIXe siècle où la bonne société anglaise découvre les bienfaits des bains de mer, les Parker se sont mis en tête de faire de la paisible bourgade de Sanditon une station balnéaire à la mode. Invitée dans leur magnifique villa, la jeune Charlotte Heywood va découvrir un monde où, en dépit des apparences « très comme il faut », se déchaînent les intrigues et les passions.
Charlotte Heywood, héritière noble mais comme souvent dans les romans d’Austen, avec un semblant souci d’héritage (treize frères et soeurs), se retrouve sous la protection d’un couple de gentils bourgeois, Mr. et Mrs Parker. Charlotte ne tarde pas à rencontrer la modeste société qui peuple le bord de mer : de la noble Lady Denham, vieille femme égocentrique et imbuvable qui a pris sous sa coupe (et comme esclave domestique) une jeune nièce, Clara Brereton, au caractère lunaire et énigmatique ; Sir Edward Denham, neveu pompeux et ridicule à qui il plairait bien de mettre le grappin sur la demoiselle Brereton ; deux sœurs excentriques et superficielles en mal d’amants, Lydia et Laetitia Beaufort, une héritière créole et sa protectrice, Miss Lambe et Mrs Griffith, et une grande partie de la famille Parker, dont deux sœurs et un frère célibataires, Diana, Mary et Arthur, qui ne sont rien de moins qu’hypocondriaques. Mais toute cette compagnie n’est rien et s’ennuie mortellement avant l’arrivée chamboulante du jeune Sidney Parker, à l’énergie et la bonhomie foudroyantes, qui vient secouer cette société un peu terne en tirant à ses côtés son bon ami Henry Brudenall, dont la mélancolie trahit une récente déception amoureuse.
Découragée que j’avais été en m’attelant à l’ouvrage il y a quelques mois (la persévérance des choses utiles n’est pas ma marque de fabrique), par les descriptions détaillées des petites affaires, des contingences et des potins, il ne m’a pas fallu cinq minutes cette fois avant d’être complètement immergée dans la lecture, si bien qu’à 4h30 du matin, il a fallu que je me ola moi-même. Tout est menu dans l’écriture de Jane Austen, et c’en est parfois surprenant comme elle passe d’une centaine de pages à décrire les plus minutieuses affaires quotidiennes, à ne plus pouvoir se départir des entretiens de personnages une fois que ceux qui étaient voués à être introduits ont enfin pu jouir du plaisir de se rencontrer. Si elle avait eu le temps de reprendre son manuscrit, Jane Austen aurait-elle accordé autant de temps partagé entre Charlotte Heywood et Sidney Parker ? Et parlons-en, tiens, de ces deux canailles qui sont les Lizzy Bennett et Mr Darcy de Sanditon.
Le personnage de Charlotte est un croisement inconnu de multiples héroïnes de précédents romans : elle a la réserve (provinciale dans son cas) et la prudence d’une Elinor Dashwood (l’aînée de Raison et sentiments) avec pourtant un penchant naturel pour l’aventureuse malice de Lizzy (Orgueil et préjugés), que son éducation lui a appris à brider. Moins expérimentée que Lizzy pourtant, ses principes ne tiennent que parce qu’ils n’ont jamais été exposés au reste du monde, et la voilà bientôt désarmée par le charme jouissif de Sidney Parker, bien décidé à lui faire lâcher sa retenue par un excès de franchise et de camaraderie.
On a, avec Sidney, un fascinant personnage d’après la définition de Austen : loin des beaux nobles qui récupèrent d’ordinaire les héroïnes austeniennes, dont les défauts sont plutôt ceux des princes (l’orgueil) comme avec Mr Darcy (Orgueil…), Captain Wentworth (Persuasion) ou Mr Knightley (Emma), Sidney se situe plus du côté des anti-héros dont les comportements ont été blâmés : notablement, George Wickham (Orgueil…) ou Frank Churchill (Emma). Sidney est irrécupérable, plein de failles mais dispose de la meilleure foi au monde. On perçoit le charme d’une Miss Crawford (Mansfield Park) qui valorise l’amusement avant tout mais n’en reste pas moins un personnage intelligent et profond, à la maîtrise des codes sociaux absolument parfaite. Car comment autrement réussir à tirer son absolution de tant de transgressions ?
Jamais autant de défauts n’ont été si peu conséquents :
Après s’être étudiée avec honnêteté, ayant reconnu la stupéfiante influence que Sidney avait acquise sur elle à son insu, Charlotte voulut réagir et lutter en se concentrant sur les défauts de caractère qu’il ne manifestait que trop, défauts qu’elle passa en revue de la sorte : il était désinvolte, mondain, imprudent, impétueux, dominateur, indiscret, incorrigible, irresponsable et sans doute indigne de confiance. Mais ce catalogue de défauts la fit seulement sourire.
Au commencement, le personnage de Charlotte est un régal de par son rarement vu : car bien loin d’être naturellement imprudente (Marianne Dashwood), elle le devient malgré elle, complètement désarmée par le charme du canaillou Parker. Personnage rafraichissant et surprenant, dont le caractère n’est pas défini dans la pierre, et forcé à changer par ses interactions avec le monde.
L’humour est savoureux, comme toujours les personnages croqués par Jane Austen parlent plus qu’ils n’accomplissent. Quelques interventions pompeuses de Sir Edward, aux citations erronées et à la superbe mal placée, valent le détour :
Tandis que Sir Edward en décrivait « l’aspect frangible » qui masquait « une construction adamantine » et se creusait la cervelle à la recherche d’une citation appropriée…
Ma chère Esther, concluait-il, notre conjoncture procrastinatoire ne promet en rien de culminer avec l’authentification de vos aspirations. Nos nouveaux amis semblent peu enclins aujourd’hui à leurs déambulations matutinales.
Dans cette ambiance festive de colonie de vacances, le jeu du match-making bat son plein : il faut se caser à tout prix ! C’est du renouveau Austenien qu’offre Sanditon et c’est assez jouissif. Et avec ce modulateur de compliment, il faut peut-être à présent en repasser les quelques défauts, parce que c’est en pinaillant qu’on devient Pina Bausch repasseur. Je m’explique.
Si Sanditon est dans l’ensemble ressemblant à lui-même, et qu’il faut admettre que jusqu’aux deux-tiers du livre, l’écriture tient la cadence, malgré quelques étrangetés pointant leurs ombres ici et là, vient le fatal moment où les péripéties et le style dans lequel elles sont rapportées ont un goût trop appuyé de jamais-vu. Si au début, on se surprend à aimer cette nouveauté, rafraichissante et renouvelante, elle traverse malheureusement la fine frontière qui la séparait de la dissonance, et fraye dangereusement avec la trahison calleuse.
Le roman a donc été achevé par une tierce main, et bien heureusement à aucun moment de la lecture, ce changement de plume n’est noté (bien heureusement, car sinon le lecteur aurait été trop conscient du changement, là où le choix lui est laissé de réussir à le constater, ou non). En fin de volume, une note de quatre pages intitulée « Quelques mots de justification à propos de l’achèvement du livre » écrite à la première personne mais non signée, nous explique que l’auteure n’avait conclu (dans une forme non définitive) que onze chapitres avant que la maladie ne l’empêche de poursuivre son travail (26 000 mots pour être plus exacte), tandis que l’on vient d’en engouffrer près de trente. Seule une centaine de pages provient donc de la plume régente, tandis que les trois cent restantes ont probablement été catapultées directement d’un clavier d’ordinateur. Cette notion de chapitres se révèle importante quand je m’aperçois que si le ton général du livre a fini par me choquer, je n’ai absolument pas noté la passation lorsqu’elle s’est opérée, ce qui constitue une vraie réussite d’écriture inventive pour cette voix souffleuse. Dans cette note, cette inconnue justifie son travail d’écriture en éclairant les probables intentions de l’auteure originelle qu’ont analysées nombre de critiques universitaires : bien que la voix de Charlotte Heywood ne soit pas développée en largesse lors de la première centaine de pages, il va de soi qu’elle est positionnée en tant qu’héroïne et que la mention à plusieurs reprises de la personne de Sidney Parker fait de lui le parti approprié pour former le cœur de l’intrigue sentimentale. Pourtant ce dernier n’étant pas encore apparu sous l’écriture d’Austen, il est dans le présent livre une complète invention de la continuatrice, à l’instar de ses comparses londoniens. Son caractère moins héroïque prend donc la forme d’un écartement de l’imitatrice, et non d’une simple évolution ou changement de parti pris dans la continuité d’une œuvre.
Voilà ce que dit de sa méthode Marie Dobbs (également connue sous le nom de Anne Telscombe), qui est en fait à l’origine de cette note et des vingt chapitres suivants comme le révèle le copyright (pourquoi les éditions du Livre de poche / J-C Lattès n’offrent aucun éclaircissement sur son identité, cela m’échappe – à moins que ce soit dans un but obscurantiste et participer à l’impression générale qu’une seule auteure mérite de trôner sur le devant de couverture) :
Comment Jane Austen entendait-elle ensuite continuer son roman ?
Ses intentions quant à l’intrigue de constituent pas une difficulté insurmontable. (elle) ne parle que d’une petite fraction de la société, personne ne meurt sous nos yeux et il ne survient jamais de catastrophes. Jane Austen ne s’intéresse pas aux événements politiques, ne se soucie pas des guerres napoléoniennes ; elle ne rapporte jamais une conversation où ne figurerait pas un personnage féminin. (…) Dans cinq de ses six romans, l’héroïne habite un village de campagne jusqu’au moment où un bon parti se présente. (…) Chaque héroïne a généralement un faire-valoir ou une rivale. Mais il y a toujours une fin heureuse.
Dobbs ajoute :
Sanditon est depuis longtemps connu des critiques littéraires ; j’aimerais cependant souligner que mon plaidoyer aussi bien que ma version achevée du manuscrit ne s’adressent pas à eux, mais au grand public qui lit Jane Austen.
Et voilà un moyen parfaitement juste de se prévaloir des critiques sur cette entreprise périlleuse : la suite est là pour divertir les fans, toujours plus en demande. L’expérimentation ne veut pas réussir en ce sens qu’elle ne pouvait qu’échouer. Mais pourtant, il est utile de critiquer pour comprendre ce qui fait l’unicité de ton d’une grande auteure, et bien heureusement, ce qui n’est pas si aisé à imiter.
Pour commencer, Marie Dobbs accorde au lecteur tout ce dont il a toujours rêvé et qu’il ne s’est jamais vu accorder dans un roman de Jane Austen : du temps pour l’amour. Charlotte et Sidney passent un temps démesuré à converser dans Sanditon, à échanger, à se taquiner. C’est tout bonnement anormal, et une faction de bonnes mœurs armée jusqu’aux dents les auraient arrêté il y a belle lurette dans un autre roman de l’auteure : autant de temps passé en la compagnie de l’un et l’autre aurait du valoir à Charlotte un aller-simple au couvent de Sainte-Ursule. Car de Raison et sentiments à Persuasion, on dévore la ligne qui permet de capter la tension électrique entre héroïne et prétendant. Tout est attente, suspense sociétal, description de menu fretin provincial. Les apartés sont peu fréquents et parfois si nuancés qu’il faut lire entre les espaces pour en saisir la charge sentimentale.
Dans la suite de Sanditon, on se voit pourtant accordé tout ce qui fut restreint par le passé : un effleurement de main plus qu’appuyé avec témoins à l’appui (sexy!), des entretiens renouvelés sur des pages et des pages, tous les amis du prétendant venant accorder leurs hommages à l’héroïne et lui répéter combien le dit-prétendant parle en bien sur elle (so much pour l’atmosphère de mystère), la jeune Miss Brereton confesse out of the blue à Charlotte qu’elle planifie une fugue (sans aucun agenda machiavélique ? improbable), on a également droit à des allers-retours pour les conscient et subsconscient de l’héroïne qui tergiverse tellement sur ses sentiments et ses faiblesses amoureuses qu’on en regrette presque qu’elle soit dotée d’un appareil à penser si c’est pour l’entacher comme ça – et qu’en plus on soit forcé d’en être témoin (vive le mutisme d’une Elinor ou d’une Jane), les dialogues et observations (qui finissent par s’appauvrir de façon aride à mesure que le dénouement approche) manquent de subtilité (les sous-entendus si bien soignés et si peu audibles chez Austen sont là braillés avec un mégaphone orange vif), Sidney Parker fait sa demande en mariage littéralement une minute après avoir rencontré le père de sa dulcinée (l’étiquette, quelqu’un ?) ce que ce dernier lui accorde dans l’instant parce qu’il semble disposer « d’un bon sens et de bonnes manières » (c’est un argument fort, c’est sûr)… Au-delà des caractères finalement mal dépeints des personnages, ces manquements atteignent leur apex avec le mot de fin : Charlotte et Sidney s’installent à Londres, car ce dernier ne peut envisager vivre autre part. Mes cordes vocales s’en sont emmêlées.
Autre aspect rarement vu dans ses précédents ouvrages : la modernité. Autant la guerre a souvent été présente par le biais des compagnies militaires stationnant (Orgueil et préjugés), la Marine (Persuasion)… Mais les sociétés décrites sont souvent très conservatrices : bon ou mauvais jugement, les fortunes bourgeoises sont parvenues. Mais l’énergie insatiable de Sidney Parker, déambulant de tous les côtés, prenant en main le destin de chacun, devient alors un symbole de modernité quand il est découvert par Charlotte que ce dernier investit dans « le gaz, la houille et l’éclairage » : Sidney défend l’entreprise d’éclairer Londres grâce au gaz, et prenait le parti des machines à vapeur avant cela. La modernité est enfin arrivée. Et les manières franches du jeune homme, revues à la lumière de ses engouements formeraient une évolution naturelle des mœurs, que l’Auteure n’aurait jamais incluse, en jeune vieille bigote qu’elle était et qui ne mettait pas un chausson hors de son boudoir.
Il reste que je salue l’effort, qui jusqu’à un certain point, m’a bien réjouie : et l’une de ses inventions, menée d’un tambour battant la mesure à moitié (mais battant tout de même), consiste en une scène pratiquement culte. La façon dont, au détour d’une mise en scène pour piéger la prudence et les bons principes de Charlotte en public, Sidney réussit à introduire une petite boîte à bijoux grotesquement moche dans le logis de la demoiselle, et ce sans éveiller aucun soupçon d’impropreté. Le détour se vaut, qu’on se l’assure, et la curiosité assez titillée pour aller lire du côté des continuations de Juliette Shapiro et Anna Austen Lefroy.
À quoi penser quand on ne pense pas
En cet agréable cours de déclin solaire de cette fin de semaine, qui n’est rien d’autre qu’un jour défini comme le dernier d’une liste, mais qui n’avait rien demandé à personne et aurait peut-être aimé se trouver être le cinquième ou le second, et ainsi disposer d’une certaine banalité dont les autres jours jouissent plus ordinairement, en ce simple dimanche donc, je décide de m’héler moi-même : “Est-ce qu’il ne serait pas temps de se baffer deux coups (la première pour réveiller, indispensable. La seconde qu’une baffe n’empêche pas le piège du siècle communément connu sous l’intitulé “snooze” (voilà la modernité, plus personne ne se lève le matin, l’urgence de la responsabilité est délayée)) et de pondre les trois-cinq croûtes qui me trottaient dans la turbine depuis une plomb ?” Réponse : oui.
M’enfin, pour paraphraser le film, c’est toute la question de la bravitude des choses, et je suis au regret de m’avouer intermittente de la pensée. On ne peut pas toujours penser, et d’ailleurs, on ne pense pas toujours. Il y a même des jours où l’on ne pense toujours pas. On me dira bien que je confonds réfléchir et penser, et on pense bien que c’est une question à laquelle j’ai déjà réfléchi. Je ne fais donc aucun commentaire à voix hautement écrite là-dessus, merci et à bientôt. D’où vient le mal donc ? Lénifience des sens ? Synapses mal configurées ? Distraction obstructive ? Ou faudrait-il fouiller du côté des possibles raisons pour lesquelles l’esprit ne s’étire pas ?
Oui, voilà que se profile la question du jour : sur quoi pense-t-on ? Et dans mon impropre cas, à quoi réagit-on ? Car lorsqu’on ne pense plus, cela va souvent de pair avec un défaut de réaction. La tête ne se trémousse plus, et le corps est désélectrifié. On baille intérieurement en regardant lascivement passer dans l’air les opinions et commentaires d’autrui sur les sentiers de sujets battus (et à rebattre), on tombe la tête lorsque les passions se déchaînent et on rentre tôt quand les pavés s’allument. Désintérêt de l’autre et repli sur soi ? Glaçage de l’appareil à penser ? Ou bien les encres s’estompent-elles sans jamais s’imprimer sur l’écran mémoriel ?
Tout ça pour lire, j’ai soufflé trois lignes (des livres qui m’ont éraflée en les lisant, mais dont les traces ont séché depuis, miettes d’une lointaine ingestion) sur quelques uns des romans engouffrés ces derniers mois. Le billet s’est programmé de lui-même dans le passé, alors que je poussais avec beaucoup de pression poucière la touche “publier maintenant”.
Notons que ce cafouillage en dit long sur la technotention qui ferait main de se mieux manoeuvrer.
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !
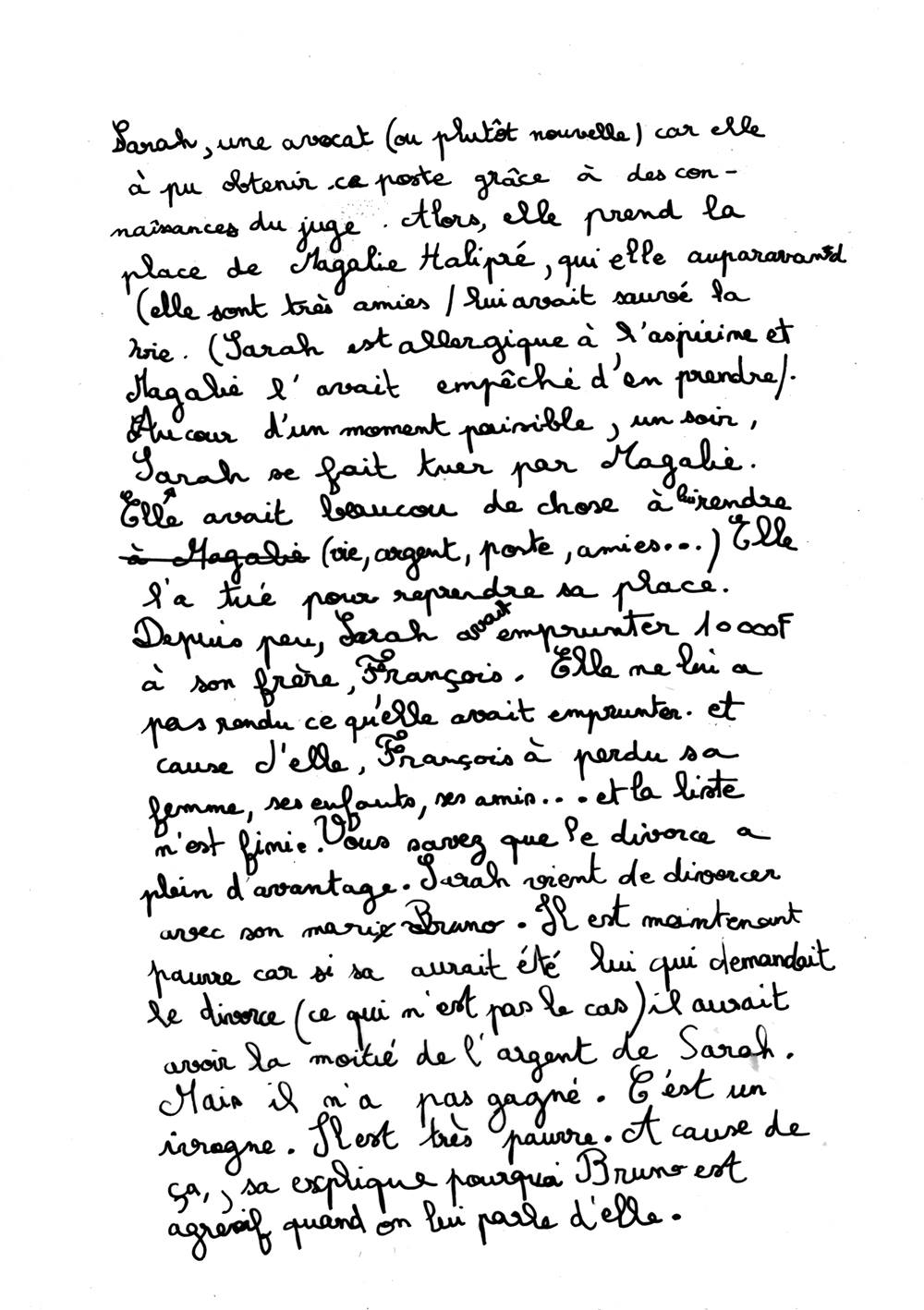

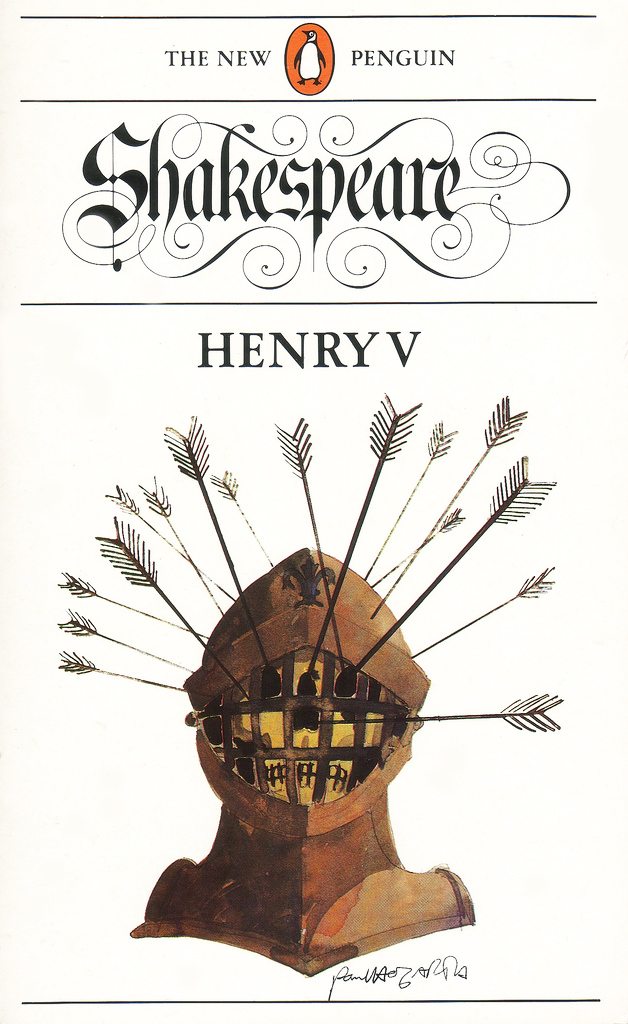




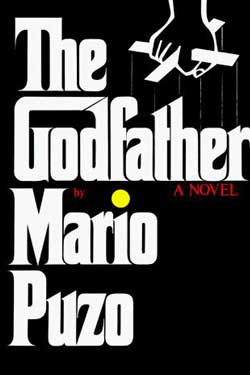

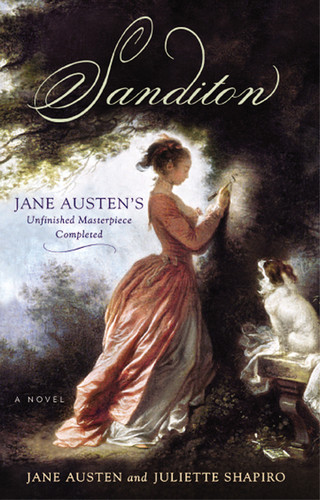

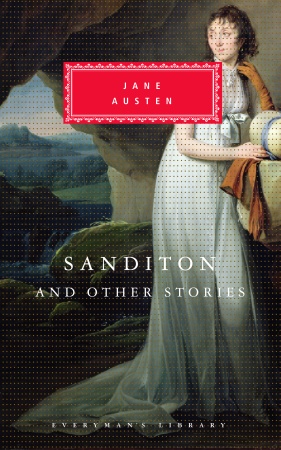
![[01-10-10] Ububeïb](http://lebancdesgueux.free.fr/wp-content/uploads/01-10-10-Ububeïb.jpg)


