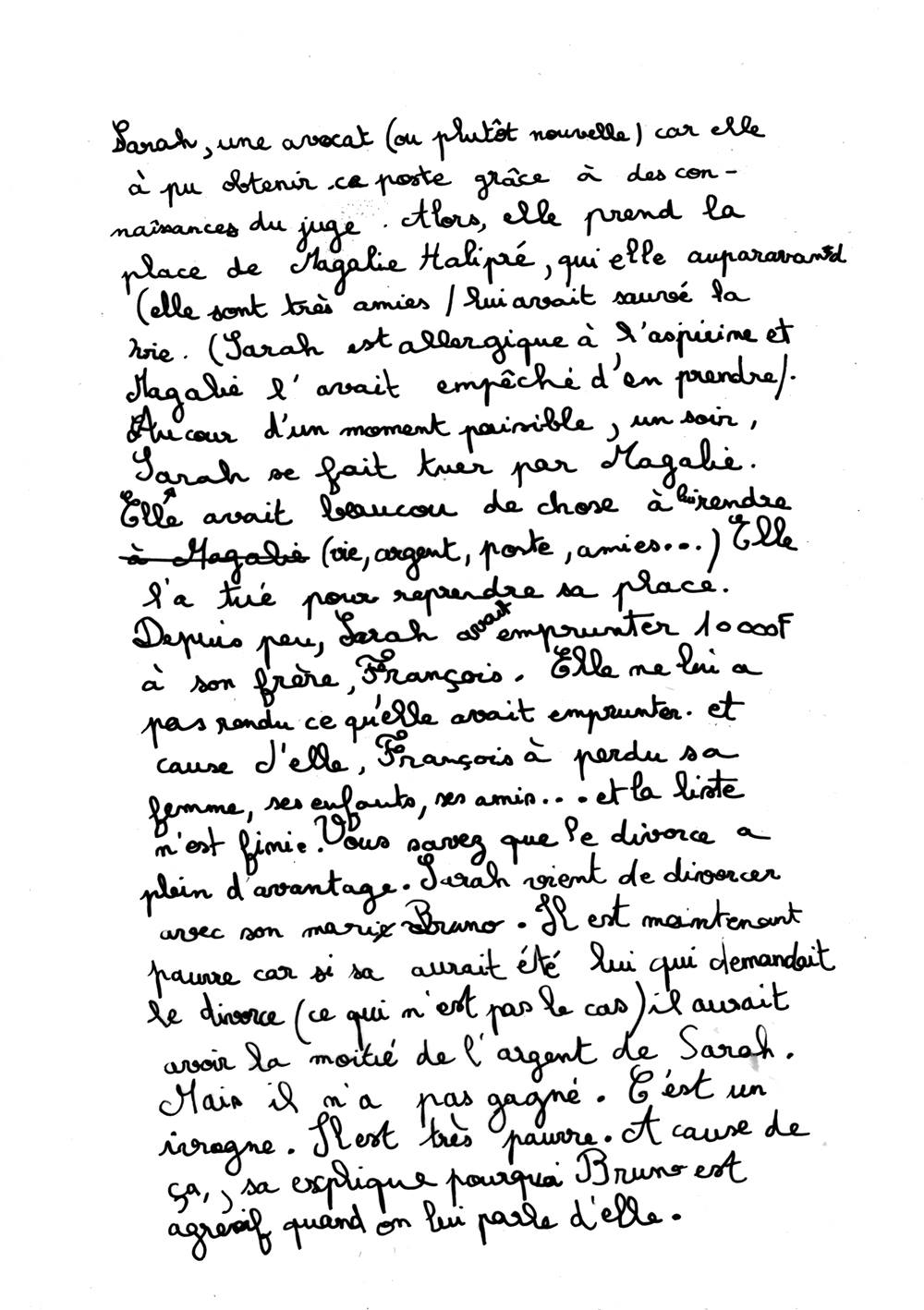Brèves d’images qui bougent 4/4
See, Sept and Son : sons en images
Chef d’orchestre de la musique sur écran d’âge adulte, Michel Chion avait trouvé un élégant sobriquet pour qualifier son outil de travail : la musique était une planche pourrie.
N’allez pas croire que Michel Chion aimait à terroriser les oreillons de ses lecteurs en violentant son sujet bien aimé. Mais Michel avait ses raisons pour tailler dans le gras : en tant que théoricien de comptoir cossu, il criait dans tous les mégaphones que la bande-son sortait du cadre cinématographique et que la place sonore qu’on lui allouait n’était qu’un geste charitable de gracieux connoisseurs visant à embobiner les estropiés. La bande-son, c’était du pipo ; la musique, une virgule travestie en accent ; et la parole un trou dans l’air. Michel acquiesçait et se dissolvait à mesure qu’il s’interrogeait sur ce public ingrat, étourdi ou outrecuidant, qui perdait le goût du bruit, coutumier d’une pléthore sonore empoisonnante.
L’idéal, compagnons, serait de donner tort à Michel Chion : de se rendre vers des paysages filmés, d’y faire halte les pores vagabonds ; puis d’y tendre la vue et d’ouvrir l’ouïe.
Buena Vista Social Club, de Wim Wenders
Ry Cooder a composé la musique de Paris Texas et de The End of Violence. Au cours du travail sur ce dernier film, il parlait souvent avec enthousiasme à Wim Wenders de son voyage à Cuba et du disque qu’il y avait enregistré avec de vieux musiciens cubains. Le disque, sorti sous le nom de « Buena Vista Social Club », fut un succès international. Au printemps 1998, Ry Cooder retourne à Cuba pour y enregistrer un disque avec Ibrahim Ferrer et tous les musiciens qui avaient participe au premier album. Cette fois, Wim Wenders était du voyage avec une petite équipe de tournage.
Plonger dans l’ambiance de Buena Vista Social Club, c’est se lancer dans l’exploration des bas-fonds cubains regorgeant de spécimens rares et solides de la musique latine. Les percussions, les trompettes, le piano s’allient pour livrer l’expression de corps à vif, des paternels dont l’âge n’a pas de prix tant la vigueur, la sérénité et l’humilité traversent les lieux et les images. Entre concerts uniques et un retour aux rues pour escorter des hommes qui ont survécu aux péripéties de leur musique populaire, entre leurs traces suivies avec une fluidité et une simplicité teintée de nostalgie, ses habitants s’en démarquent par des accents virevoltant du plaisir de vivre, d’une vivacité mortellement contagieuse. Nos nuques s’échinent vainement contre ces frissons que nous donne l’alliance des visages et des douces sonorités dont accouchent ces enfants sages. Les faciès arborent les traces des paroles si particulières, si simplement poétiques, exactes répliques de leurs pères. La complicité entre chaque joueur et son instrument demeure stupéfiante, de même que la virtuosité jaillissant de leurs gestes : c’est tout comme aspirer une bouffée chargée de couleurs.
The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman
Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences.
Minuit de chasseurs, des diables paraissent dansant sous l’emprise d’un transsexuel transylvanien, fou d’un libertinage de rites et de ton. Bienvenue dans l’univers phantasmeur de The Rocky Horror Picture Show !
Il est des films qui ont fait de la parodie une authentique machine à produire du culte. De clins d’œil de cinéphiles en regards en coin filant la parfaite folie, un scientifique racoleur accouche en couleurs d’un éphèbe. Mais tout Pygmalion original qu’il soit, ses créations sont vouées à se lasser de ses faveurs pour se targuer de sommets plus enivrants aux relents de leur architecte : l’indépendance. Le sympathique puritanisme incarné par un couple d’ingénus lâche prise pour s’attacher aux libres parties de plaisir que plébiscitent les accrocs au dévergondage peuplant la demeure.
The Rocky donne à goûter un tourbillon d’icônes en images, d’airs qui déménagent : c’est un carnaval de saintes qui y touchent. Démarrage en trombe sur la piste aux bizarreries, acrobaties burlesques sur des bosses gothiques ; et un fabuleux pitre transformiste donnant une fête foutraque à la fin fumeuse.
Dancer in The Dark, de Lars Von Trier
Selma Jezkova, émigrée tchèque et mère célibataire, travaille dans une usine de l’Amérique profonde. Elle trouve son salut dans sa passion pour la musique, spécialement les chansons et les danses des grandes comédies musicales hollywoodiennes. Selma garde un lourd secret : elle perd la vue et son fils Gene connaîtra le même sort sauf si elle réussit à mettre assez d’argent de côté pour lui payer une opération.
La caméra infrarouge de Selma se débat pour capter les mouvements d’un monde qui se meut dans son dos. Selma pressent plus qu’elle ne voit, au travers d’un globe oculaire poissonneux, de couleurs ternes, cernées par des solitaires qui s’épaulent. Et soudain, la voilà, la voici fécondant des bonds, tandis qu’elle a tant de mal à se traîner le long des sentiers, à longer les rails sans vaciller. A mesure que sa vision s’amoindrit, chaque son s’insinue en elle, chaque chuchotement son show, jusqu’à ne dépendre plus que de bouffées d’air libre, puis que de son pouls paniqué. Elle apprivoise les sons du monde environnant pour façonner sa citadelle enivrante. Entre l’usine et la caravane, les rêves sauvent ; entre les couleurs et l’obscurité totale, les rêves prévalent ; entre l’affolement et la fin, le rêve perce puis s’éteint…
Selma est une évadée follement belle, une héroïne tragique à la sensibilité touchante, à la fois têtue et naïve, crue dans son appareil, qui perd la tête sans spiritueux : mais quand un rythme démarre, la fête s’empare de son être.
Le sort frappe, la voix déraille : et le cœur fait une embardée en apesanteur.
Simplement extatique.
Gimmie Shelter, de David et Albert Maysles
Le samedi 6 décembre 1969, dans l’autodrome d’Altamont, en Californie près de San Francisco, 300 000 personnes assistent à un concert gratuit des Rolling Stones. Ce spectacle marque leur retour après trois ans d’absence et clôt une tournée dans les plus grandes villes américaines. Les Hell’s Angels de Californie se chargent de la sécurité tandis que l’on filme le show, qui sera réalisé comme une grande émission de télévision en direct. Très vite, la musique fait place à l’hystérie.
Dans la toile du groupe réputé, la gloire escalade et dégringole des sommets, suivant les aléas acculés d’une existence irréelle. Dans Gimmie Shelter, les frères Maysles tissent un monde effiloché : celui d’un quotidien déconnecté, de musiciens à l’ouest, d’une musique psychédélique pour un auditoire lénifié. Il annonce la fin d’un règne où sujets et souverains ne connaissent plus ni leur place, ni leurs offices, et se laissent dériver aux limites de la conscience. Par l’effet du cinéma direct – utopie graineuse, nous voici cheminant sur les traces des Rolling Stones dressant leur concert gratuit à Altamont ; en parallèle, le film constate les réactions des membres suite à la diffusion des images. Constat de choc : leur légendaire légèreté est spectaculaire. Mais la génération de l’euphorie est révolue, l’espoir est en train de mourir.
Le groupe passif aime en vain de chansons venimeuses qui mènent à l’apothéose. Les Stones envoûtent jusqu’aux obstacles qui s’écroulent les uns après les autres : la machine est en marche pour le désastre. Après la pluie d’amour, acides violence et dérèglements s’abattent comme un voile.
C’est la musique qui semble avoir porté le coup.
Prolonger le plaisir audiovisuel : Tommy de Ken Russel (1975), La leçon de piano de Jane Campion (1993), Reefer Madness de Andy Fickman (2006).
Brèves précédentes :
Brèves d’images qui bougent #1
Brèves d’images qui bougent #2
Brèves d’images qui bougent #3
Extrait du fanzine InK #4 (hors-série Musical), composé & imprimé en 2008, dépôt légal Juin 2008. Pour la rabâche ultra vitale de cacahuètes : InK Le Musical est un (gentil) fanzaïne appartenant à ses sociopathes créatrices : Alivia, Cira, Pierre, Pomme et Winona, et investisseurs intergalactiques.
Dans le cadre d’une opération de grande envergure de numérisation du fonds InK (également intitulée « Temple funéraire »), feu les fanzaïnes de commerce pas équitable seront bientôt disponibles en consule-taie-shion aunelaïne.
Brèves d’images qui bougent 3/4
Si c’est infâme : filmer la guerre
Quoi de plus délectable qu’un crêpage de chignons au marché ou qu’un match de boxe sur un ring ? Parlons tiens, du feu belliqueux : les hommes se battent d’eux, armés d’osselets, de poêles ou de détonateurs depuis les premiers temps du redressement de sa colonne. De l’univers même dont nous sommes tirés, la création s’est avancée dans un chambardement d’atmosphère chargée. La fusion de contraires qui s’attirent : on a souvent avancé que haine et amour se mordaient la queue, et le mot ébat en serait quelque trace probante.
Mais la haine n’a pas été de tous les fronts ; la vilénie et sa palette d’adjuvants seraient plus habiles à auditionner. Ce que le cœur frondeur lui entraîne contre le trône altier de l’humanité est bien plus clair : bienvenue fougueuse Destruction. Te revoici Barbarie ? Tu me fais frissonner d’une anti-nostalgie venue de mes livres du révolu. Oh ! Voici le ballet de Pauvreté, elle est reine dans les taudis, la guerre elle s’en repaît et elle danse pour les autres.
Les autres derrière les rideaux de la paix.
Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.
Psychédélique. Foudroyant. Et à titre personnel : terriblement sensuel…
Ces lumières infernales qui valdinguent font l’effet d’un boomerang qui ne laisserait nul répit. On surfe sur la vague des occupés, on leur troue la terre sous les pieds en entonnant de classiques valses, on se terre dans ses pensées et on s’effraie de ses proches qui prêchent la mort.
Clarté solaire, lueur des torches, éclat de la terre argileuse. Tenter de deviner des hommes qui se mottent et se couvrent des ombres. Se rassasier de découpages et de profils partiels. Observer Le visage impassible du chasseur devenir celui d’une bête traquée. Quand les autres basculent peu à peu au creux du sein brûlant de la folie, même l’homme le plus tenace doit se retirer dans le silence pour ne pas être tenté de répliquer à ce qu’il ne saisit pas et d’être à son tour happé par cette construction microcosmique et démente au milieu de la jungle, ce lieu où siège un demi-dieu qui n’est qu’un homme essoré, résigné à sa fin. Un retour au primitif, aux origines, réapprendre à se nourrir et à boire, voir d’un œil autre, contempler, étudier, sentir… Le film se fait alors semblable à un exercice visuel de capoeira.
Nuit et Brouillard, de Alain Resnais
1955 : Alain Resnais, à la demande du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, se rend sur les lieux où des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont perdu la vie. Il s’agit d’Orianenbourg, Auschwitz, Dachau, Ravensbruck, Belsen, Neuengamme, Struthof. Avec Jean Cayrol et l’aide de documents d’archives, il retrace le lent calvaire des déportés.
« La guerre s’est assoupie, un œil toujours ouvert. » Alain Resnais alterne entre images d’archives et lente progression entre les vestiges des camps. Entre barbarie et ironique paysage calme et tranquille. Quelle réalité ont pour nous ces lieux imperturbables où des touristes se font photographier le plus sereinement du monde ? Si l’herbe a poussé, si les pierres se sont effritées, si le bois s’est détérioré, ce n’est qu’à l’image de notre esprit que rafraîchit d’une douche glacée cette excursion dans le passé. Ce sont bien les images du présent qui invoquent ces vies décharnées dans la mort. Le brouillard n’est plus que notre propre aveuglement qu’il nous appartient d’estomper. D’une voix sentencieuse, à l’ironie mordante et à la poésie chèrement révoltée, c’est une immersion intemporelle et un conseil que prodigue l’auteur : ne jamais s’apaiser l’âme quand les souvenirs sont une alerte au paysage d’aujourd’hui.
Un héros très discret, de Jacques Audiard
Dans l’époque trouble et confuse de l’hiver 1944-1945, à Paris, un homme qui n’a pas participé à la guerre va se faire passer pour un héros en s’inventant une vie admirable. A force de mensonge, il va construire par omissions et allusions un personnage hors du commun.
Dès les premières notes, le rythme est livré : c’est dans la peau de cet ordinaire personnage à la poursuite de reconnaissance qu’il va falloir se mettre. Ce n’est pas tellement la gloire vers laquelle tend Albert, c’est briller, c’est se trouver là où les autres furent et d’où ils tirent leur droit d’être à présent. Un anti-héros au plomb angélique, un rêveur zélé qui ne réalise l’ampleur de ses tours qu’une fois confronté au caillou coincé dans le mécanisme. Sans prêchi-prêcha sur le sujet rôdé des résistants de la dernière heure, c’est la chronique d’un garçon perdu dans la peau d’un usurpateur, qui saisit la guerre comme une chance d’exister. Qui ment par pratique, dont les fables sont apprises comme des théorèmes de géométrie. Une quasi-candeur qui le fait devenir la proie de ses propres inventions… Riant, bondissant, et frémissant, sillonnant périlleusement parmi ses succions d’histoires, c’est charmés qu’il nous vampirise à notre tour.
Docteur Folamour, de Stanley Kubrick
Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé d’empoisonner l’eau potable des États-Unis, lance sur l’URSS une offensive de bombardiers B-52 en ayant pris soin d’isoler la base aérienne de Burpelson du reste du monde. Pendant ce temps, Muffley, le Président des Etats-Unis, convoque l’état-major militaire dans la salle d’opérations du Pentagone et tente de rétablir la situation.
Balançant entre film noir, satire et critique des pendants belliqueux, Docteur Folamour est un film trop excentrique pour intégrer le moule des catégories communes. Tout du long de la projection, il déploie ce savoir faire rire sans pouvoir nous ôter de l’esprit les images si sérieuses, parfois froides et austères, de la guerre. Cadre et dialogues concourent au constant décalage, un contraste donnant naissance à une tonalité sacrément grotesque.
Parmi les relents de terrifiant docteur nazi expérimentaliste, militaires qui chiquent et dirigeants aisément manipulables, il faut concéder un chapeau à pois pour le superbe tercet de Peter Sellers, en homme de science dément qui a poussé le vice expérimental jusqu’à trafiquer son propre corps qui lui joue des tours ; en capitaine décalé, dandy et couard, ou bien en président qui se souhaite confiant quand un simple coup de fil suffit à le déstabiliser comme un enfant. Parfois aux allures de documentaire, souvent aux airs de conversation de bistrot, parsemé d’allusions piquantes et de répliques qui font mouche, voilà de quoi piaffer comme une fougueuse jument de la paranoïa et de l’immaturité de nos dirigeants, tout en s’en alarmant rondement.
Brèves précédentes et suivantes :
Brèves d’images qui bougent #1
Brèves d’images qui bougent #2
Brèves d’images qui bougent #4
Extrait du fanzine InK #3, composé & imprimé en 2008, dépôt légal Juin 2008. Comme le dit son Nounours (appellation peu affriolante et comblage d’un trou) : InK est un (gentil) fanzaïne appartenant à ses sociopathes créatrices : Alivia, Pierre, Pomme et Winona.
Dans le cadre d’une opération de grande envergure de numérisation du fonds InK (également intitulée « Temple funéraire »), feu les fanzaïnes de commerce pas équitable seront bientôt disponibles en consule-taie-shion aunelaïne.
Danser de son saoul
La danseuse d’Izu, c’est une histoire de contagion.
J’ai personnellement toujours éprouvé des difficultés pour porter un jugement quel qu’il soit sur la littérature japonaise : c’est en immense partie dû à cette habitude culturelle de la simplicité. L’art japonais est historiquement très épuré : certes, tout son art ne peut être arrêté à une telle déclaration, les occidentaux ont eux aussi connus leur époque de décantation. Mais de manière commune, l’anodin, le calme plat et les teintes primaires sont hautement beaux.
L’exemple en est le haïku, forme lapidaire que j’affectionne et qui porte sur la nature concrète des choses qui nous entourent quotidiennement : ces choses qui nous accompagnent en deçà de l’attention qu’on leur porte. Difficile d’appréhender la forme littéraire d’un « ploc dans l’eau » et tenter de cerner la littérature japonaise s’apparente alors à un parcours semé de coquilles d’œufs frais.
La danseuse d’Izu est donc un recueil de cinq nouvelles, aux tons foncièrement différents, aux thèmes dissemblables hantés par des rêves pareils ; la première nouvelle éponyme nous place en porte-à-faux, forcés de reconnaître que l’on n’a peu idée de quel pouvoir les mots sont exactement porteurs. A la fois anecdotique et pleine de sagesse, la rumeur la présentait comme un classique des manuels japonais…
Pourtant, la seconde, personnellement mon coup d’étreinte, démontre déjà comment l’auteur va se montrer sous tous les yeux du jour existants, comme il jongle de sa plume, de sa machine à écrire et de son stylo. Comme il troque des récits bucoliques contre des pensées mortuaires, ou des anecdotes de passeurs. Comme il sait endosser un simple lycéen sans envergure notable, et une femme passionnelle forte de ses connaissances de doctrines étrangères.
Bref, un écrivain à découvrir pour sa variété simplement complexe.
La danseuse d’Izu
Cette première nouvelle qui offre son titre au recueil, conte une étape de voyage d’un étudiant ayant fait la rencontre fortuite de forains et s’étant épris d’une danseuse.
Rien d’autre que le récit d’un moment dépensé à l’unisson, de liens amicaux lentement tissés, de conventions (différence de castes, jeunesse de la danseuse, déférence envers l’avant génération, frontière entre les sexes) entravant les désirs d’un jeune homme perdu, retrouvant ses repères au contact de gens simples.
La narration à la première personne , aisément perturbatrice par le fait qu’elle s’en tienne au point de vue du lycéen, a de ça de bon qu’elle ne dévoile en rien les pensées de personnages environnants, mais leurs comportements, saisissables de par son intervention narrative.
Comme une suspension, seules des précisions géographiques sont livrées au lecteur (île et environs d’Izu, où séjourna l’auteur durant sa rédaction) : l’île elle-même représente cet isolement temporaire car le récit s’achève en mer, sur un départ. Difficile de retrouver l’époque exacte, où les costumes (kimonos, getas, fard, coiffure de lycéen) et les coutumes nous tromperaient aisément sans furtive allusion à des véhicules, ou au cinématographe.
Jamais de descriptions détaillées, excepté le semblant d’âge et leurs attributs (une lourde chevelure, un air serein), comme si chaque personnage était une figure potentielle dans lesquelles tout un chacun serait en droit de se mirer.
Elégie
Rien ne pourrait plus opposer ces deux extractions : sans perdre de la pudeur de son style, le personnage réservé s’éclipse pour laisser la narration à une femme transportée, à l’intelligence tourbillonnante, croyante de ses propres croyances, c’est-à-dire de la suprématie de certaines sur d’autres en ce qui concerne la relation des vivants et des morts. Allusions à diverses croyances : bouddhiques, chrétiennes, confucéennes, égyptiennes, grecques…
Prétextant la mort d’un amour, la narratrice offre au lecteur un exposé sur l’état de mort et la vanité de l’être humain qui cherche à la cerner. D’une fougue presque moqueuse et parfois sèche, cette femme esseulée prend tout de même parti pour la liberté qu’offrent certaines doctrines (le bouddhisme ou l’aspect protéiforme du polythéisme grecque) face à d’autres bien plus hermétiques (chrétienté) et trop humanisées pour l’homme. Echangeant tirades funèbres et brefs mots adressés au disparu sur leur vie passée, aucun répit n’est laissé au lecteur avant la conclusion du récit, revenant à ses lignes liminaires.
L’imagination vole si haut qu’il m’a fallu vérifier le sexe de l’écrivain tant l’illusion de la voix était trompeuse.
Bestiaire
Voilà un récit atypique concentré sur la faune et en particulier sur les volatiles. Après avoir dépensé une vingtaine de pages précédemment à railler cette médiocre habitude de séparer les règnes et particulièrement dans l’absolu de la mort, Bestiaire prend pour figure centrale une sorte de misanthrope vouant son existence à l’élevage d’oiseaux.
Distillant à touches légères des détails de sa vie passée, n’ayant rien à voir avec son isolement présent, cet homme ne peut souffrir la présence des humains. Seule l’assemblée des bêtes le distrait, effaçant jusqu’à la conversation de ses rares interlocuteurs.
« Vivre avec les animaux, c’est aimer seul, dans un libre orgueil ». Et de fait, cette solitude l’éloigne de toute confrontation sociale et le place en sa vie comme unique représentant de son espèce, et lui assure par là une certaine suprématie sur celle qu’il dit considérer comme différente, mais égale.
Sur le chemin d’une représentation de danse, unique démonstration mondaine dont il s’autorise la visite, le heurt d’un convoi funèbre l’amène à se souvenir de tous les êtres passés entre ses jours, et souvent trépassés entre ses mains. C’est l’occasion de se rendre compte que progressivement, le traitement de ses bêtes revêtira celui effectif entre humains, puis que la vie perdra de son sens et de son importance ; leur maître ne s’attachant qu’à l’éphémère distraction qu’ils peuvent lui procurer, fusse-en leur prodiguant des soins.
Il est bon de voir l’auteur amarrer son lecteur au sein de descriptions concrètes et d’une connaissance élargie sur la faune, après un récit à la dimension métaphysique.
Retrouvailles
Après la défaite japonaise, un homme, Yuzo, retrouve par hasard lors d’un rassemblement entre soldats japonais et américains, une courtisane qu’il entretint avant la guerre. La nouvelle retrace leur cheminement du temple des retrouvailles jusqu’à un logis, et donne à découvrir un panorama de l’après-guerre. Car sur leur trajet, blessés, dégâts matériels et paysage ravagé sont compagnons de voyage, auxquels viennent s’ajouter les considérations et remarques de Yuzo, ainsi que les souvenirs épars de Fujiko. En une vingtaine de pages, est offerte au lecteur une vision de ce qu’étaient les personnages avant la guerre, et ce qu’ils sont à présent ; ce que leur relation représentait autrefois, ce qu’elle n’est plus aujourd’hui.
L’homme, taciturne et sévère, laisse entrevoir une mince faiblesse envers cette femme fantôme, et ce malgré l’exaspération qu’elle occasionne chez lui. Dû à cette irrémédiable nostalgie provoquée par ces retrouvailles et auxquelles il est aisé de se laisser couler, particulièrement après une époque de troubles, comme une guerre dévastatrice. Personnages réalistes composés d’une ancienne courtisane émue et désemparée, en repentir et refusant de laisser s’envoler cette rencontre de bonne fortune qui pourrait la sauver des griffes de la misère ; et de cet homme indifférent et tout de même rattaché à la chair d’une ancienne amante dont il ne souhaite pourtant pas subir le poids au quotidien. Des personnages passant difficilement à autre chose qui se réfugient dans le passé face à un présent incertain, et qui divergent réellement de ceux mis en acte dans les précédentes nouvelles.
La lune dans l’eau
Titre bien mystérieux pour cette nouvelle, probablement en référence au reflet de la lune dans l’eau reflété dans un miroir dont dispose un homme malade.
Au Japon, le miroir a une très longue histoire : « le jeu des miroirs parallèles de la femme à la toilette », comme l’indique l’écrivain lui-même, ce qui se constituait d’un lever de glace derrière sa nuque et représenté dans de nombreuses estampes comme un comble de séduction. La nouvelle retrace l’ouverture oculaire d’un couple forcé de contempler le monde en passant par la porte d’un miroir, et redécouvre ainsi ses différents échelons, en apprenant à préférer leur propre interprétation du reflet des choses qui leur est renvoyé.
Ref :
AL, 2007. La danseuse d’Izu. Inktime. From http://inktime.free.fr
Ref :
AL, 24-07-06. A dada sur mon bidet. Le goût du thé refroidi dans la fusée flamboyante de l’après-midi. From
Brèves d’images qui bougent 2/4
Sur les histoires sans issue
Pourquoi regardons-nous des films d’amour ?
Pas bête la guêpe qui n’ira pas fourrer ses antennes dans des considérations si emmielées.
Pour tenter de se donner réplique, il faudrait venir fureter du côté des sensations procurées par le visionnage d’un film d’ivresse.
Car depuis 110 ans que le cinéma existe et qu’il y a des hommes pour l’habiter, l’amour n’est jamais tombé de ses nues. Arboré, exhibé ou soufflé des plus belles manières comme lors des censures du Code Hays où les réalisateurs brimés, se sont surpassés à raconter des passions dans une retenue feinte (plus tard, les chevilles de Catherine Deneuve très évocatrices).
Très vulgairement, il faudrait s’emparer de l’aspect dépaysant de nombre de contes d’amour, quand certains ne recherchent qu’un récit au plus voisin de leur réalité, et les autres des présences phantasmées envahissant le film comme par sorcellerie, des situations idéales et ardentes qu’on se projette profusément dans la salle crânienne.
Et ces histoires, souvent nous acheminent au transport de l’âme : nous éclatons de larmes, de rires, nous grelottons plus en une heure et demi sur la chronique étrangère de deux (voire plus, selon les mœurs) inconnus, qu’en un mois sur notre propre couple. L’on rapporte que l’acteur fait rêver parfois plus que la main qu’on tient. Sans sécher le baiser du cinéma, réinventé mille fois, légende milliardaire.
L’art cinématographique d’il bacio.
Mais qu’ont les histoires impossibles de plus que les histoires sentimentales ordinaires ?
Elles sont souvent plus furieuses, cause du nœud prédéfini de leur situation, plus tragiques et intensives ; elles satisfont notre tendance à réclamer nos hypersécrétions et nos coulées de roupie.
Mais surtout, elles sont pleines à craquer les coutures de ce mot tabou, cette chose écoeurante et impure que la moitié des mortels poursuivent et que l’autre moitié feint de fuir furieusement :
Le romantisme.
Edward aux mains d’argent, de Tim Burton
Edward Scissorhands n’est pas un garcon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un coeur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu terminer son oeuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.
L’histoire d’une créature montée de toute pièce, aux cheveux hirsutes, au teint blafard et aux mains déchirantes.
Sur le modèle d’un conte de Grimm, une grand-mère entreprend le récit pressé par une fille petite incapable de s’évanouir au sommeil.
Le conte sombre et coloré d’un frankenstein moderne et édulcoré : un hymne à la différence qui flirte au chant contre le conformisme d’une société, et papillonne aux instruments pour un amour sans issue.
Interprété par un Johnny Depp donnant cœur au personnage peu prolixe et un peu raide avec un brio peu comparable ; orchestré avec délicates fantaisie et poésie, composition aux accords de magie pour un univers aux contours réalistes.
Un coup génial.
Orphée, de Jean Cocteau
L’histoire a traversé les siècles… Orphée a perdu Eurydice, mordue par un serpent. Pour la ramener sur terre, il n’hésite pas à affronter tous les périls de l’enfer. Une seule condition : lors de cette lente remontée vers le monde des vivants, il ne doit pas se retourner, ni regarder la bien-aimée. Hélas ! Cocteau relance le mythe. Parmi ses personnages, quel est le plus envoûtant ? Cet Orphée, amoureux de sa mort qui va et qui vient à travers les miroirs ? La princesse qui transgresse les lois de l’au-delà pour l’amour du poète ? Heurtebise, le messager, qui apparaît et disparaît à volonté ? Eurydice ? L’Intouchable, l’Invisible, l’Ombre ? Dans un décor surréaliste où les vivants et les morts se côtoient, le film de Cocteau prolonge encore le mystère…
Cocteau a beaucoup pratiqué la magie, celle de la poésie. Orphée, ou l’une des nombreuses apogées de son œuvre. Comme certaines histoires qu’il a remaniées, Cocteau s’attèle à donner une histoire aux histoires : ainsi, avant de perdre son Eurydice, Orphée se voit remettre en question sa vocation.
Mais quelle magie ?
Magie visuelle avant tout : Cocteau n’a pas déçu les pionniers du cinéma (Méliès que nous évoquions précédemment) avec les tours de passe-passe et les effets spéciaux presque indétectables. En 1950, des hommes peuvent déjà traverser des miroirs, remonter le temps et disparaître. La matière filmique est tâtée en profondeurs : les décors désertiques de l’entre-deux-guerres sont scrutés par la lanterne du réalisateur qui reconstruit le monde à forces d’ombres et de lumière. Les visages sont taillés dans la pénombre et rien jamais n’est hasardeux.
Les dialogues, dignes de l’un de ses ouvrages littéraires (pensez La machine infernale, adaptant le mythe d’Œdipe) sont si affûtés qu’il faudrait constamment se pauser pour en décortiquer les syllabes.
Les acteurs splendides : on retiendra éternellement la douloureuse Maria Casarès en mort moderne qui se radie par amour.
Après une contemplation de l’escale orphique dans les allées contemporaines, Cocteau apparaît comme boussole de l’indicible : comme un voyant.
Brockeback Mountain, de Ang Lee
Eté 1963, Wyoming.
Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un troupeau de moutons à Brokeback Mountain.
Isolés au milieu d’une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu’inattendue.
A la fin de la saison de transhumance, les deux hommes doivent se séparer. Ennis se marie avec sa fiancée, Alma, tandis que Jack épouse Lureen. Quand ils se revoient quatre ans plus tard, un seul regard suffit pour raviver l’amour né à Brokeback Mountain. Qu’est-ce qui est secret à Brockeback Mountain ?
A coup dur et certain, le processus de gonflement d’une glotte, l’engorgement salivaire, le provocateur des pulsations, l’étonnant Ang Lee faiseur d’un film à son image. Tout est pur. De longs panoramiques sur un panorama capté au plus grand soin. Dans des teintes claires, dans des tons pâles, dans les sillons de pâturage, deux hommes partagent un amour. Tout est calme : tout est consumant. Pour eux, dévorés par la montagne, d’abord instigatrice de leur combinaison, par cette nature se glissant entremetteuse d’un amour si lourd.
Le premier, Jack, fougueux et volontaire ; le second, Ennis, taciturne et pesneux dans cette amérique profondément éloignée des années soixante-dix, des années deux-mille-dix. Des cœurs en particules ébouillantées, des entrailles charbonneuses, des va-et-vient freinés, une cadence cardiaque effrénée.
Plans d’ensemble qui se resserent sur un profil figé, une nuque qui se brise et des vies tourmentées.
Servie par des acteurs saisissants, Heath Leager et Michelle Williams en tête de file, une merveille de poignance, une photographie composée brillamment, des notes frémissantes et un renouveau du western.
Les brèves précédentes et suivantes :
Brèves d’images qui bougent #1
Brèves d’images qui bougent #3
Brèves d’images qui bougent #4
Extrait du fanzine InK #2, composé & imprimé en 2006, dépôt légal Novembre 2006. Comme le dit son Nounours (appellation peu affriolante et comblage d’un trou) : InK est un (gentil) fanzaïne appartenant à ses sociopathes créatrices : Alivia, Paul, Pomme et Yoli.
Dans le cadre d’une opération de grande envergure de numérisation du fonds InK (également intitulée « Temple funéraire »), feu les fanzaïnes de commerce pas équitable seront bientôt disponibles en consule-taie-shion aunelaïne.
Brèves d’images qui bougent 1/4
Le cinéma asiatique (et pas que)
Aux premières heures, c’étaient les augustes frères Lumière : des vues de cinématographe qui en 1895, chamboulent leur monde. Qui peut vraisemblablement se représenter la fureur des spectateurs de ces sorties d’usine et autres arrivées de locomotive, sobrement accompagnées de piano ? Pour l’heure, des éclats de réalité en noir et blanc, tressautant, durée : une minute et pianotés, ce n’est décidément plus envisageable.
Pas plus que le formidable art de Méliès, le magicien incroyable qui employa des acteurs pour la première fois et mis en scène ses « vues ». Des trucages, des effets spéciaux, de la couleur (imaginez un homme peignant sa pellicule sur des mètres et des mètres), des décors extraordinaires, autant d’éléments fondateurs de notre cinéma contemporain.
Mais est-ce bien l’utilité de cette modeste rubrique de retracer le chemin cinématographique de notre époque ? Certes non, exercice trop périlleux et point optique si pauvre que les miettes restantes de vérité seraient indigestes.
Ici donc, quelques coups d’organe cardiaque (bom bom) : films datant, entrant et sortant, diverses brèves que voici pour vous communiquer l’enthousiasme de leurs spectateurs.
À noter : l’hommage à Kim Ki-Duk, cinéaste coréen de renom international dont les films marquants sont à l’honneur ce fanzaïne-ci. Bonne lecture !
Eurêka, de Aoyama Shinji
À Kyushu, au sud-ouest de l’archipel japonais, un matin de chaleur estivale… une sanglante prise d’otages dans un bus municipal épargne le chauffeur, Makoto, une écolière, Kozue, et son frère aîné, Naoki. Traumatisé, Makoto disparaît. Les deux enfants s’enferment dans le silence.
J’ai trouvé ! s’était écrié Archimède dans son bain. Pourtant, ici nul cri, pas de trouvaille, aucune découverte autre que celle de nos penchants les plus sordides, les plus pitoyables… Et un désir violent de rémission. Mais pourquoi ?
« Un raz de marée va venir, bientôt, j’en suis sûre, tout le monde mourra » : ainsi Kozue inaugure-t-elle le film par une période sentencieuse qu’on oublie bien trop vite… Un matin, un bus, deux enfants, un chauffeur et d’autres passagers : une prise d’otage sanglante, la mort des passagers, la survie de trois individus.
Tourné en noir et blanc versant dans le sépia, le film s’écoule lentement : un voyage de près de 3h30 au noyau dur du psychique. Qu’est-ce qui a été endommagé ? Comment le restaurer ? Cloîtrés dans le mutisme, les enfants errent et sont trouvés : Makoto, le chauffeur dont la fuite se mue en altruisme et Akihiko, le cousin empli du désir de protéger ces oisillons emmaillotés de leur torpeur. Oisillons à nos yeux en déroute : loin de là en vérité. En parallèle, d’autres événements : une intrigante série meurtrière de femmes, la remontée en bus, les secrets de chacun… Epopée lentement ascendante de personnages sans repère, un espoir qui renaît. Un moment ficelé finement, un art de filmage où images et sons sont en harmonie et baignent le spectateur d’un ravissement séché.
The Coast Guard, de Kim Ki-Duk
En Corée du Sud, une base militaire sur la côte veille à ce qu’aucun espion de Corée du Nord ne pénètre dans le pays. Pour nombre de militaires présents, cette mission tient plus de la corvée que du sacerdoce. Le soldat Kang, par contre, prend tout cela très à coeur : il ne vit en fait que pour une chose, pouvoir abattre un espion nord-coréen. Un soir, « l’espion » tant attendu semble être enfin là…
Un nouveau Kim Ki-Duk qui dessine le long cheminement de la conscience à la folie douce amère.
Le soldat Kang n’aspire qu’à une chose : piéger un ennemi, ceux qui pénètrent en zone interdite, la nuit quand tout parait éteint…Paraître motivant pour un couple de villageois insolents qui viennent baigner la plage de leur amour. Le problème, c’est Kang, obnubilé par la soif d’illustration qui surprend l’amourette et embrasse la gâchette. Un dicton pour la suite : plutôt deux fois qu’une et le soldat n’est pas en état de compter ; la cible croule sous le feu et un jet de grenade, et s’émiette sous les yeux terrifiés de sa fiancée.
L’histoire d’un dérèglement de comptes : on abat son semblable et après ? Le goût du sang est âpre entend-t-on. Cette âpreté-ci est celle d’une vision horrifiante, la vue insoutenable d’écoulement sanguin, flot destiné à nous tenter et nous perdre parce qu’inaccessible à la bouche. On ne peut goûter ce qu’on a abattu, en vain donc et ce tiraillement d’essentiel qu’on nous signifie superflu nous place en exil périphérique, en dehors de l’arène d’un monde déjà suranné destinés à le parcourir en contour, en patrouiller les frontières qui nous demeurent closes.
Descente en démence pour Kang et Mee-Young dont l’amant a été répandu sur le sable : pour cette dernière, le temps s’est arrêté quand la vie continue ; elle le cherche, pense le retrouver et devient peu à peu victime de la concupiscence des militaires. Quand Mee-Young est entrée dans l’eau folle toute entière sans chanter gare, Kang observe l’onde et attaque par le talon. Mais le résultat sera l’idem : ces humains devenus créatures erratiques couleront somme toute sous le poids fol de tous les hommes.
Printemps, été, automne, hiver… et printemps, de Kim Ki-Duk
Un enfant grandit auprès d’un vieux moine. Le rythme des saisons accompagne les cycles de la vie du jeune disciple. Ce dernier connaîtra la perte de l’innocence, la passion qui consume l’esprit et les sens, la jalousie et ses pulsions destructrices, la rédemption et l’expérience, avant de devenir un maître à son tour…
Comment mieux définir ce film, que par ce titre curieux, induisant à la réflexion sur bien d’autres plus insipides (…).
Printemps… c’est tout d’abord un film esthétique : des images à couper les artères, de vastes paysages apaisants, des travelling et des excursions qui nous bercent.
Deux portes s’ouvrent sur un temple, au centre d’un lac, et nous voici projetés dans un lieu qui respire la sérénité éternelle.
On touche, ça y est, on est touché.
C’est du temps qui passe, et qui passe merveilleusement bien.
Une leçon de vie.
The Taste of Tea, de Katsuhito Ishii
Les Haruno sont une étrange famille, unie par de solides liens d’affection. Pas moins de trois générations coexistent dans cette tribu sympathique, heureuse de son sort, qui habite une petite bourgade des environs de Tokyo. Pourtant, ce printemps là, chacun va se trouver confronté à des problèmes inattendus…
The Taste of Tea est pour moi la révélation de l’année. Voilà un film qui vient rappeler par sa simple existence, que le cinéma est bien plus qu’une tradition qui se perpétue.
D’exquis et d’indispensables ingrédients y sont réunis : histoire poignante, conte étrange, émotion, esthétisme, poésie… C’est un savoureux mélange.
Le début est un peu déroutant : voilà que vous débarquez dans la vie de nombre de personnages, et suivez leur quotidien malgré vous. Et force est, le temps de se dérouler comme une précieuse pelote de laine, vous pouvez enfin mettre une histoire sur des traits, des sentiments sur un visage. Vous attrapez la ficelle qui relie tous ces drôles de personnages, qui au final sont tout comme vous : de banals humains, dont vous vous étiez fourvoyiez.
La force de ce film, est de réussir à vous faire éprouver tour à tour, foule de sentiments divers. La gaieté, un peu de peine, la pitié, puis la honte d’avoir ressenti une telle pitié.
J’en entends qui maugréent encore : « hep la loutre, tu passes sous silence le côté bizarroïde de la chose ! »
Une fois entrés dans le contexte du film, vous trouverez cela enchantant (l’envie de chanter) et non plus bizarroïde (comme le train qui traverse le front de l’adolescent, simple matérialisation de ses sentiments, ou le tournesol… non, là je vous laisse la surprise. Personnellement, j’en suis restée clouée, bec dans l’air, les yeux ayant quitté leurs orbites pour s’en aller vers d’autres lieux plus saisissables).
Enfin, si vous ignorez comment l’on fabrique une chanson avec un seul mot (montagne)… si enfant, vous étiez poursuivi par votre ombre géante, si vous courrez après les papillons… si vous n’avez pas perdu vos rêves et s’ils sont égarés, entrez dans ce monde de réalités.
Vous y gagnerez une étonnante sérénité.
Locataires, de Kim Ki-Duk
Tae-suk s’est fait une spécialité du squat des maisons inhabitées, sans jamais rien y voler ni dégrader. C’est ainsi qu’il rencontre Sun-houa, une femme maltraitée par son mari, et l’emmène avec lui. Dès lors, uni par un lien puissant qui semble les confondre, le couple va partager de squat en squat la solitude qui les unit.
J’ouis de vicieuses langues : « encore un film peace & love ! »
Dieuesse, que de perspicacité ! Car c’est tout à fait ce qui caractérise Locataires.
Entre blessure et guérison, il y a un lieu, un temps de pause, où l’on progresse.
Ce temps, c’est Locataires, cette femme meurtrie, et cet homme qui par la magie des gestes, des paroles muettes, des regards si peu inquisiteurs… qui par la douceur, car Locataires c’est doux, même lorsque l’on nous montre la violence.
Et les dialogues ne manquent pas, on est presque à regretter que le mari, cette calamité, soit muni d’une foutue langue, et par-dessus le marché, en fasse usage.
C’est une balle de golfe qui redonne le droit de vivre, et la retire tout aussi bien : un vide comblé creuse un comble.
Et c’est le cœur léger que l’on s’en extrait, et les pieds sur leur pointe pour ne pas briser cet éclat de paix.
Garden State, de Zach Braff
Après 9 ans d’absence, Andrew retourne dans son New Jersey natal pour l’enterrement de sa mère. Il revoit son vieux père, et tous ceux avec qui il a grandi. Sa rencontre avec la jolie Sam va le bouleverser. Vivante et audacieuse, elle est tout son contraire. Entre passé et futur, douleur et joie, Andrew va apprendre à se remettre en question…
J’ai aimé, j’aime, j’aimerai. Espoir, quand tu nous tiens…
Garden State : l’état du jardin. Si ce titre désigne le New Jersey, la région qui a vu naître Zach Braff et le tournage se dérouler, il induit à la réflexion. L’état du jardin…
Et si c’était notre petit coin de vaste vie ? Si, aussi dérisoire qu’elle soit, il fallait l’entretenir ? Sam a beau posséder quantité de hamsters, lorsque l’un d’eux vient de rendre l’âme, c’est une prière, c’est une pensée et des larmes, sincères. Le dernier soubresaut d’une petite créature n’est pas plus dérisoire qu’un échafaudage menaçant de s’effondrer.
Ce film est d’une justesse rafraîchissante, d’une franchise rafraîchissante, de gens rafraîchissants.
Garden State nous rappelle l’espoir : il nous dit le plus simplement du monde, que nous sommes ce que nous sommes, et qu’on fera affaire avec. Car qui vaudra mieux ?
Brèves suivantes :
Brèves d’images qui bougent #2
Brèves d’images qui bougent #3
Brèves d’images qui bougent #4
Extrait du fanzine InK #1, composé & imprimé en 2005, dépôt légal Janvier 2006. Comme le dit son Nounours (appellation peu affriolante et comblage d’un trou) : InK est un (gentil) fanzaïne appartenant à ses sociopathes créatrices : Alivia, Paul, Pomme et Yoli.
Dans le cadre d’une opération de grande envergure de numérisation du fonds InK (également intitulée « Temple funéraire »), feu les fanzaïnes de commerce pas équitable seront bientôt disponibles en consule-taie-shion aunelaïne.
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !