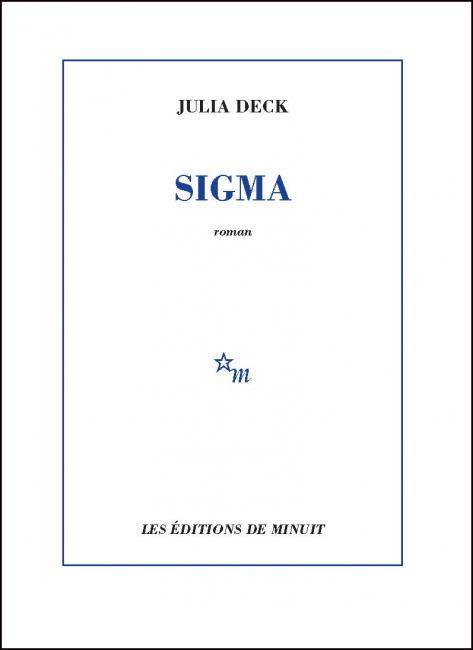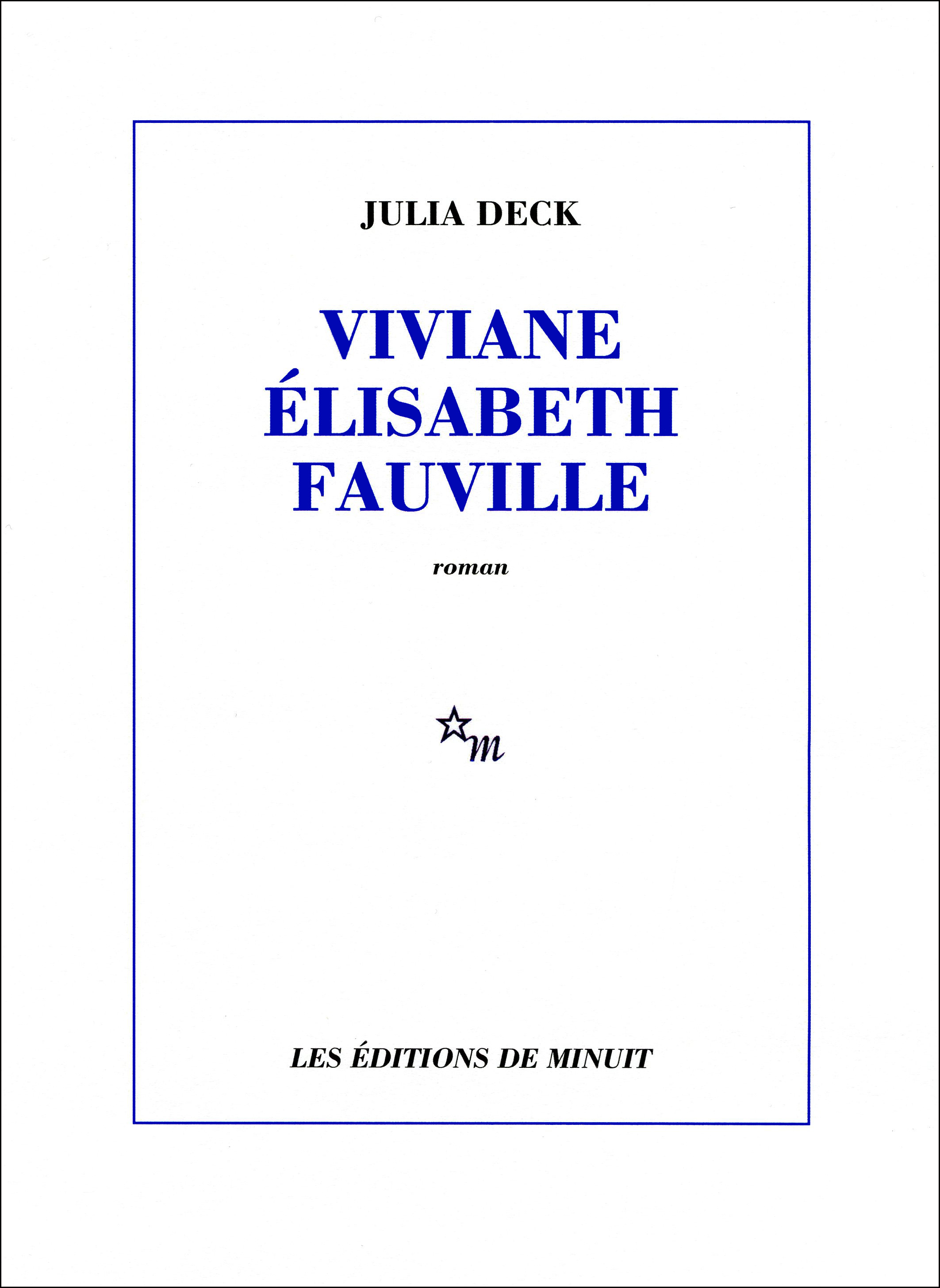Je suis très fan de Julia Deck. Fan du genre à mettre un rappel dans mon calendrier pour la sortie de son nouveau bouquin, et même à obtenir de ma libraire de quartier de me le refourguer la veille au soir, alors que je sais pertinemment que c’est illégal et qu’elle va devoir trouver une combine pour justifier cette sortie.
C’est simple, dès la sortie de son premier roman en 2012, Viviane Élizabeth Fauville, qui récolta une pluie d’éloges et une couverture médiatique d’autant plus efficace que Julia Deck bénéficiait du statut de primo-romancière (une carte joker malheureusement utilisable qu’une seule fois), je me suis sentie conquise. Conquise, prête à suivre cette sympathique auteure pour d’assez longues aventures. Sa lecture m’a procuré un sentiment que je n’avais pas ressenti depuis le lycée, enthousiasme hilare provoqué notamment lors de ma découverte de L’Hygiène de l’assassin. Tout à coup, une voix était née, dont l’impertinence et l’humour résonnèrent durablement en moi.
Amélie Nothomb, comme tant d’autres, j’en suis depuis revenue, semée en chemin après une dizaine d’ouvrages dégustés avec plus ou moins d’enchantement et de désenchantement. Mais Deck n’est pas Nothomb. Pour la quantité, déjà : si l’on a eu le plaisir d’obtenir un second roman deux ans plus tard, Le Triangle d’hiver, il a fallu trois années supplémentaires pour en livrer un troisième, Sigma. De fait, sans vouloir jouer à touche-maison, la pression de la création doit être tout autre chez Minuit (sans compter tous les spectres des reustas de la maison, à commencer par Echenoz, une influence majeure de Deck). Et puis, Deck s’éloigne d’elle-même et s’en va expérimenter du côté des genres.
S’ouvrant sur une citation en exergue tirée d’Un pur espion de John Le Carré, Sigma est une courte énigme chorale se déroulant autour de l’existence (hypothétique) d’un tableau du peintre suisse Konrad Kessler. Cette peinture au potentiel controversé pouvant bouleverser l’ordre public en encourageant le tout-venant à se poser des questions qu’il ne devrait pas se poser (pourquoi suis-je là ? que fais-je ? qui suis-je ? etc., tout ça juste en fixant une croûte), une corporation internationale décide de mettre la main sur le chef-d’œuvre et dépêche dans l’entourage local toute une kyrielle d’assistants qui ont pour principale fonction l’espionnage personnel. Ainsi, le directeur d’une banque d’influence, Alexis Zante, collectionneur d’art à ses heures perdues ; Pola Stalker, actrice de cinéma et sœur d’Elvire Elstir, gérante d’une galerie d’art à la recherche de cette œuvre subversive ; Lothaire Elstir, neuroscientifique aux idées quelque peu dangereuses : tous ces personnages sans lien apparent se retrouvent suivis comme leur ombre, dans le but de débusquer l’endroit où l’œuvre siège en secret. L’entreprise d’espionnage global œuvre ici à la tranquillité d’esprit de l’humanité, à la tenue de l’opinion, à la circonférence des comportements. Loin du matérialisme goulu des grandes corporations souvent mises en scène dans les complots, Sigma monopolise ses forces dans le but manipulatoire avoué et revendiqué de ne pas exciter les passions. Julia Deck a pris le temps de revenir sur cette notion dans un long et intéressant entretien avec Diacritik :
« Dans Sigma, je me suis intéressée aux discours officiels des puissants. Je suis toujours étonnée par le fait que les interviews de responsables politiques, de chefs d’entreprise, ou même de stars ou de sportifs de haut niveau semblent à ce point interchangeables. On dirait qu’ils sont complètement opprimés, qu’ils s’autocensurent volontairement pour ne pas sortir des clous. Donc je me suis demandé quelle était cette force obscure qui les poussait à lisser leur discours. J’ai imaginé que cela pouvait être un complot. Dès que vous accédez à un certain niveau de notoriété, une organisation secrète se chargerait de vous faire marcher droit pour que vous ne risquiez pas de perturber l’ordre établi. C’est très séduisant, le complot. Ça a l’avantage de gommer toutes les questions sans réponses, des mystères médiatiques au chaos financier. »
D’un ton léger, caustique et frappant, Julia Deck s’attache à faire entendre la voix des espions puisque c’est pas leur correspondance romancée, les rapports à destination des directions des opérations locales ou du siège mondial que l’on prend connaissance de toutes les pièces s’assemblant peu à peu. Et les espions aussi connaissent les doutes du métier, se révélant être souvent des caractères abusés d’un côté de la branche espionne comme de celle espionnée, souvent insatisfaits du manque de reconnaissance ou pris au piège du dévouement feint qui se transforme en véritable affection pour leur « cible ». Loin de l’image traditionnelle plutôt sérieuse, austère et méticuleuse prêtée aux espions (coucou La Taupe), les envoyés de Sigma sont parfois monsieur ou madame tout-le-monde en mission dans un pays pas poilant, bien emmerdés par toutes les corvées qu’ils se tapent, ne pouvant pas s’empêcher d’émettre des avis personnels. L’industrie de l’espionnage n’échappe pas à la crise de l’emploi et engage au rabais.
Une lecture très sympathique, peut-être moins coup de cœur que Viviane Élizabeth Fauville mais qui ne se faufile pas très loin derrière. Fun fact : Deck entame toujours l’histoire de son dernier livre à l’endroit où le précédent s’est terminé (Viviane s’achevait dans un port, Le Triangle d’hiver se déroulait dans des villes portuaires et se terminait sur une exposition de peintures, Sigma se passe dans le monde de l’art…), ce qui rend le lecteur évoluant dans cet univers fermé sur lui-même encore plus friand de toutes les références, y compris cinématographiques, artistiques ou littéraires, à glaner au fil de la lecture.
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !