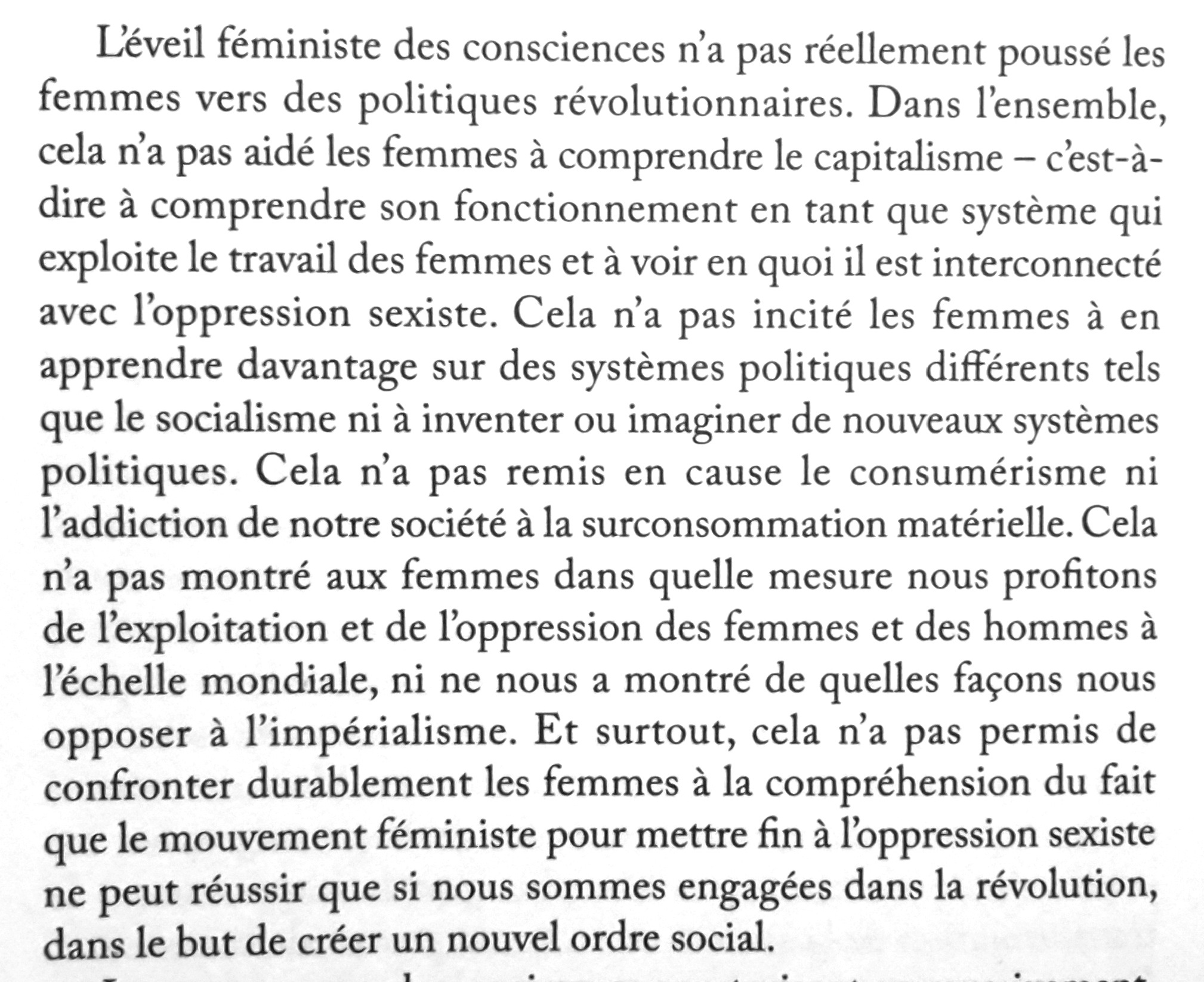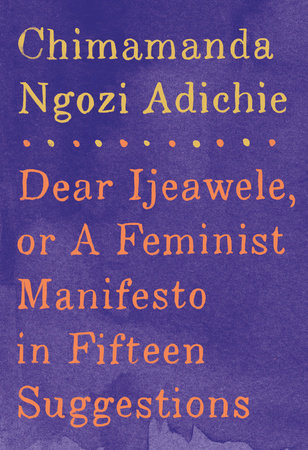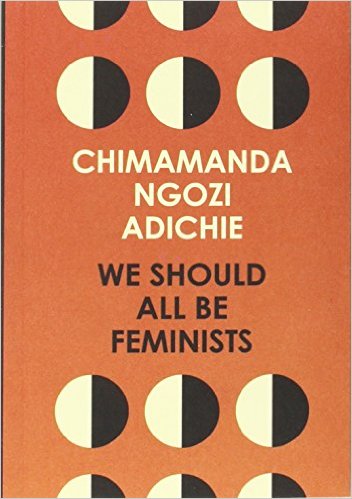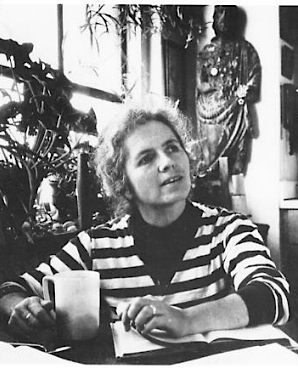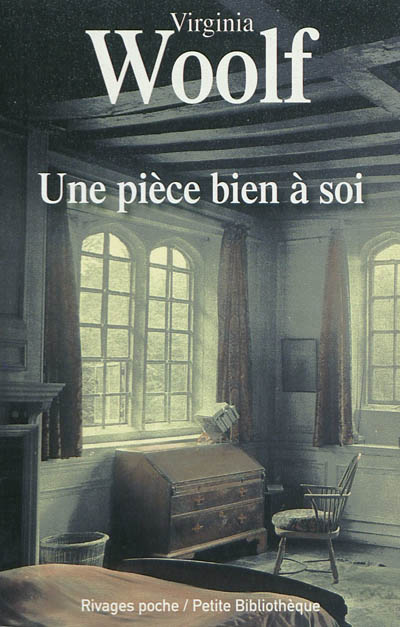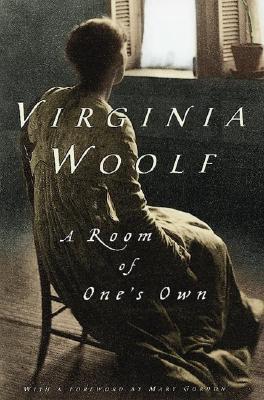Il parait juste de dire de Virginia Woolf qu’elle est une auteure prolifique du XXe siècle.
À la lumière de la parution de ses journaux, d’une densité impressionnante, on mesure combien l’écriture était plus qu’un besoin, une occupation, un métier. Un remède. C’était aussi une stricte discipline, à laquelle elle s’est adonnée chaque jour de sa vie, avec une attention et une rigueur inflexibles. Auteure de romans, d’essais, de pièces de théâtre, de parodies, d’articles, de poésie (ou bien ?), on l’associe plus précisément à ce courant moderniste qu’elle pava, le désarçonnant stream of consciousness, qui vise à rendre la complexité d’un personnage pensant, à en tisser une toile intérieure. Ma première rencontre avec Woolf fut une occasion manquée : traversant une période de curiosité genresque, je lisais Orlando au même moment où je m’intéressais à Herculine Barbin. Sans mise en garde quant à la teneur et la tenue du livre de Woolf, je me perdais dans les méandres des pages sans saisir véritablement les enjeux narratifs, uniquement déçue par l’approche du sujet, jugée trop peu littérale et bien trop littéraire à mon goût.
Quelques années ont depuis permis à l’eau de s’écouler sous les bâtisses, de surélever les berges et de rincer les façades. Je me suis passionnée pour le personnage, dont la modernité, la productivité et la perspicacité ont happé mes premières incompréhensions, et me suis finalement plongée dans ses traductions (disons-le d’emblée), pour m’apercevoir combien ses écrits différaient les uns des autres.
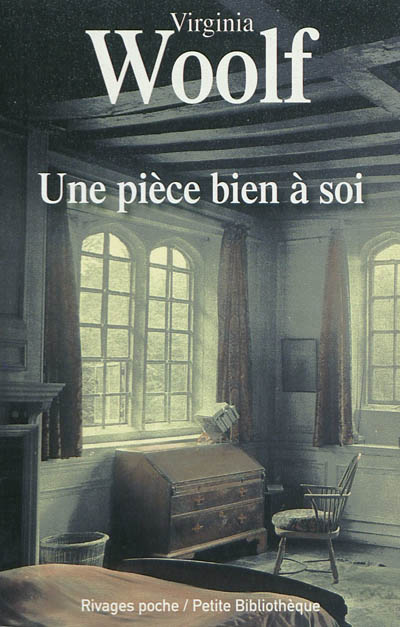
A Room of One’s Own (Une pièce bien à soi, traduction d’Elise Argaud) est paru en 1929. On y écoute une Virginia Woolf placidement virulente, répondre à la demande universitaire de donner une conférence devant deux collèges féminins de Cambridge, sur le thème des Femmes et de la Fiction. Woolf y répond à sa manière à elle : non pas en délivrant un discours conventionnel et démonstratif dans son sens universitaire, mais en faisant émerger les enjeux d’une telle question et en proposant la méthode du flux de conscience. Suivant et retraçant les moindres pas que sa réflexion emboîte en s’appesantissant sur la question, elle emporte avec elle ses auditeurs dans ses déambulations géographiques et temporelles (et non pas juste dans ses connections sémiologiques), démontrant ainsi l’importance de re-contextualiser pour intellectualiser.
Une pièce bien à soi propose de suivre Virginia Woolf dans sa réflexion, alors qu’elle tente de répondre aux attentes de ses commanditaires, qu’elle arpente les campus, la ville, le musée et la bibliothèque, et de saisir le rapport existant entre les femmes et la fiction. À cette conférence, elle donne une forme formidable : elle crée de la fiction féminine en même temps qu’elle en discourt et en fait émerger des motifs. De cette « conférence », on a plutôt retenu sa fameuse invention d’une soeur à Shakespeare, pure création pour montrer que jamais le génie de Judith (eut-elle existé) n’aurait pu s’épanouir au XVIe siècle, et que son lot fatal aurait été purement et simplement… la folie.
L’exclusion
Je repensai à l’orgue tonitruant dans l’église et aux portes closes de la bibliothèque – je me dis que s’il était franchement désagréable d’être mise dehors, il était peut-être encore pire d’être enfermé dedans ; et, considérant la sécurité et la prospérité d’un sexe comparées à l’insécurité et à la pauvreté de l’autre, ainsi qu’à l’effet de la tradition ou de l’absence de tradition sur l’esprit d’un écrivain, j’en conclus qu’il était temps de rouler la peau fripée de cette journée, avec ses raisonnements et ses impressions, ses colères et ses éclats de rire, et de la jeter dans les broussailles.
Voilà bien là le sens de l’humour de Virginia Woolf, un humour flegmatique, aux abords froids et distancieux, au maintien bien droit. Après avoir passé la journée à arpenter les abords de célèbres collèges fermés aux pupilles féminines, être allée et venue dans le temps, après avoir brisé des conventions, Woolf achève son trajet dans le salon d’une certaine Mary Seton, à décrire son chez elle et imaginer quelle parentes l’ont précédée…
Ce premier chapitre prend donc la forme, à l’image d’un acte tragique, d’un jour unique, se dépliant dans un espace limité, Oxbridge. Pour illustrer l’exclusion que les femmes subirent de la part de l’université, l’écrivain se promène et se repose à l’extérieur de l’enceinte, pour signaler que sa réflexion de femme n’a pu naitre qu’en son deçà. Invitée à entrer (mais l’est-elle ? cette séquence a quelque chose d’un songe), elle assiste à deux repas : un déjeuner et un dîner. Elle s’y décide alors, contrairement aux us littéraires, de décrire très en détails, la teneur du repas qui se trouve devant elle ; puis, en dépit de la simplicité et de sa frugalité, elle décide d’en faire de même avec le dîner.
Un mouvement dans le temps s’exécute, elle ne cesse d’aller et venir en toute liberté. C’est l’automne. La journée s’éteint.
Qui est cette figure de Mary Seton, que l’Histoire réclame en dame de compagnie de Mary Stuart ? Et lorsque Virginia Woolf se crée un personnage, « Mary Beton », y a-t-il une référence au prétendant rejeté de cette première, Internet voulant bien délivrer de maigres informations sur son compte, dont une solide propension au célibat qui fit comme victime, l’amouraché (ou non) Andrew Beaton ? Woolf nous demande d’élaborer sur son parcours et ses liens, qui pris dans leur sens le plus littéral, nous résistent avec force.

L’un des grands avantages d’être femme, c’est de pouvoir passer devant une négresse même très belle sans vouloir en faire une Anglaise.
Déconnons pas, Woolf a clairement l’art de vous foutre une audience mal à l’aise.
Rappel de quelques éléments biographiques : Virginia avait été empêchée d’aller à l’université, que les demoiselles étaient galamment priées de ne pas pénétrer, et avait du se résoudre à lorgner sur le parcours de ses frères. Son père lui a pourtant ouvert sa grande bibliothèque dès son plus jeune âge, et elle s’est donc éduquée par elle-même, ayant accès à absolument tout son contenu sans qu’il n’y regarde, de près ou de loin. Autant dire que ça forge un esprit libre (la bibliothèque familiale était connue pour sa richesse). C’est donc une affaire assez incongrue et importante, que d’avoir ce petit bout de femme parler aux jeunes étudiants de l’université, quand elle-même en fut exclue. Elle remet à leur place ces hommes qui en décidèrent ainsi, qui à leur gré, tandis que le vent de la modernité tourne, l’invitent à intervenir auprès d’étudiantes, uniquement pimprenelles de leur état académique. Virginia Woolf est définitivement moderne, et Une pièce bien à soi est une véritable gifle adressée aux messieurs de l’université, à tous les patriarches résistant à l’avancée des femmes dans des corps de métiers. Qu’attendaient-ils d’elle en lui demandant un topo sur les femmes et la fiction ? Elle leur répond d’une pichenette bien placée, renvoyant l’image présente de ceux qui ont tant résisté à leur introduction académique, cette élite d’Oxbridge, leurs ancêtres – dont ils ont poursuit ou poursuivent encore les traditions. Ceux qui empêchèrent les femmes d’avoir leur plume à dire, qui la contraignirent dans le présent à ne rien pouvoir exhumer de féminin et de fiction avant un certain âge. Et de trouver, là encore, des limitations à ses trouvailles.
Où sont les femmes ?
Woolf inaugure un nouveau jour, à Londres cette fois. Direction : le British Museum, où la vérité scientifique doit pouvoir se trouver. En chemin, elle s’attarde pour rapporter le tableau de l’effervescence qui l’entoure, broder la situation de ce simple périple : un pinceau minutieux ? L’art digressif ? Le flux de conscience ? Chaque détail de son parcours compte, comme autant de points de croix littéraires, dont la texture est le clef-de-voûte de sa réflexion. Sa quête avant d’être spirituelle est une quête des habitants, des lieux, des temps. Ou si elle ne la précède, du moins en est-elle indissociable.
Au British Museum, un constat s’impose : un nombre conséquent de livres sur les femmes ont été écrits par des hommes. Étonnement. Et le mouvement inverse ne semble pas tout à fait vrai. Woolf s’interroge, et examine avec attention les intitulés de ces livres : ils sont, dans leur majorité, prescriptifs. Non d’une flûte. Il y a là un panel de livres moraux, critiques, scientifiques, et beaucoup avec pour objectif de prouver l’infériorité naturelle de la femme. L’errante en ressent de la colère, en même temps qu’elle absorbe la colère des auteurs de ces textes. Pourquoi tant de haine, pourquoi ce souci de prouver l’incapacité généralisée de toute une frange de la population ? Sa réflexion l’amène à penser qu’il y a là une crainte de perdre du terrain sur le pouvoir d’influence que s’est octroyé la gente masculine à la sueur de la dure machette de l’Histoire.
Peut-être bien que lorsque le professeur insiste un peu trop sur l’infériorité des femmes, ce n’est pas tant cela qui le préoccupe que sa propre supériorité. (…) Plus que tout, peut-être, tant nous sommes des êtres d’illusion, (la vie) demande de la confiance en soi. Sans cette confiance, nous ne sommes plus que des nourrissons au berceau. Mais comment faire naître très rapidement cette qualité impondérable, pourtant si précieuse ? En pensant que d’autres personnes nous sont inférieures.
Mais ses pensées sont interrompues par une addition qu’elle doit régler. Elle décampe vers une autre route : l’argent. Observant son porte-monnaie d’où elle tire par miracle des billets de dix shillings, elle songe à sa tante, Mary Beton, qui lui a laissé un héritage. Une histoire fausse. Une histoire vraie. L’anecdote fait irruption et disparait aussitôt, pour laisser la trace du squelette sur lequel repose l’essai.
… Je songeai que le changement de caractère produit par un revenu fixe était bien remarquable. Aucune force au monde ne peut m’enlever mes cinq cent livres de rente. (…) Ainsi s’évanouissent non pas simplement l’effort et la peine, mais aussi la haine et le ressentiment? Je n’ai plus besoin de haïr un homme, car aucun ne peut me blesser. Je n’ai plus besoin de flatter aucun homme, car aucun ne peut rien m’apporter. Alors, insensiblement, je me suis mise à adopter une attitude nouvelle envers l’autre moitié de l’humanité. Il était absurde de condamner une classe ou un sexe tout entier. Une grande masse d’individus n’est jamais responsable de ses actes, car ceux-là sont mus par des instincts qui leur échappent.
Retournant vers chez elle, près du fleuve, elle décrit la vie casanière de sa petite rue. Et prévoit que dans cent ans, la condition des femme aura radicalement changé, tandis que les barrières se seront effondrées pour la majorité d’entre elles.
Tout cela peut arriver dès lors que la féminité cesse d’être un métier protégé.

History vs. Herstory
Les lieux changent, la réflexion se poursuit : c’est le foyer qui l’habite à présent.
Il vaudrait mieux tirer les rideaux, chasser de son esprit les distractions, allumer la lampe, réduire son champ d’investigation et interroger l’historien, qui consigne non les opinions mais les faits, pour savoir quelles furent les conditions de vie des femmes, non pas de tout temps, mais en Angleterre, disons à l’époque d’Elisabeth.
Ce déplacement n’est pas anodin : ce qui l’interpelle avant tout, est ce vide dans l’histoire littéraire, d’auteures de sonnets et de pièces de théâtre, d’oeuvres marquantes, voire d’oeuvres tout court. Quand les hommes, de leur côté, ont été si prolifiques, uniques à produire des textes sources. L’Histoire lui apprend que le sort des femmes n’était pas de leur ressort : manquant de liberté, d’autonomie, elles étaient louées pour leur discrétion et leur obéissance. Ah… Mais pourtant, Wolf ne peut s’empêcher de constater que nombre d’héroïnes de l’époque ont marqué leur ère et toutes les suivantes : Antigone, Cléopâtre, Phèdre, Lady McBeth, Roxanne, Hermione, Bérénice ou Andromaque… et plus tard Emma Bovary, Anna Karénine, Clarisse.
Mais de l’Histoire, les femmes sont un peu absentes. Mises à part Elisabeth et Mary Stuart, on ne sait pas grand chose du déroulement de leurs journées en général, encore moins de leur implication dans les grands faits de l’H. Elles semblent avoir doucereusement somnolé lors des Croisades, s’être pâmées lors de l’édification de l’Université et la Guerre de Cent Ans, avoir langui pendant la Guerre des Roses, la Renaissance ou la Dissolution des Monastères. Présentes dans l’absence (certes, mentionnons les nombreuses compagnes d’Henry VIII dont Boleyn qui pava sa route vers le schisme et la dissolution.)
Se demandant bien pourquoi aucune femme n’a écrit d’oeuvre marquante à l’ère Elisabéthaine (il est vrai que le XXe siècle a fouillé l’histoire pour la re-visiter, et on a depuis exhumé les Journaux privés de Elisabeth I pour leur reconnaître une incontestable valeur, littéraire et historique. Néanmoins, ces journaux étant tenus de manière privée, et au vu du statut exceptionnel d’Elisabeth, on ne peut donc tenir cet exemple comme valeur de contre-argument), voilà qu’elle fait jaillir de son imagination les traits d’une soeur, fictive, de Shakespeare, qui aurait eu, à son exemple, droit aux petits avantages financiers de l’héritage familial, génétique (un esprit de génie) et des aspirations similaires. Inutile de préciser que Judith bute tout au long de son chemin dans des embûches d’envergure, finit cinglée et pour ne rien gâcher, se suicide par une nuit d’hiver et se trouve enterrée à quelque carrefour où font halte les omnibus devant l’arrêt Elephant-and-Castle. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Londres, précisons qu’Elephant-and-Castle est un recoin glauque et à l’architecture fortement rebutante : l’endroit a même remporté la palme du lieu le plus moche de Londres, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Judith, pour combler le tout, est donc ensevelie sous l’arrêt de bus le plus laid d’Europe : ça donne envie.
Woolf n’exclut bien entendu pas ces petites exceptions, qui varient d’un siècle à l’autre, et rappelle l’existence muette et terne de Jane Austen ou d’une folle et erratique Emily Brontë. Reste qu’il s’agit bien là du XIXème siècle, et Woolf est bien en peine de découvrir dans sa bibliothèque, des auteures antérieures au tournant du XVIIIe siècle, si sporadiques soient-elles.
Revenant sur les circonstances matérielles nécessaires à l’élaboration d’une oeuvre, le fantôme tuberculeux de Keats est convié à la charmante procession lorsqu’il s’agit de parler des auteurs sur lesquels tous les malheurs tombèrent. Pourtant même ce dernier, malgré son sort funeste, avait trouvé un refuge matériel, accueilli par des hommes, protégé sous les toits de ses mécènes, ou de ses protecteurs.
Mais pour les femmes, me dis-je, en regardant les étagères vides, les difficultés étaient infiniment plus redoutables. Tout d’abord, il était hors de question qu’une femme possède une chambre à elle, encore moins une pièce calme ou protégée du bruit.
Le pire était encore d’ordre immatériel. L’indifférence du monde, si pénible à supporter pour Keats, Flaubert et d’autres hommes de génie, se muait dans son cas à elle en de l’hostilité. À elles, le monde ne disait pas comme à eux : « Ecrivez si ça vous chante, cela m’est égal ». Il s’esclaffait : « Écrire ? À quoi bon ? »

L’écriture féminine
La littérature est parsemée de débris d’hommes qui prirent trop à coeur les opinions émises à leur sujet.
Installée chez elle tandis que son regard se porte sur l’étagère, se pose la question de la production féminine et de la raison d’être du roman : pourquoi a-t-il été le genre de prédilection par lequel la fiction féminine s’est exprimée ? Roman, ce sous-genre.
C’est toute la question de la spécificité de l’écriture féminine. Qu’est-ce que l’écriture féminine ? Y a t-il une écriture féminine ? Voilà un point d’interrogation qui martèle, notamment dans les questions de genre, et la forme plutôt que le fond sont souvent des blocages pour apporter des éléments de réponse. Woolf soulève un point important : l’écriture féminine, c’est avant tout écrire sur une expérience féminine, et non son double masculin. Elle entend par là, écrire sur ce que l’on connait, plutôt que la pensée qu’on le devrait, pour suivre une tradition littéraire et s’inscrire en son sein. Mais mimer n’est pas créer, ce n’est qu’honorer. Pour créer une tradition là où il n’en existe pas, il faut partir de soi et non des autres.
Woolf ne trouve pas grand chose avant le XIXe siècle en termes d’écriture féminine à se mettre sous la dent. L’éducation et les astreintes sociales porteuses de préjugés sont à blâmer : l’écriture féminine est alors privée, on la trouve dans les lettres élégantes de Dorothy Osborne, qui jamais ne fut troublée par la pensée d’écrire un livre, se gardant bien de ce ridicule et de l’humiliation fatidique qui sauraient en résulter. Woolf évoque alors le précédent enfin réalisé par Aphra Behn : émergeant de la classe moyenne, voilà la première femme à subsister de ses écrits (moyennant des sacrifices non négligeables pour l’époque). Bien sûr, j’ai en tête les noms que l’histoire du XXe siècle a réhabilités : Maria Edgeworth, Frances Burney, Mary Hays, Mary Wollstonecraft. Mais ont-elles vécu de leur plume ?
D’autres noms surgissent, aux lauriers plus altiers : Emily et Charlotte Brontë, Jane Austen, George Eliot.

Aucun chef-d’oeuvre ne surgit solitaire et unique ; tous sont le produit de nombreuses années de pensée en commun, d’une pensée exercée par la masse du peuple, afin que la voix unique s’appuie sur l’expérience de l’ensemble. Jane Austen aurait dû déposer une couronne sur la tombe de Fanny Burney et George Eliot rendre hommage à l’ombre vigoureuse d’Eliza Carter – la vaillante vieille femme qui attachait une clochette à sa tête de lit pour se réveiller tôt et apprendre le grec.
Pourquoi le roman donc ? Emily Brontë, George Eliot, Charlotte Brontë et Jane Austen sont des figures qui n’ont pas tout à fait leur lot de points en commun. Pourquoi leur « génie » littéraire s’est-il pourtant exprimé par la forme du roman ? Revient alors cette pièce à elles, dont elles ne disposaient pas (trait partagé par cette classe moyenne) et du temps qui ne leur était pas imparti. Pour écrire de la poésie (cf. Dickinson, auto-cloîtrée sa vie entière), du théâtre, il faut du temps et de l’espace. En témoigne le neveu de Jane Austen qui écrivit ses mémoires : lui-même est assujetti à une certaine perplexité quand il considère l’étendue de son oeuvre. Elle ne disposait, avance-t-il, que de très peu de temps à elle… Où a-t-elle trouvé la capacité de filer de tels canevas ?
Et puis, une fois encore, toute la formation littéraire d’une femme au XIXe siècle consistait en une observation des caractères et en l’analyse des émotions. Depuis des siècles, sa sensibilité était éduquée par les influences reçues dans le salon commun. Elle s’y imprégnait des sentiments de chacun ; elle avait sans cesse sous les yeux le spectacle des relations humaines. Par conséquent, lorsque la femme de la classe moyenne se mit à écrire, elle se tourna tout naturellement vers le roman.
Et d’un petit rond de jambe, Woolf soulève à la force d’une démonstration toute naturelle, la prédisposition en ce début de XIXe siècle du roman pour faire émerger une fiction propre à l’expérience féminine ; mais encore une fois, il faut marquer les limites de cette expérience, rattachée à la classe moyenne, puisque la femme laborieuse des villes ou des champs n’est absolument pas représentée dans la peinture de ces romans-ci, et si elle est peinte, c’est d’après observation, et non d’après vécu. Woolf précise que la stature de chacune fait qu’elles avaient été moulées pour d’autres genres : la poésie, le théâtre, l’histoire et les biographies, mais que leur nature ad minima de femmes les conditionna pour verser dans le genre romanesque.
L’intégrité du roman
Elle poursuit sur une comparaison entre Jane Austen et Charlotte Brontë, qui la conduit vers ce qu’elle nomme « l’intégrité du roman » : l’incompréhension de la seconde du génie de la première, et l’échec – en tant que romancière au sens où veut l’entendre Woolf – de la seconde. Charlotte aurait, aux dépens de son histoire et de sa caractérisation, évacué de sa frustration dans son oeuvre, et sa voix se scinderait en autant de commentaires non contrôlés qui voileraient la voix de ses personnages. Il ne faut pas écrire lors d’un accès de rage, mais avec sagesse, dans la placidité de la réflexion. Les répercutions du fait d’être une femme, qui entravaient la vie et les aspirations broyées de Charlotte Brontë, marquèrent certains passages de Jane Eyre.
Le roman, d’après Woolf, est un certain reflet, déformé, simplifié et construit, de la vie. Elle en donne également une description imagée :
Il s’agit d’une structure qui marque l’imagination, organisée autour de cours, en forme de pagode, déployant ses ailes et ses galeries ou ramassée et massive et dotée d’un dôme comme la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople.
Mais il reste franchement difficile d’évaluer le degré auquel cette micro-tirade est lancée.
Dans le cas du romancier, ce que j’entends par « intégrité », c’est la conviction qu’il nous donne d’exprimer la vérité.
J’aime qu’elle tienne cette position, mais il faut bien reconnaître que c’est l’exact argument inverse que soutiennent nombre d’autres écrivains. Voir soudainement avec lumière une situation précédemment vécue mais non appréhendée livre au roman une dimension élévatrice (ce genre sordide). Néanmoins, c’est là la force des narrateurs et énonciateurs, de détenir le pouvoir de faire gober n’importe quoi au détour d’une langue bien ourlée, aussi peut-on facilement imaginer ce qu’il y aurait à y décrier. En tout état de cause, si le roman n’a pas même éclairé et laisse un goût inachevé, alors Il a échoué. Râté.
Et effectivement, pour la plupart, les romans échouent quelque part.
Et comme le roman possède cette correspondance avec la vie réelle, les valeurs qu’il porte sont pour une part aussi celles de la vie réelle. Cependant, il est bien évident que les valeurs des femmes diffèrent très souvent de celles forgées par l’autre sexe – c’est tout naturel. Mais les valeurs masculines dominent. Pour le dire crûment, le football et le sport sont « importants », tandis que le culte de la mode et l’achat de vêtements sont « futiles ». Or ces valeurs passent immanquablement de la vie à la fiction. Tel autre est insignifiant, car il traite des sentiments des femmes au salon.
Et cette différence de valeur demeure. Woolf salue la capacité des femmes écrivains, telles Jane Austen et Emily Brontë, qui ont su ne pas se plier à l’ordonnance des sujets valeureux : elles ont écrit à leur manière, de leur point de vue, non en suivant l’idée générale du public de ce qu’aurait approuvé l’établissement littéraire. C’est là l’intégrité des auteures d’Emma et des Hauts de Hurlevent.
Ce patrimoine commun qu’elle décrit est prétendu nul pour les femmes écrivains précédemment citées : impossible de se servir de la tradition littéraire à leur portée pour trouver un style à elle, une écriture qui leur corresponde. La tâche est gigantesque, noble, édifiante.
Le poids, le rythme, l’allure d’un esprit d’homme sont trop éloignés des siens pour qu’elle réussisse à lui voler quoi que ce soit de conséquent. L’imitation est trop vaguement ressemblante pour pouvoir être fidèle. La première chose qu’elle découvrir peut-être en prenant la plume fut l’absence de phrase courante à sa disposition.
Ainsi, Thackeray, Dickens ou Balzac avaient chacun trouvé leur voix, leur rythme, leur tonalité bien particuliers, en s’appuyant sur le domaine commun. La réussite de Jane Austen est d’avoir dessiné le contour d’une phrase unique, qui lui corresponde, bien proportionnée et à laquelle elle se tint ensuite avec constance, sans faillir, dans le moindre recoin de ses romans. Le roman, une forme littéraire assez jeune et bien plus flexible que celles rodées, raides et caillées du théâtre ou de la poésie, est donc le choix de prédilection, et presque l’unique choix, qui était à disposition des femmes écrivains en érection.
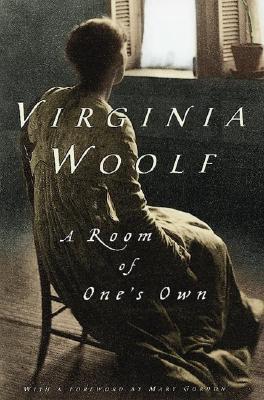
Apporter sa pierre à l’édifice
La voilà revenant, dans le cinquième chapitre, à l’époque contemporaine, où les auteures féminines occupent les étagères presque autant que leurs collègues masculins.
Elle s’attelle à réinventer le type même de de la conférence : après tout, malgré le fait qu’elle édite et augmente son originelle intervention, elle choisit d’en garder la forme, d’en garder l’adresse. C’est à vous qu’elle parle, vous, et seulement vous : elle joue avec adresse des pré-requis. On lui a spécialement demandé de prodiguer ses sages paroles à des étudiantes du collège ? Elle en profite pour passer derrière l’institution qui l’invite et fait des recommandations de son propre cru, qui ne seront pas émises de ces murs. Elle situe la pièce, parle du rideau derrière lequel elle espère qu’un recteur ne s’est pas caché, ou quelque instance inviteuse qui pourrait grimacer à ses répliques. Elle rappelle constamment que c’est une conférence qui lui a été demandé de délivrer, pour parler des Femmes et de la Fiction. De quoi pourrait-elle parler d’autre, sinon des femmes ? Pourquoi aurait-on invité cette femme romancière, cette moderniste de génie, sinon pour débiter de cette vaste matière ? Elle donne l’illustration même des difficultés dont elle parle pour les passées écrivaines, des silences de l’histoire, du génie enfoui, par sa langue, son rythme, sa tonalité, sa narration, sa virtuosité à offrir de multiples niveaux d’écoute et de lecture : les femmes et la fiction, c’est aussi Virginia Woolf, qui accomplit un formidable tour de force. Elle crée un personnage, de multiples facettes de fiction pour parler de l’imparlé, et parler surtout de la réalité de la fiction féminine. La réalité par la fiction et la fiction par la réalité.
Au travers du personnage (fictif ?) de Mary Carmichael, une auteure de romans dont le style ne semble, à première vue, pas époustouflant, elle écrit à présent d’une époque où la route est pavée, pour les femmes se destinant à l’exercice de l’écrit, où cette vocation n’est plus une marginalité. Elle regarde cette romancière comme la descendante des madame de Winchelsea, Jane Austen, Aphra Behn and & co.
Car les livres se prolongent les uns dans les autres, malgré notre habitude de les juger séparément.
L’écriture, le style, n’a rien de vrombissant. Woolf lui trouve des défauts instantanément. Mais pour mieux juger l’ensemble du livre et de l’écrivain, elle reprend sa lecture du début, avec minutie.
Je lus : « Chloé aimait bien Olivia. » Et je fus frappée tout à coup par la changement majeur que cela faisait surgir. C’était peut-être la première fois en littérature que Chloé aimait Olivia. Cléopâtre n’aimait pas Octavie. (…) J’essayais de me rappeler, dans le cours de mes lectures, le cas de deux femmes présentées comme amies. (tentative dans Dianne de la croisée des chemins) De temps à autre, elles sont mère ou fille. Mais elles apparaissent presque sans exception sous l’angle de leur rapport aux hommes. (…) D’où le côté étrange des personnages féminins, leurs incroyables extrêmes de beauté et d’horreur et leur oscillation entre divine bonté et infernale dépravation – car c’est ainsi que la verrait son amant selon que son amour enfle ou retombe.
Avec une nuance faite pour les romanciers du XIXe siècle, dépeinte avec plus de complexité, dit Woolf, avant de s’épancher un moment avec emphase sur la difficulté de capturer l’esprit et le caractère d’une femme.
Là, cependant, nous commençons à diverger :
Cette puissance créatrice (cf. des femmes) n’a pourtant absolument rien à voir avec celle de l’homme. Il faut donc en conclure qu’il serait vraiment dommage d’empêcher son déploiement ou de la gaspiller (…). Il serait vraiment dommage que les femmes écrivent ou vivent comme des hommes ou encore leur ressemblent, car, même si aucun des deux sexes n’est complètement adéquat, vu la vastitude et la variété du monde, comment ferions-nous s’il n’en existait qu’un seul ? L’éducation ne devrait-elle pas avoir comme rôle de révéler et de renforcer les différences plutôt que les similitudes ? Il y a déjà trop de ressemblances en l’état, et si un explorateur s’en revenait rapportant la nouvelle de l’existence d’autres sexes scrutant d’autres cieux à travers d’autres branches d’arbres, rien ne rendrait plus service à l’humanité ; sans compter que cela nous procurerait l’insigne plaisir de voir le professeur X se précipiter sur ses règles graduées afin de prouver sa « supériorité ».
Je ne m’accorde pas, mais c’est évidemment à mettre en corrélation avec l’argument que veut faire valoir Woolf : il ne sert à rien d’écrire sur l’expérience des hommes, si l’on doit l’inventer car il faut alors passer par les lieux communs. Une expérience qui a été valorisée par un corps qui n’est pas le sien, vendue comme un absolu. En ce sens, elle revient sur les innombrables vies et aspects de vie inconnus de tous, sur lesquels ni les hommes, n’auraient écrit. Elle veut aider Mary Carmichael a faire la lumière sur son âme, tenir son flambeau, et l’enjoint plus d’une fois.

Elle écrivait comme une femme, mais une femme qui aurait oublié ce qu’elle est, tant et si bien que ses pages étaient pleines de cette singulière qualité sexuelle qui découle d’un sexe qui ne se perçoit pas comme tel.
Quelques routes de continuation sur Multitudes et Agoravox, et les ressources de la London Review of Books : la bio d’Hermione Lee, Deceived with Kindness, Three Guineas, On being ill et Flush.

 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !