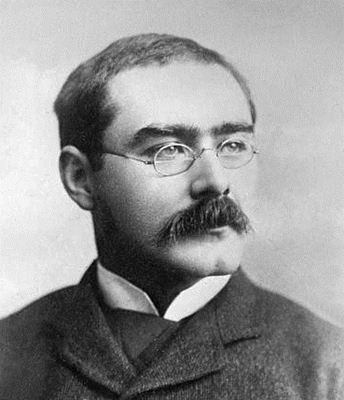En termes d’écriture victorienne et pré-victorienne, on a retenu quelques fameux noms, qui se ricochent les uns les autres : il y a d’un côté, Jane Austen, ouvrant son siècle par un style réaliste et dépourvu de fioritures ; plus tard viennent les Brontë et leur manie romantico-gothique, Dickens et sa productivité de manufacturier, George Eliot, Wilkie Collins et Mary Shelley se baladent quelque part, tandis qu’Henry James et Edith Wharton débarquent sur la fin de siècle. On a vite relégué Frances Burney, Maria Edgeworth ou Aphra Behn dans le panier des moins-que-les-autres, quand Daniel Defoe, Henry Fielding et Samuel Richardson se payent la vitrine sans concession. Certes, mon relent de féminisme aveuglé concèdera qu’Ann Radcliffe et ses romans d’échevelées (littéralement, l’héroïne à la chemisette volante et aux cheveux détachés) ont obtenu reconnaissance, sinon critique, du moins publique. Mais les éternels relus éclipsent souvent leurs contemporaines, et c’est devenu, on le sait, l’un de mes poneys-nains de bataille, dans cette arène numérique où je m’évertue à donner des coups de rapière en bois à ma seule ombre.
Parlons un peu ce jour d’Elizabeth Gaskell, noble épouse de pasteur, bienconnue de son époque et tombée dans l’oubli peu après. On en connait peu l’oeuvre dans nos contrées saucissonnées, mais outre-Manche, sa renommée est plus établie, figure historique de l’écriture féminine aux côtés de George Eliot et des soeurs Brontë. Attention cependant à ne pas l’assimiler à cette bougresse de Jane Austen, qui expira l’air que respira bambine Gaskell, car cette dernière a notablement nourri un dédain fort affiché (dans sa correspondance, ses écrits, etc…) pour l’écriture et les sujets non-révolutionnaires d’Austen : car chez Gaskell, la modernité est omniprésente, le social et le politique sont en vitrine et une héroïne fait bien de laisser le naturel galoper les plaines de la transgression, tant que les intentions sont morales et la conduite dépourvue de répréhension. On ne saurait qu’approuver.

Pour rendre à César ce qui fut ravi par César, il faut bien sûr noter le travail de la BBC pour jeter un éclairage sur la production de Gaskell : impossible de passer à côté de l’adaptation de North and South datant de 2004, à la musique poignante, aux acteurs incarnés, à la mise en scène impeccable ; la libre écriture de Cranford, tirant son intrigue de plusieurs de ses romans, ou bien le plus vieillot Wives and Daughters, entraînant tout de même. C’est par la figure inflexible du Mr Thornton visité sous les traits de Richard Armitage que j’ai exécuté ma première incursion dans l’univers de Gaskell, via ce manufacturier élevé au rang de bourgeois par la seule force de son travail et sa détermination, trouvant dans le commerce une idéologie et une morale de vie. Il est pourtant curieux (décevant ?) de constater à la lecture du pavé originel de l’auteure que les scènes « romantiques » de la mini-série de la BBC (pauvres dans le livre, présentes sans omni à l’écran) sont des réécritures étoffées de ce qui est sous-entendu ou peu appuyé par le texte. Si l’intrigue amoureuse est bien là, quelque part, c’est loin – très loin – d’en être l’objet, les pages de descriptions et de dialogues donnant la constante prescience au contexte ouvrier et manufacturier, à la rencontre des mondes classés. On voit bien pourtant l’attrait de ce romantisme d’un point de vue commercial, car quitte à lire un ouvrage dressant le portrait de la lutte des classes à l’heure de la Révolution Industrielle et de la montée des syndicats, pourquoi se tournerait-on vers le roman d’une femme ? Par contre, si l’on souhaite bénéficier d’une lecture romantique sur fond de fresque sociale, où les caractères orgueilleux que les deux protagonistes tirent de leurs milieux respectifs clashent avec des accents de tragédie, alors bienvenue, lectrice. C’est ce que mettent en avant les éditeurs souhaitant réhabiliter un peu l’intérêt que l’auteure a connu de son vivant, avec des couvertures arborant d’élégantes figures – qu’on ne voit pratiquement jamais apparaître dans le paysage industriel qui contient l’intrigue – et des références ou citations au concept (trompeur en ce qui concerne cette lecture-ci) d’amour impossible. Dommage, mais réaliste d’un point de vue commercial.

Sur ces entrefaites, causons-en un peu de l’intrigue !
La famille Hale, constituée d’un pasteur, sa femme, sa fille, Margaret et leur gouvernante, Dixon, déménage soudainement de la petite bourgade de Helstone dans le Hampshire, dans le Sud de l’Angleterre, pour rejoindre une ville industrielle du Nord, Milton, où Mr Hale a trouvé un nouveau travail d’enseignant. Margaret, qui a vécu plusieurs années à Londres sous la protection de sa tante et en compagnie de sa bien-aimée et quelque superficielle cousine, Edith, n’a le temps que de cligner de l’oeil sur la campagne verdoyante et paradisiaque du Sud, avant de faire ses bagages et suivre le mouvement ascendant. La raison de ce déracinement vient du refus de Mr Hale de renouveler ses voeux envers l’Eglise établie : le pasteur est un intellectuel d’Oxford, honnête, qui ne peut supporter de rester plus longtemps en position compte-tenu de ses doutes de conscience. Abandonnant le presbytère derrière lui, il entraîne à sa suite femme et enfant vers le Darkshire (qui porte bien son nom) et la ville industrielle de Milton où une place lui a été trouvée en tant que professeur de leçons privées, sous la protection d’un riche commerçant du nom de Mr Thornton.


À leur arrivée, c’est l’effondrement d’un monde et la découverte d’un autre avec une effroyable stupeur : le contraste entre la lumière et le calme du Sud, et l’agitation et la noirceur du Nord. Les gens se bousculent, la pauvreté est partout, l’air moins respirable, les logements insalubres et la fumée enveloppe de son manteau la ville toute entière. La ville est dominée par le commerce du textile : ce sont les manufactures de coton qui font la richesse et la pauvreté de ses habitants, des habitants orgueilleux, furieux, révoltés, qui tirent de leur savoir-faire une fierté et un féroce esprit d’indépendance. Les patrons et les ouvriers, qui s’unissent en syndicat depuis plus d’une dizaine d’années, s’affrontent, impitoyables les uns envers les autres.
C’est dans cette atmosphère dichotomique que les Hales mettent les bottes. Plus pauvres que les industriels dirigeant la ville, mais affiliés à l’aristocratie de par leur statut social et leur éducation. Le père et la fille incarnent, chacun à leur façon, la tentative de dialogue et de compréhension qui s’établit entre les deux fronts : Mr Hale trouve en Mr Thornton un pupille patient, éclairant et fascinant sur la situation du commerce et de sa tenue, tandis que Margaret se lie à la classe ouvrière par le biais de Bessy et Nicholas Higgins et établit avec eux ses premiers et seuls rapports amicaux dans la ville. C’est là le principal thème du roman d’Elizabeth Gaskell : le déplacement. Comment les deux mondes se provoquent et s’accusent de n’y rien entendre l’un à l’autre, entre le Nord des Higgins et le Sud de Margaret, entre le Nord de Thornton et le Sud de Margaret, entre le Nord des Higgins et celui de Thornton. Il s’agit d’un constant mouvement, l’effort de compréhension de Thornton et la mise à disposition de ses clefs aux Hales, vers qui il tend la main sans discontinuer, immanquablement attiré par la simplicité et la noblesse de maintien de coeur de Margaret, de la bonté et l’intelligence de son père ; il s’agit également du constant effort de Margaret de défendre la classe ouvrière et d’accuser celle de Thornton de ne jamais faire assez, et pourtant toujours oeuvrer vers un consensus en présence des pauvres. Il s’agit enfin d’essayer de se retrouver au milieu de toutes ces luttes, car enfin aller jusqu’au bout d’une extrémité n’amène jamais rien d’autre que la perdition de celui qui s’y est aventuré.

Ce mouvement est parfaitement bien compris par l’adaptation télévisuelle de la BBC (la scène finale, les deux personnages se rencontrent sur un quai de gare, lors de l’arrêt de chacun de leurs trains, revenant ou allant vers le Nord : ils se rencontrent exactement en son milieu). Superbe scène de première rencontre entre Margaret et John : cette dernière, lasse d’attendre dans le bureau de ce dernier pour mettre au clair une histoire de logement, se rend dans la manufacture de textile et ouvre grand les portes sur un monde complètement inconnu. Les flocons de coton volent alors partout, comme des flocons de neige, dans une vision de ciel chutant, avant de voir la figure trônante de Thornton, du haut de sa rambarde, surplombant l’ensemble des ouvriers, hurler après l’un des hommes et dévaler les marches pour le poursuivre et le battre en plein milieu de l’usine. La scène est créée de toute pièce, puisque dans le roman, Thornton vient présenter ses hommages à Mr Hale à leur hôtel et en l’absence de ce dernier, c’est Margaret qui lui tient compagnie une demi heure durant dans le salon, demi heure pendant laquelle elle se trouve bien en peine de faire la conversation avec un homme si peu prolixe, pourtant tombé sous le charme.

Certains portraits sont tout bonnement fascinants : Thornton s’en sort haut la main, peint dans toute sa complexité, ses failles, ses contradictions nées de de la friction entre ses croyances inébranlables et sa vive sensibilité.

Margaret dispose d’un capital fortitude non des moindres : fille unique d’un père occupé à vaquer à ses activités intellectuelles et d’une mère peu encline à s’occuper des affaires de sa fille, elle est laissée à elle-même, ce qui implique dans une ville comme Milton de sortir sans chaperon et se heurter à la violence apparente d’une ville qui ne fait pas de quartier. Cette liberté imposée devient le point de départ de la prise d’indépendance du personnage, qui déjà peu encline à faire des manières féminines (un style vestimentaire des plus pratiques, des manières franches et peu « d’aptitudes » – aucun talent au piano, pas de goût particulier pour le dessin – tandis qu’elle met la main à la patte pour le repassage, le lavage, le nettoyage…), souffre de moins en moins qu’on lui impose une manière de vivre, et d’autant moins une pensée. Déjà prédisposée à délivrer son opinion avec franchise (sans s’affoler de partir en croisade contre l’assemblée toute entière), elle en vient à acquérir une véritable liberté de faits. Sa conscience sociale s’éveille, et rien ne peut plus la détacher des sujets qui la préoccupent le plus : les grèves, les conditions de vie des ouvriers, l’état du commerce, la pacification des rapports entre les classes, ou encore la spéculation, jusque se faire enseigner en fin de volume les rudiments de finance et de droit en vue de futurs investissements. La transformation progressive de Margaret Hale l’amène à glaner une fibre d’entrepreneuse qui de fait constitue son ambition de vie.

Le prêchi-prêcha auquel elle s’adonne nuit néanmoins à mon sens à sa haute stature : indomptable, certes, mais ses positions inflexibles mettent en échec sa raison quand le soit-disant cruel et rustre Mr Thornton déploie infiniment plus de patience et de pédagogie pour faire se rencontrer les deux mondes. Margaret représente également la gardienne de piété, plaçant la volonté de Dieu au-dessus de tout, la morale chrétienne comme conduite de vie et de commerce. C’est un personnage parfois frustrant de par son potentiel héroïque (elle n’hésite pas à se placer entre patron et ouvriers, quitte à se prendre une brique dans la tronche) doublé d’une opiniâtreté qui ne voit parfois pas plus loin que le bout de son nez. Elle passe d’ailleurs le plus clair de son temps à s’excuser pour ses écarts et ses faux-pas, lucide sur ses ignorances, mais paradoxalement entêtée dans ses jugements. L’une des faiblesses d’un tel comportement vient de l’entendement avec lequel le lecteur écoute les discours raisonnés de Mr Thornton, dont la dureté et l’inflexibilité sont des manifestations de sa pensée à long-terme, de sa capacité à anticiper et planifier : des comportements donc raisonnés, et non une simple posture caractérielle.

Gaskell est bavarde, c’est un reproche qu’on peut lui adresser. La narration pourrait régulièrement se faire l’économie de certains dialogues, parfois alourdis à force de trop en dire. Il faut alors se rappeler du format de publication de Nord et Sud, la sérialisation en chapitres dans les journaux de Dickens, qui tend à exploiter ses écrivains jusqu’à la moelle et nuit parfois à la fortification de leur romanesque. Nord et Sud serait une version plus étayée et plus équilibrée de la situation des ouvriers déjà rapportée dans son premier roman, Mary Barton, dont l’adaptation est peut-être déjà en cours par la BBC.


 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !

 Asimov, précurseur du duckface ?
Asimov, précurseur du duckface ?