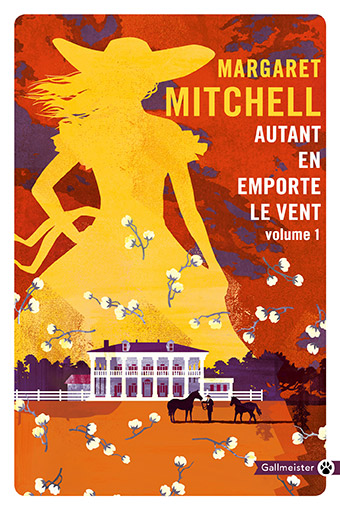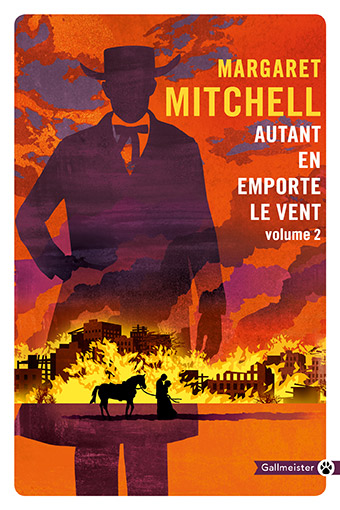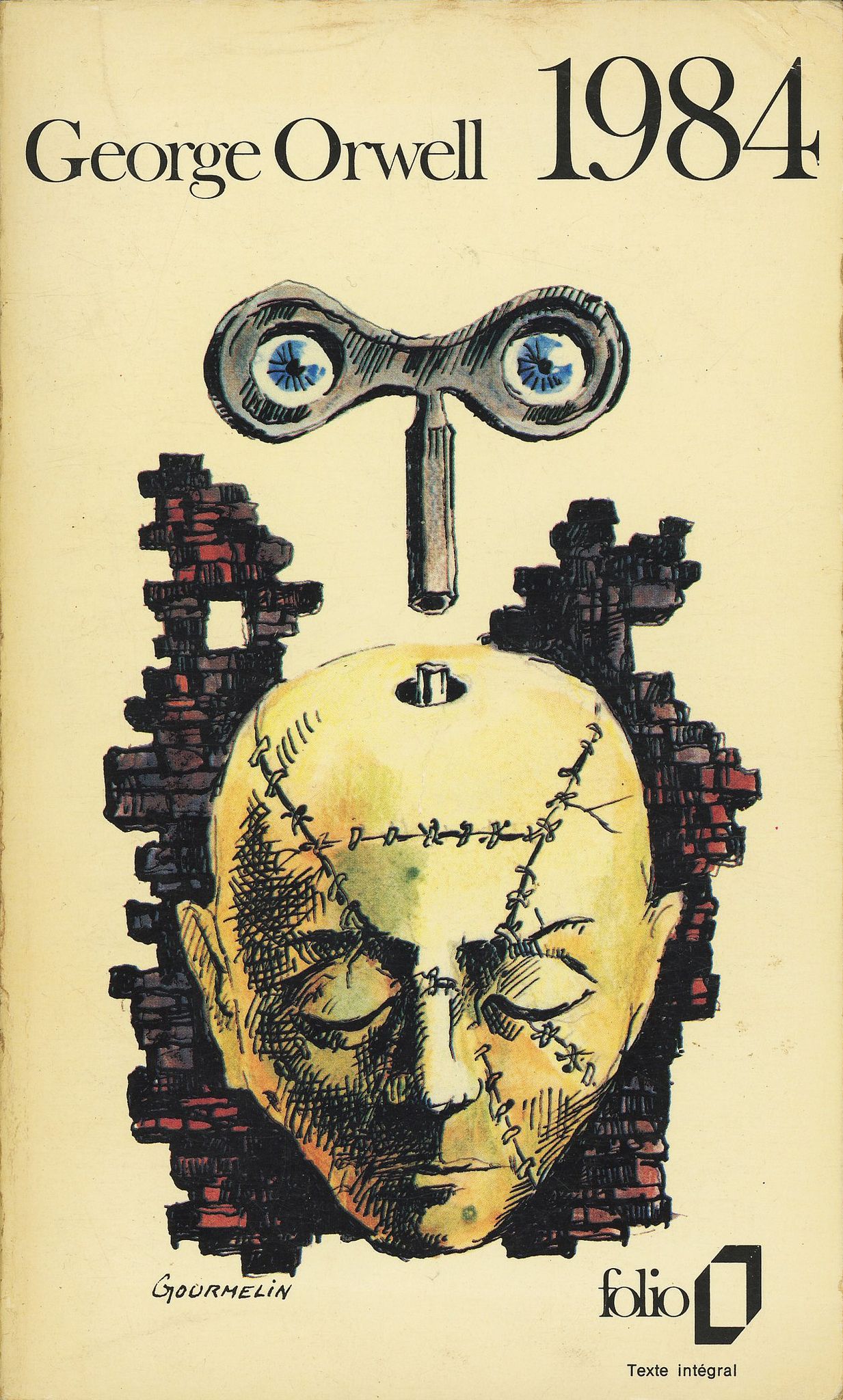Je suis une femme de 47 ans hantée en permanence par un sentiment d’impermanence. Si le temps ressemblait à un morceau de musique, on pourrait le rejouer jusqu’à en saisir la moindre nuance.
Issue d’une famille juive de la petite bourgeoisie new yorkaise conformiste, Joyce Johnson (née Glassman) a grandi à quelques pas de Broadway, de Columbia et du Village. À l’âge de 20 ans, elle rencontre Jack Kerouac (alors âgé d’une trentaine bien passée), auteur d’un roman inconnu, fauché, alcoolique, pour qui elle nourrira une passion obsessionnelle pendant près de deux ans, deux ans qui verront ce fantôme de la Beat Generation publier son roman phare, Sur la route, puis sombrer dans une soudaine et déflagrante célébrité.

Aussi ce livre témoignage est-il, il est vrai, la promesse de connaître les coulisses des Beats, promesse ô combien tenue. Mais c’est aussi le récit d’autres personnages, ces Personnages secondaires éponymes qui naviguèrent autour de ces écrivains survoltés, subirent leurs frasques, les entretinrent coûte que coûte pour les garder à flot, et, pour un certain nombre d’elles et eux, sombrèrent dans la folie, le suicide, la maladie. Joyce Johnson, qui le dit dans cette citation clôturant son livre, aurait voulu engloutir la vie autant que les autres : mais une retenue profondément ancrée en elle la maintient à la marge, et c’est ce qui lui permet de raconter l’existence oubliée de sa meilleure amie sacrifiée à cette génération pleine de vie et de mort.
Johnson entame son histoire par la sienne propre, celle de son milieu modeste et calme, celle de son quartier, Manhattan, et entreprend de conter sa lente progression, de fille tranquille et obéissante, vers l’état de sécession spirituelle puis physique, elle qui ne cesse de regretter appartenir à la Génération silencieuse, une génération qui ne vit pas, qui attend le déclic. De dix ans la cadette des consorts de la Beat Generation, elle se laisse porter par une époque attendant des jeunes filles qu’elles fassent leurs études avant de se ranger. Mais à l’adolescence, quelque chose lui manque : les activistes trotskistes qu’elle croise dans la rue constituent sa première rencontre avec un monde souterrain de marginaux, d’exclus, de parias. Pourtant, Johnson colle partiellement à la description d’un idéal bourgeois : peu bravache, assidue à l’école puis à l’université – Barnard College, dépendance de l’université de Columbia où Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs et Lucien Carr se rencontrèrent dix ans auparavant –, elle pressent avec acuité son enfermement quotidien, le besoin d’émancipation d’une génération. Mais jusqu’à ses 19 ans, elle se contente de regarder avec envie la vie débridée de ses quelques amies dont elle s’entiche avec force, puis des compagnons de ses amies sur lesquels elle transfère son admiration. Elle prend tout de même le soin de sécher des cours lors de sa quatrième année à Barnard et n’obtient jamais son diplôme, ce qui ne l’empêche pas de décrocher très rapidement un boulot de dactylo dans l’édition (une belle époque), puis de job en job, de finalement monter l’échelle éditoriale.

Parmi ses amies, il y a Elise Cowen, profondément atteinte d’un mal existentiel et psychanalytique, qui se lie avec Allen Ginsberg en 1953, quelques années avant la percée de celui-ci à San Francisco et la Renaissance poétique de Berkeley menant à l’émergence de la Beat Generation. Lorsqu’en 1956 paraissent les premiers articles couvrant ce mouvement littéraire (dont l’apparition a en réalité été savamment orchestrée durant des mois par Ginsberg, Kerouac et autres chantres), Johnson remarque le visage de Kerouac – encore relativement inconnu – sur les épreuves d’un reportage de magazine : elle s’intrigue à sa vue, puis tombe par hasard sur sa première publication chez l’agent littéraire pour lequel elle travaille.

Ginsberg et Cowen, qui (se) tapera le manuscrit de Kaddish à la machine
On ne peut cesser de déplorer, à la lecture de ce livre, combien l’attention et les choix de vie de Johnson (ou de ses comparses) tournent bien trop souvent autour de leurs idoles. Quand, à 21 ans, Johnson voit l’un de ses projets de manuscrit accepté pour publication par Random House et qu’un poste d’assistante éditoriale lui est offert chez Farrar, Strauss and Cudahy par le directeur littéraire Robert Giroux (celui-là même qui finira par diriger la maison d’édition), elle lâche tout pour rejoindre Kerouac au Mexique – et échoue en chemin, puisque Kerouac finit par rentrer en Amérique une semaine avant qu’elle parte le rejoindre. On a envie de lui hurler entre les pages de cesser d’être aussi écervelée. C’est bien entendu sans compter la mémoire que l’on perd de nos 20 ans, ces années de fulgurance où les émotions nous submergent, où le désir d’aventure chez certain.e.s surpasse tout.

Mais le témoignage qui m’a le plus surprise est la description des événements menant à l’encensement de Sur la route. Car, on l’oublie, ce manuscrit a été rédigé par Jack Kerouac en 1951, en l’espace de deux semaines, par un Kerouac probablement sous influence. Les années suivantes, l’auteur essaye de le refourguer à des éditeurs, sans succès, car son tout premier ouvrage publié en 1950, The Town and the City, n’a pas rencontré le public. Quand Viking Press accepte enfin de publier Sur la route, nous sommes en 1957 : l’époque est enfin prête à recevoir cette prose virevoltante, frôlant avec le non-sens, mais Kerouac n’est plus du tout le même. Ses années d’errance l’ont fatigué, il est habité par un sentiment de solitude inextinguible où qu’il aille, il n’est plus en si bons termes avec Neal Cassady, dépeint à ses côtés dans son road-trip. L’auteur n’est plus celui de 1950 et regrette presque sa publication imminente, tandis que les étoiles s’alignent du côté de la critique new-yorkaise :
Quelque part à Cape Cod ou sur le Sound, Orville Prescott, critique littéraire conservateur et vieillissant du New York Times, prenait ses congés annuels. Durant la période creuse du mois d’août, le compte rendu de Sur la route échut à une homme plus jeune nommé Gilbert Millstein, qui suivait la carrière de Jack depuis des années – depuis qu’il était tombé sur l’expression “Beat Generation” dans le romain de John Clellon Holmes intitulé Go, et, cherchant à mieux définir le mouvement naissant, avait demandé à Holmes d’écrire un article sur le sujet.
Apparemment, cette coïncidence relevait de la chance pure et simple – même si l’on vanta ensuite la stratégie éblouissante de Viking Press.
Et, de fait, Gilbert Millstein n’y va pas avec le dos de la cuillère du panégyrique, jugez vous-même :
« Sur la route est le deuxième roman de Jack Kerouac, et sa publication un événement historique dans la mesure où l’apparition d’une œuvre d’art authentique est de quelque importance […]
… la déclaration la plus claire, la plus importante et la plus belle faite jusqu’ici par la génération que, voici des années, Kerouac lui-même qualifia de “beat”, et dont il est le principal avatar.
De même que Le Soleil se lève aussi, plus que tout autre roman des années 1920, fut considéré comme le testament de la Génération perdue, il semble certain que Sur la route deviendra celui de la Beat Generation. »
Gilbert Millstein, New York Times, 5 septembre 1957.
Écriture moins ébouriffante que celle de Just Kids, c’est aussi parce que là où Patti Smith écrivait son époque du point de vue d’actrice, Joyce Johnson la raconte depuis le poste d’observatrice. Ces deux livres se répondent néanmoins, puisque celui-ci s’achève en 1959 dans le Village, moment où une jeune Patti Smith y fait sa première incursion, fraîchement débarquée de son New Jersey natal. Le final tragique de Personnages secondaires m’a saisie, car on avait oublié en pleine lecture que beaucoup des personnages primaires et secondaires ont péri, parfois avec fracas, souvent avec pathétisme et sordidité. Une fin qui vous fait relativiser la nostalgie de ces années-là.





 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !