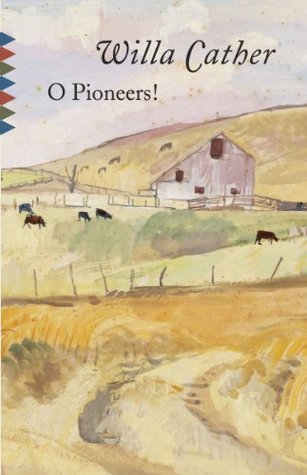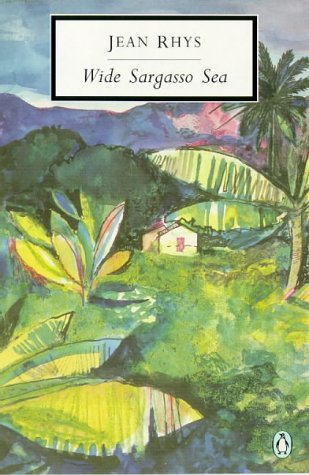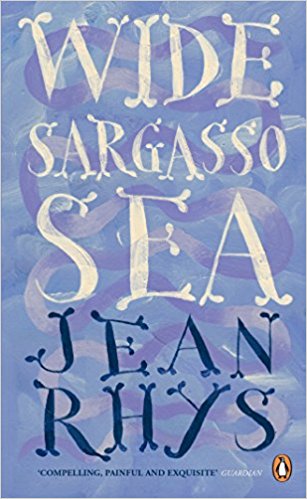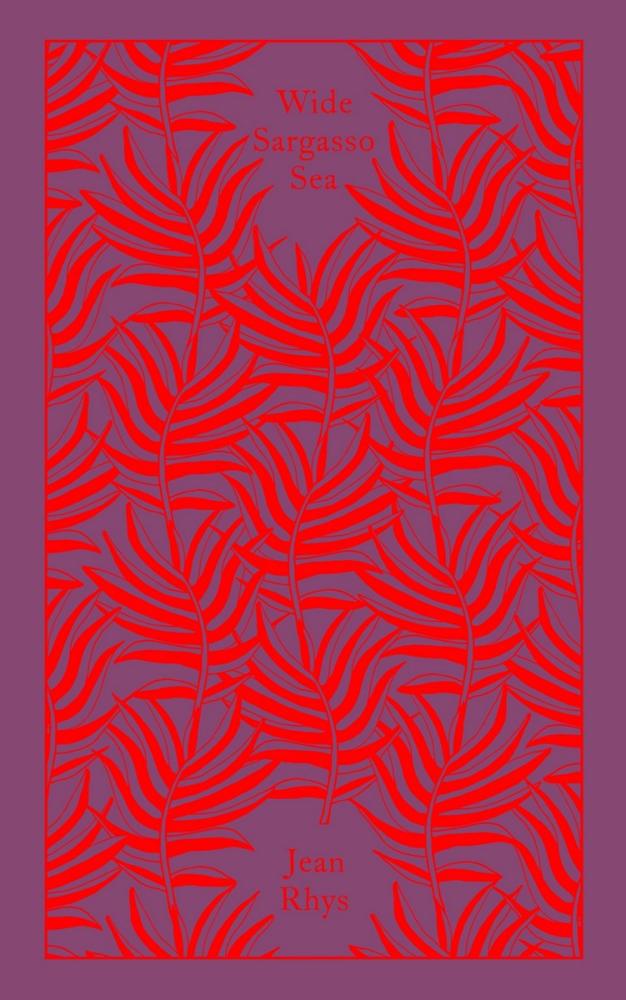Lorsque Maria Pourchet se décide à mettre à exécution l’un de ses plus anciens projets – écrire un roman – elle se saisit de son ordinateur et accouche de son premier mot : avancer. C’est autour de cette notion que le roman va entièrement manoeuvrer.
Née en 1980, et originaire d’Épinal, comme son personnage principal, Maria Pourchet publie ce premier roman aux éditions Gallimard à la rentrée littéraire d’août 2012, après avoir envoyé son manuscrit avec succès à deux autres maisons d’édition. S’il s’agit de son premier roman, il ne s’agit pas néanmoins de sa première publication puisque Pourchet est sociologue et a collaboré à des publications de revue et journaux (dont le Républicain Lorrain), ainsi que co-dirigé un ouvrage aux éditions de L’Harmattan, Les médiations littéraires (2011). Sur ce dernier sujet des médiations littéraires, elle a pu notamment intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de rencontres universitaires et a été attachée temporaire d’enseignements au pôle métiers du livre de Saint Cloud.
L’histoire
Spécialiste de la sociologie, Maria Pourchet utilise sa discipline comme cadre pour son premier roman avec un étonnant sens de l’auto-dérision.
Victoria, ex-étudiante de sociologie, se cherche : assise sur le balcon de cet appartement du premier arrondissement parisien, elle observe la rue et le trou qui se creuse sur le chantier face à son immeuble. Elle a décidé de ne rien faire, attendant que le Destin lui fasse signe. Touchée par une flemmingite aiguë, elle est entretenue de son plein gré par Marc-Ange, son ancien professeur, éminent spécimen de la sociologie que la narratrice nous présente comme éclairé (« L’un des rares à savoir que la sociologie n’existe pas »). Issus d’une première union mise en échec, le Petit et sa soeur sont les deux bêtes noires de Marc-Ange : s’il peut faire sans, il tient à ne pas se gêner. Le premier est un enfant précoce, dont la lucidité et le vocabulaire mettent souvent en échec les arguments des adultes ; la seconde est son exact opposé, demeurée à un stade végétatif de l’avis unanime de son entourage, y compris ses parents. L’inaction de Victoria (recherchée, à l’inverse de celle de Marc-Ange, imposée) devient inacceptable sur le long terme, aussi une enquête sociologique sur les « Vélenvilles » lui est confiée. Au milieu de nombreuses péripéties, les enfants s’installent au domicile de Marc-Ange, Victoria en est expulsée pour infidélité et parasite un autre foyer, celui des Dupont, couple filial de sans-abris, vivant de pigeons et de vols de matériel de « Vélenville » sur le chantier en bas de l’immeuble. Cette déchéance sociale se trouve être une aubaine, puisque cette fois, forcée de contribuer aux revenus, Victoria s’improvise cartomancienne l’espace de quelques jours, tirant parti de sa foi en le Destin, mais surtout de son don de lucidité et d’observation. Cette situation n’est néanmoins pas vouée à durer, et le Petit lui signifie par son absolution qu’elle est habilitée à « remonter ». Néanmoins, Victoria prend part à cette décision et réintègre le foyer conjugal du cinquième étage en ayant amorcé une prise en mains de son avenir.
L’enjeu du titre
Cette problématique d’avancer est un enjeu que l’on perçoit en filigrane tout au long du roman : elle est incarnée par les différents personnages du roman. Victoria refuse d’agir et concentre toute son énergie dans l’attente, Marc-Ange est aux prises du syndrome de la page blanche, Augustin est étriqué dans son couple et dans son travail… et l’enfance du Petit est coincée dans un univers trop intellectualisé. Ce thème de l’avancement est évoqué sur plusieurs plans : à l’immobilisation de la pensée, s’adjoint l’immobilisation physique et diégétique. Trois états sont remarquables en ce sens : un premier état d’immobilisation initiale ; suivi d’une mise en branle, du fait des événements, impliquant une première descente ; complété par une seconde mise en branle, cette fois du fait de la volonté des personnages, impliquant une remontée. Cette mise en mouvement vise à participer au développement personnel des personnages du roman : Victoria est promue de parasite irresponsable à capable de prendre son avenir en mains, Marc-Ange voit son manque d’envie et d’idées déverrouillé, Augustin est finalement désengagé de sa relation conjugale. L’appartement « haussmannien » voit se dérouler la majorité de l’action en huis-clos et donne une apparence de stagnation physique à ses habitants. Victoria, notamment, demeure « suspendue dans les airs » sur son balcon, duquel elle ne varie pas beaucoup. Ses mouvements dans la ville (le questionnaire sociologique en « Vélenville », la promenade touristique dans Paris) offrent une première tentative de mise en branle physique, qui finira par conduire à une mise en mouvement psychique, mais n’aboutissent en l’état qu’à une forme d’observation s’apparentant à l’errance, et à des enregistrements qui ne serviront jamais. Cette union du physique et du psychique atteint son point paroxystique lorsque Victoria se décide enfin à « prendre ses affaires » et quitter l’appartement : prise d’un terrible doute, elle se retrouve coincée entre la cage d’escalier et la porte d’entrée qui lui est refermée au nez, incapable de faire un pas dans un sens (la sortie de l’immeuble) comme dans l’autre (l’entrée du domicile). Il faut attendre l’arrivée de Francis, le concierge, qui la force à partir, nécessitant la place pour accomplir ses corvées. Une nouvelle fois, la protagoniste s’est trouvée inapte à prendre une décision.
Pour traiter cette problématique, Maria Pourchet utilise notamment deux éléments que nous nous proposons d’analyser : d’une part, une narration éparpillée, dont la constante agitation prévient cet enjeu d’avancement ; d’autre part, le choix de l’humour, pour évoquer des thèmes sociaux et critiques (« au sens de « frappés par la crise » et non par « la capacité objective d’exercer le jugement », attention au contresens », comme le dit si bien la romancière).
La voix narrative : une « voix » royale
La narratrice et protagoniste semble a priori être aux prises avec une personnalité multiple. Dès l’incipit, Victoria alterne entre la première et la troisième personne du singulier pour se mettre en scène dans le paysage urbain qu’elle décrit.
Une voix scindée
La voix narrative se présente d’emblée comme double, sous la forme d’une petite annonce, introduisant le thème de la recherche : « De l’autre côté de la route, Victoria née Marie-Laure, Vosges, préfecture Epinal, vingt-huit ans, cherche actuellement à Paris la voie royale. (…) Victoria c’est moi. » Une fois présentée comme plusieurs, elle ne peut s’empêcher d’aller de l’une à l’autre : cette incapacité à se fixer a pour conséquence l’impossibilité de choisir une direction unique dans laquelle aller, et c’est l’immobilisation du personnage comme un tout qui en résulte. Cette scission de la personnalité participe de l’immobilisation. « (Marc-Ange) compte avant d’être mon, enfin avant d’être l’amant de Marie-Laure qui s’était pourtant promis de ne pas tomber dans le panneau, parmi ses enseignants. » ou encore un peu plus loin : « - Tu m’étonnes, ricane un peut fort la maîtresse de maison, car je bois déjà beaucoup trop mais qu’est-ce que vous voulez. »
Mélange de déni et de déresponsabilisation, la voix narrative utilise différents prénoms pour compartimenter ses réactions et ses fonctions. Marie-Laure est la provinciale effarouchée à la mauvaise humeur décomplexée, et Agathe désigne la panoplie étudiante qui ne serait pas tombée dans les bras de Marc-Ange, tour à tour coincée ou sans vergogne. C’est d’ailleurs cette dernière qui est à blâmer pour la tromperie « - Tu sais, amour, il a pris ses précautions. Il ne m’a pas touchée, précise par ma voix Agathe qui me fait honte. »
En les séparant, il devient alors possible de les utiliser comme les outils d’une stratégie d’évitement, un moyen de n’endosser aucune responsabilité et de ne confronter aucun problème. Le personnage peut vivre confortablement dans le déni puisque chaque aspect de sa personnalité (Agathe, Marie-Laure, Victoria) – une notion extensible à l’infini au demeurant – est calibré pour compléter et assumer ce que l’un ou l’autre de ses aspects ne reconnaît pas. Bien que la voix de la narratrice semble elle-même confuse par moments, cette scission est moins symptomatique d’une névrose que d’un refus de faire face à soi-même et de la peur de faire usage de son libre-arbitre. Son être en tant qu’unité propre fait sécession, marquant son désarroi devant l’absence de certitude en l’avenir.
Voix de l’extérieur, voix de l’intérieur
Sa narration semble retranscrire les mouvements que ses cinq sens captent : à ses propres commentaires et pensées, se greffent les paroles et les événements qui se déroulent en-dehors d’elle. La narration vise à unir mouvements extérieur et intérieur, en une tentative rhétorique de rendre sur papier cette réalité de voix multiples qui se mêlent et brouillent les signaux de la pensée et la parole qui en découle. La voix narrative est aussi une vue (« Je n’invente rien. Tout cela est, d’aujourd’hui et en détail, décrit sur un panneau. ») et une ouïe narrative. « Vautré sur la première marche après les boîtes aux lettres, le Petit est plongé dans la lecture d’un magazine. Les rondeurs, c’est chic ; ces hommes qui mentent ; médecines naturelles, qui croire ; s’épanouir, dossier. » Son oeil témoigne de la scène avec une simplicité aride : plaçant le protagoniste dans l’espace, il se contente de lire l’intitulé des pages, pour permettre à l’incongruité de la scène de parler d’elle-même. Sa voix se démultiplie : elle retranscrit celle du magazine, mais par effet de conséquence, également celle du Petit, lui-même en train de lire le magazine.
Plus rentre-dedans, comme dit la langue française qui en a de bonnes. Il faudrait parvenir à me faire comprendre en somme. Ce à quoi j’ai justement renoncé depuis mes quatre ans et les débuts révélateurs de ma vie sociale qui, tiens bonjour, messieurs, dis-je, avisant les Dupont.
Les voix intérieure et extérieure se mêlent. En attendant, Victoria, de son prénom emblématique, a trouvé une « voix royale », un « nous » qui englobe une multitude d’autres voix, dont certaines ne lui appartiennent pas mais rebondissent pourtant sur le miroir de sa psyché. « - Bordel de merde, répond Marc-Ange mais il ne parle pas vraiment de la société. C’est à cause de la palourde qu’il vient de lâcher dans le broyeur au prix que ça coûte. » Il en va presque d’un joyeux boucan dans la narration, qui n’est même pas capable de différencier les discours directs des discours rapportés, les paroles des pensées :
Les conditions, qui sont là pour ça, excusaient tout mais ne changeaient rien, regardons les choses en face : j’avais ramassé un gars dans la rue.
- On s’est tout de même croisés chez vous auparavant ! se défend le type, car je pense à voix haute.
Pour éviter de se fixer sur elle-même et s’offrir le luxe d’un énième interlocuteur, la voix narrative va jusqu’à faire parler Roland, le chat :
Une fois n’est pas coutume, risquons-nous, c’est bon le pouvoir, à sonoriser le chat. Le mieux serait que tu ne m’adresses pas la parole, pauvre conne, prononce donc Roland, déplaçant le présent récit vers la science-fiction et la faute de goût. Ce à quoi nous renonçons immédiatement en invitant le chat à se taire à l’avenir. C’était juste pour essayer.
La voix narrative est avant tout consciente de sa posture, lucide dans ses commentaires et ses possibles, de son potentiel humoristique et de sa fonction illusoire de figure d’autorité.
Une voix énonciative peu sérieuse ?
Mettons Victoria, mettons même Marie-Laure, diplômée du supérieur, engourdie au balcon, faute d’échéances. Mettons faible personnage paralysé par la trouille, obscure, de devenir la Bovary et celle, téléphonée, de devenir sa mère. Quoi d’autre ? N’a jamais cotisé ou quasi. Quoi d’autre ? J’ai la nette impression d’oublier quelque chose. La lucidité. Individu tout à fait lucide. Voilà.
« Mettons Victoria » est une formule familière, orale, posant l’hypothèse d’un personnage. L’énoncé paraît presque accidentel, il souhaite expédier la présentation et ne pas trop s’attacher à déterminer quoi que ce soit. Dès le début, on constate une mise à distance de la narratrice avec son propre énoncé : cette ironie, à son propos, fait d’elle un personnage à la fois lucide et désengagé d’elle-même. Cette levée d’hypothèses sur l’énoncé la présente d’emblée comme une narratrice peu aux faits de ses responsabilités, dont l’auctorialité est un leurre, une tâche fastidieuse dont elle s’acquitte avec peine. La répétition de « Quoi d’autre ? » et le mot final « Voilà » révèlent parfaitement, par leur tournure lapidaire, son désir d’expédier cette présentation.
Les noms ne paraissent pas revêtir d’importance à ses yeux, tant ils humanisent et situent des êtres et des situations avec lesquels elle souhaite demeurer étrangère : la dénomination du Petit et de Dupont Vieux se fait presque à ses dépens d’énonciatrice, et semble être un cadeau inattendu que le lecteur lui a arraché, à force de patience. Mais lorsqu’ils sont enfin nommés, il s’agit pour leurs noms de servir un but humoristique : le prénom de Dupont Vieux est aussi banal que le surnom caricatural trouvé par Victoria (Michel), quant au fils de Marc-Ange… Il s’agit du Petit Nicolas.
Quant à la durée et le lieu, le roman est figé à la fois dans l’espace et dans le temps. C’est le règne du présent. Le passé est clairement oblitéré, on le rembobine exactement comme un film en accéléré. Le temps n’est pas traité de façon vraisemblable : l’emphase est mise sur la dizaine de jours qu’elle passe aux côtés des Dupont. Du reste, le traitement du temps semble être une corvée pour la narratrice, qui préfère rapporter des événements sans s’empêtrer de préambules fastidieux. L’idée de progression est happée par cette absence de cheminement : la situation finale elle-même est introduite par le biais d’un bond dans le temps.
Ce traitement de la mémoire se retrouve dans l’absence de rancune chez Marc-Ange, ou du souvenir d’avoir possédé un recourbe-cils chez Victoria : le présent est prégnant et renforce l’image de personnages accaparés par eux-mêmes.
Le choix de l’humour
L’humour exprime, selon Maria Pourchet, une « forme aiguë de la tolérance ». La comédie est à la fois un moyen et une fin.
Une hygiène d’écriture
L’humour fait figure d’hygiène de l’écriture dans Avancer, tant la moindre situation est traitée au travers de son prisme. Les personnes font pleuvoir les remarques mordantes et ne s’épargnent aucune franchise : la lucidité de Victoria est même une constante invitation à ironiser sa propre situation. L’humour émerge du contraste créé par l’alternance entre les niveaux de langue : le langage soutenu des personnages pour lesquels il paraît impropre au premier abord (le Petit, Dupont Vieux) et les réparties grossières de Victoria et Marc-Ange. Les personnages présentés comme « éduqués » (l’étudiante, le professeur) sont ceux dont la langue est la plus relâchée.
Son écriture vise à retranscrire, comme nous l’avons déjà dit, le mouvement de la vie à l’intérieur de la narratrice et à l’extérieur. De ce fait, elle détourne les règles linguistiques et typographiques afin d’en rendre un usage modernisé et oralisé. Il ne s’agit pas de jouer sur l’orthographe pour rendre le français quotidien parlé, à la façon du néo-français de Queneau, mais la rythmique de son style présente des similarités, et un résultat comique analogue.
C’est dans ce sens que dans le cadre de la présentation du Petit, elle « ouvre » les parenthèses, non pas comme à l’écrit par leur signe typographique et silencieux, mais en signifiant verbalement l’action de les ouvrir, amplifiant la force de sa voix. Cette voix narrative veut être entendue :
En résumé, pour le Petit, trois choses à retenir : rempli de connaissances inutiles, pas sortable, appartient à un autre foyer fiscal, fermons la parenthèse.
Ce contournement des règles grammaticales visant à mimer le langage parlé se retrouve notamment dans l’usage de la ponctuation. On relève, par exemple, l’absence de marquage de l’interrogation : « Est-ce que je règle la circulation, non. » L’intonation est celle de l’affirmatif. Cette question rhétorique se voit ôter sa marque interrogative pour apparaître dans sa véritable nature, dont l’évidente réponse devient incluse dans la phrase même, n’étant plus séparée que par une virgule. Dans une optique similaire, l’usage de la virgule remplace celui du point ou des tirets de dialogue : la phrase devient le réceptacle de multiples informations (narration, commentaires, discours directs et rapportés, etc) et la virgule seule permet d’en dissocier les éléments.
Maria Pourchet détourne donc la codification syntaxique figée de l’écrit, pour offrir une écriture mobile, inventive, mélange d’expression orale et de pensées.
Des personnages anti-héroïques
L’humour provient de ces personnages égocentriques, sans-gêne, opportunistes et sans scrupules, qui disent tout haut ce qu’il est bon de penser tout bas : ce sont des personnages qui, littéralement, pensent à voix haute. Ils n’ont que très peu de retenue verbale.
Victoria s’apparente à une anti-héroïne du genre picaresque : elle narre, d’une voix lucide qui n’épargne personne, sans aucune marque de jugement. Un jugement de sa part induirait une volonté de changer ou d’améliorer l’état des choses ; or, il s’agit pour la narratrice d’établir les faits, de peindre d’après nature et de s’en divertir. Dans une certaine mesure, elle incarne le rejet de certaines valeurs sociales : le travail, l’indépendance, la famille recomposée, le couple. Dans une société où l’accent est mis sur l’effort et le développement personnel, Victoria se montre opportuniste et sans scrupule, dépourvue de savoir-vivre, de serviabilité et d’amour pour son prochain. Elle semble, au premier abord, être un personnage irrécupérable : ainsi, tandis qu’elle est prise sur le fait de la tromperie par Marc-Ange et le Petit, qu’elle imagine choqué l’espace d’un instant, elle a ce geste mécanique de caresser ses cheveux, mimique empruntée dénuée de sens, dont l’hypocrisie de tarde pas à apparaître d’un côté comme de l’autre (condensée dans le performatif « je lui explique qu’il n’a rien vu« ), provoquant alors une chute jubilatoire :
J’entreprends de caresser les cheveux du gosse. Tout doucement. Ce faisant, je lui explique qu’il n’a rien vu, et que, dans le cas contraire ce n’est pas grave. Il en verra d’autres. Mais le Petit a l’air calme. Il précise simplement que, sans vouloir être grossier, il vient de se laver les cheveux.
L’adulte est dépeinte dans toute son irresponsabilité, n’en démordant pas, même dans les situations les plus poussées. Le ton cynique de Victoria fait face au Petit, drapé de dignité pour deux.
Victoria, Marc-Ange (dans son rôle de père qui ne recule devant rien pour se débarrasser de ses enfants), la soeur, le Petit et Augustin, ont des attitudes dans l’ensemble aberrant, semblant en porte-à-faux avec la bonne conscience de leur époque. L’auteure met en scène des personnages complaisants, dont la franchise balaye les fioritures habituelles du langage social (la scène du dîner « bourgeois » organisé par Marc-Ange est en ce sens probante et se présente comme le reflet antinomique du reste du roman, où l’hypocrisie et la langue de bois sont reines). Ces comportements et sentiments dont se font écho les personnages sont ceux que la société censure ou réprime, des comportements dénués de toute noblesse qu’il n’est pas prévu d’assumer. On peut se demander alors si ces personnages foncièrement frondeurs et ironiques ne sont pas une critique de la comédie sociale qu’il faut mettre en oeuvre pour ne pas autoriser des ressentis inacceptables dans leur authenticité, dont la verbalisation ouvrirait la voie au désordre tel qu’en témoigne Avancer.
L’absence de tragique
Le roman est bien décidé à se moquer et à tirer une leçon de ce personnage récalcitrant, plaçant tout entre les mains du Destin : Avancer vise à montrer à ses personnages qu’aucun déterminisme ne saurait les enfermer, et qu’il s’agit simplement pour eux de mettre en branle l’exercice de leur libre-arbitre. Ainsi, chaque situation ayant un potentiel tragique voit ses codes détournés à des fins purement comiques : « Je goûte comme un sentiment de danger. Subtil. Pas désagréable. (…) L’extérieur est connu pour son hostilité. Il pourrait m’arriver n’importe quoi. Mais le piéton passe au large, le chien avec, certainement visaient-ils autre chose.« . Les accidents graves sont relayés au statut de péripéties, l’énonciatrice les traitant avec un relativisme teinté de cynisme : on le constate lors de l’accident de voiture de la mère des jumeaux, provoqué en partie par Victoria. L’ironie tragique de la situation (les deux protagonistes ignorent chacune l’identité de l’autre, l’accident provoque l’incapacité de la mère à prendre soin des enfants, et déclenche ainsi le pire cauchemar de Victoria : la garde de Marc-Ange, entraînant des changements au domicile et possiblement la tromperie) devient un élément fondateur de la comédie. Ce hasard, à l’image du meurtre accidentel de son père par Oedipe (comme chez Cocteau, pour sa dimension humoristique), propulse la série d’événements perturbateurs qui conduiront Victoria à descendre dans la rue. Mais à la place d’un dénouement tragique, il s’agit en vérité d’un élément ouvrant la voie à sa responsabilisation.
« On peut le dire tout de suite pour souffler : la revanche du Destin n’advint pas. Il doit y avoir une certaine marge. Ou bien des échéances. » Ainsi, les événements tragiques deviennent des puits à répercussion comique dans leur absence de conséquences graves : la chute de la soeur du balcon du cinquième étage, un événement dramatique, devient un énième rappel de sa bêtise et un élément humoristique lorsqu’elle se trouve sauvée par la présence d’un store.
Les événements ne sont jamais déterminants, il n’y a pas de passion forte, les personnages pardonnent, et lorsqu’ils manquent leur chance, une autre se présente. Les actes ont des conséquences qui ne paraissent pas sceller le sort des personnages : c’est le pragmatisme qui prime.
Le personnage de Victoria est mis dans des positions grotesques : elle ne parvient à réfléchir qu’aux toilettes, quitte à utiliser les toilettes du chantier. Le ridicule de la situation vient de ce lieu, impropre à la réflexion, mais qui dans le cas de Victoria, la génère. Ce lieu sans noblesse, mais qui demeure un « trône » pour Victoria, est pourtant le dernier bastion d’intimité pour s’isoler du monde. Avancer montre qu’on est souvent interrompu et entravé dans les tâches que l’on souhaite mener à bout, que la ville, la famille, sont des perturbations dont on cherche à se prévaloir, mais qui à l’arrivée, jouent un rôle moindre que le libre-arbitre (ainsi, Marc-Ange dispose d’un bureau dans lequel il est interdit de pénétrer, mais l’existence de cette « pièce à lui » ne suffit pas à lui permettre d’être productif).
Il n’arrive jamais rien de grave. Mélange de paresse et d’effronterie, c’est avant tout son absence de vision à long terme qui permet à Victoria une telle déchéance.

Maria Pourchet introduit une galerie de personnages aux comportements censurables, qui amusent par leurs perpétuelles transgressions : elle les déculpabilise sans toutefois les déshumaniser tout à fait, leur accordant toujours une conscience in extremis des limites à ne pas franchir. Personnages fondamentalement imparfaits, le dénouement leur accorde chacun une situation finale plus satisfaisante que leur situation initiale, réalisant ainsi l’avancement désiré (même la soeur du Petit voit son sort illuminé de l’espoir de s’en sortir). La conclusion est dépourvue de toute valeur moralisante. Il n’y a ni aveu, ni contrition. Le récit distrait plus qu’il n’instruit, il vise à faire sourire et montrer avec bonne humeur et légèreté la capacité de personnages récalcitrants à se dépêtrer d’eux-mêmes. C’est une conclusion positive, pour un roman qui n’a cessé de l’être tout du long.
Cependant, si l’humour, du mot de Kundera, est l’ivresse de la relativité des choses humaines, Avancer ne va pas jusqu’à s’en enivrer à tout prix. Bien que le mode comique soit la réponse de la voix narrative aux situations de gravité, la lueur d’une conscience des limites du cadre romanesque s’immisce pourtant dans sa narration, aussi éphémère soit-elle. Ainsi note-t-on, de prime abord, l’ironie avec laquelle est traitée la scène de l’agression de Victoria par Furet :
Cette gourde régionale devait bien se faire agresser un jour ou l’autre. Ça dessale, une agression, c’est fait pour. Et puis tu aurais continué à penser que les viols, c’est dans le journal, plaisante Victoria, à qui ça ne risque pas d’arriver.
Comme à son habitude, la narratrice dédramatise l’événement et assène son ton d’ironie fataliste. Pourtant cette fois, c’est un silence abyssal qu’oppose Marie-Laure, marquant l’échec de la voix narrative à se convaincre elle-même. Le traumatisme est établi et sa relativisation est mise en échec.
Pour conclure sur cette nuance apportée à la comédie, nous relèverons deux situations du roman dont la tonalité pathétique s’avère déstabilisante, dans un ouvrage qui ne se départit jamais de son ton humoristique. Il s’agit des deux approches des utilisateurs des « Vélenvilles » : Louis et le couple de nageurs, Jérôme et Cédric, semblent être les uniques remparts résistant à l’ironie de Victoria, qui dans le cadre de son étude sociologique, n’est présente que pour les enregistrer en l’état. Ces deux moments fonctionnent comme deux entractes, à la manière du monologue du jardinier dans Electre, de Jean Giraudoux.
Louis, l’utilisateur du « Vélenville » et de la laverie du Panthéon coursé par Victoria, nous est introduit comme un garçon à « la trentaine hésitante » : paralysé entre sa place sociale et sa conscience sociale, il représente l’impossibilité du moi à faire fi du monde qui l’entoure. Il en a intériorisé les codes, les attentes, les valeurs : tout en admettant une certaine mesure de superficialité de ces codes, il ne peut atteindre un sentiment d’acceptation et d’accomplissement du moi puisqu’il ne leur correspond pas. Son sentiment d’échec est tiré de sa non-conformité. Louis est aussi la voix d’une classe moyenne prise entre deux feux : celle de la bonne conscience (il ne faut pas mépriser ou se sentir repoussé par la notion de prolétariat) et son individualisme de classe – et d’époque. Tout comme Victoria, c’est la culpabilité qui peut motiver ses bonnes actions. Louis a le syndrome moderne de « l’éternel étudiant », qui ne s’assume pas, tiraillé et meurtri, incapable de renvoyer une image de réussite « conforme » (la voiture, la femme, la machine à laver). Malgré sa pleine conscience de la superficialité de ces attentes, son sentiment d’infériorité est inhérent : l’image de raté que lui renvoie l’inconscient collectif est une matraque à laquelle il ne parvient pas à échapper.
Ce passage d’Avancer agit comme un interlude : la parole est soudainement donnée à un passant, un « jeune homme » tout le monde, une voix parmi les voix, avec tout ce qu’elle contient d’incohérent et de vrai. L’ absence d’intervention de Victoria retire à la scène sa tonalité humoristique, et le monologue de Louis acquiert une surprenante – mais inévitable – tonalité pathétique. Tout comme l’échange de Jérôme et Cédric, la parole émotive est accordée à une figure prosaïque, actuelle, avec la possibilité d’échapper à la lecture humoristique de la narratrice. La longueur de l’intervention, une quasi-exception du livre, et la disparition de la voix ironique, rend l’impuissance de cette voix pathétique considérablement touchante.
 Toi aussi, danse comme un païen !
Toi aussi, danse comme un païen !